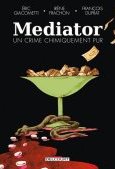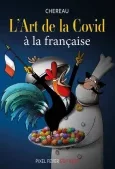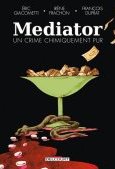65 ans de lutte contre les maladies infectieuses
Le regard d’un pionnier de la santé mondiale
Publié en ligne le 17 août 2023 - Médecine -
Marc Gentilini est né en 1929 à Compiègne, mais c’est à Reims, où ses parents s’installent dès 1937, qu’il effectue ses études secondaires, en temps de guerre. Pendant l’Occupation, son père, prisonnier, a été absent cinq ans. Sa mère était infirmière. Dans cette ville, il commence ses études de médecine qu’il termine à Paris où il devient interne des hôpitaux. Entre 1957 et 1959, le service militaire obligatoire le conduit dans l’Algérie en guerre en tant que médecin-appelé. Après six mois sur place, il est envoyé à Dakar au Sénégal puis à Bamako au Mali (le Soudan français de l’époque), destination qu’il avait souhaité rejoindre depuis son enfance. Là, il découvre avec enthousiasme un monde nouveau et se familiarise avec les maladies tropicales.
De retour à Paris, il ouvre en 1959, au sein du service de médecine générale qu’il a rejoint, une consultation consacrée aux maladies tropicales et parasitaires. En 1966, il obtient son agrégation et est nommé directeur du Laboratoire central de l’hôpital Saint-Louis, chargé de l’hématologie, de la bactériologie, de la virologie, de la parasitologie et de la mycologie.
En 1968, alors professeur à la faculté de médecine de Paris, Marc Gentilini crée à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière le Service des maladies infectieuses et tropicales qu’il dirige jusqu’à sa retraite de l’Assistance publique en 1997. Pionnier dans la prise en charge du sida, il ouvre en 1981, avec l’un de ses assistants, Willy Rozenbaum, une consultation dédiée à cette maladie alors émergente. En 1987, il crée et dirige jusqu’en 1996 l’unité de recherche de l’Inserm « Paludisme et sida en Afrique » (Inserm 313).
Tout au long de sa carrière, Marc Gentilini a effectué de nombreuses missions en Afrique surtout, mais aussi au Cambodge, au Vietnam et en Haïti. Il nous livre ici ses réflexions sur 65 ans de la discipline qu’il a incarnée en France.
Propos recueillis par Jean-Paul Krivine, avec la collaboration de Quentin Duteil.
Les notes de bas de page sont de la rédaction de Science et pseudo-sciences.
SPS. L’infectiologie en tant que spécialité médicale est venue récemment au premier plan de l’actualité avec la pandémie de Covid-19. Auparavant, le terme de « maladie infectieuse » était souvent associé, dans l’esprit du public (ainsi que dans les noms des services hospitaliers), à « médecine tropicale ». Il renvoyait essentiellement à des maladies qu’on pouvait contracter lors des déplacements hors de France. Vous êtes un des pionniers de cette discipline. Votre parcours a commencé en Afrique…
Pr Marc Gentilini. Encore étudiant en médecine à Reims, avant de partir à Paris, mon souhait était de découvrir Bamako, une ville repérée sur le planisphère accroché au mur de ma chambre. Bamako était pour moi un peu le centre de l’Afrique dont je rêvais. Lorsque vint la période du service militaire (trente mois 1), comme tant d’autres de ma génération j’ai été envoyé en Algérie : opérations et évacuations de blessés… Ce moment m’a beaucoup marqué. Initialement, j’avais demandé à partir en « Afrique noire », mais ma requête était restée sans réponse jusqu’au jour où je reçus l’ordre de quitter Hammaguir, dans le Sud algérien, pour Dakar par voie maritime. Émerveillé, j’ai découvert l’océan, la ville, ses habitants, les couleurs...

Mais sur place, le commandement m’a signifié que je ne resterais pas au Sénégal et partirais pour Bamako ! À peine arrivé dans cette ville dont je rêvais, j’ai été affecté encore plus loin, à Gao, Kidal et Tessalit au nord-est (dans l’actuel Mali), connues aujourd’hui pour les tragédies qui s’y trament. Cette zone faisait alors partie du « Soudan français » 2.
Quels souvenirs de médecin gardez-vous de cette période ?
J’effectuais des tournées pour lutter, entre autres, contre la méningite cérébro-spinale qui sévissait sous forme d’épidémies dramatiques et contre celles de rougeole qui tuaient beaucoup d’enfants. Nous partions à bord de deux Land Rover, administrions des antibiotiques ou des sulfamides et ne disposions d’aucun vaccin adapté ; le premier vaccin contre la rougeole a été mis au point au début des années 1960, celui contre la méningite cérébro-spinale au début des années 1970. Ces maladies qui n’étaient pas spécifiques aux pays tropicaux y prenaient une tournure tragique parce qu’elles frappaient des personnes, des enfants le plus souvent, marquées par la précarité, la pauvreté, la promiscuité, ou souffrant de comorbidités. La mortalité était sidérante.
Les tournées pouvaient-elles se faire en toute sécurité ?
Oui, seul un « garde » du service administratif, armé d’un fusil de chasse obsolète, nous accompagnait. Il représentait l’autorité ! Quand je vois l’actualité depuis 2012 et le conflit armé qui la caractérise, c’est avec tristesse que je pense aux victimes, le plus souvent et massivement civiles. Sans sécurité absolue, il est impossible de mettre en œuvre une action sanitaire durable et efficace. Le drame de la faim, en particulier, est directement lié à cette insécurité. La faim, et même la disette, ne devraient plus exister. Il y a assez de nourriture dans le monde pour les huit milliards d’individus, mais on ne peut rien faire de sérieux, de contrôlable et de suivi sans sécurité. C’est valable pour le sida, pour le paludisme, pour les campagnes de vaccination, comme pour la faim. Les moyens sont là. Mais l’utilisation des fonds est entravée et le résultat est déplorable.
Quelle est la vision du jeune étudiant en médecine que vous étiez quand il arrive en Afrique avec les connaissances médicales acquises à l’université ?
C’est encore la période coloniale, le statut politique est celui d’un État gouverné par la France, avec une pression croissante des populations pour un accès à plus de responsabilités.
L’image « pathologique » du monde pouvait être schématiquement décrite par deux « photos » très différentes. Au Nord, dans les pays économiquement développés, sévissaient avant tout des maladies dégénératives comme l’arthrose,
ou prolifératives comme le cancer, des maladies de surcharge comme le diabète, des accidents de la voie publique… On soignait les gens pour des troubles psychiatriques, des addictions aux drogues. À l’opposé, au Sud, dans les pays les plus pauvres, les maladies infectieuses et les maladies spécifiques tropicales dominaient (filarioses, bilharzioses, paludisme).

Ce schéma est devenu caduc parce qu’aujourd’hui, le Nord est susceptible d’être atteint par les maladies infectieuses du Sud. Le sida, qui a émergé en Afrique en 1981, en a été la démonstration. La Covid-19, partie de Chine en 2019, illustre également le fait que les épidémies ignorent les frontières… Inversement, des maladies que l’on pensait spécifiques du Nord sont apparues au Sud où la population a commencé à s’urbaniser et même aussi à vieillir, tout en restant à dominante jeune. Le diabète est devenu une priorité dans les pays pauvres (cause directe d’1,5 million de morts en 2012 et de 2,2 millions de décès supplémentaires liés aux comorbidités, selon l’Organisation mondiale de la santé [1]). Il tue autant que le sida, le paludisme et la tuberculose réunis ( !), illustrant l’importance prise par les maladies non transmissibles, par opposition aux maladies transmissibles par voie vectorielle 3 (bactérie, virus ou parasite). Vous savez, en 1957 en Afrique, on m’a dit que l’hypertension artérielle n’existait guère sur le continent. C’était inexact, mais faute de tensiomètres, on ne mesurait pas la tension.
Quand vous rentrez en France, en 1959, vous ouvrez une consultation consacrée aux maladies tropicales et parasitaires.

À mon retour, j’ai constaté et déploré un vide relatif à la prise en charge des maladies tropicales. Certes, un Institut de médecine tropicale avait pris en 1948 la suite de l’Institut de médecine coloniale créé en 1902. Mais il était peu actif. C’étaient essentiellement les médecins du service de santé des armées, en particulier à Bordeaux et Marseille, qui couvraient ce domaine, presque vierge à l’université. En 1970, j’ai créé le service des maladies infectieuses et tropicales à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, à côté du service de l’hôpital Claude Bernard, plus axé sur l’infectiologie que sur l’ensemble des maladies tropicales. J’ai pu développer cette discipline avec des collaborateurs choisis qui m’ont beaucoup aidé.
Qui venait consulter ?
À cette époque, il y avait une forte immigration venant d’Afrique de l’Ouest (Mauritanie, Mali, Sénégal), avec des maladies d’importation peu connues des praticiens, telle la filaire de Médine, qui créaient surprise et parfois frayeur 4. Mais en dehors de ces spécificités, l’accent mis sur l’accueil et l’écoute de nos malades, avec mise en place très tôt de traducteurs, a beaucoup fait pour l’audience du service. Le bouche-à-oreille a très vite suscité une forte fréquentation de la consultation. Un jour, j’ai été convoqué par le directeur des affaires médicales de l’Assistance publique qui m’a dit : « Monsieur Gentilini, j’ai une plainte concernant votre consultation ». « Pourquoi, Monsieur le Directeur ? » ― « Parce qu’on trouve qu’elle est trop noire ». J’ai alors fait remarquer que ces reproches, que je rapporterais à mes collaborateurs à qui j’avais promis de rendre compte de l’entretien, risquaient d’être relayés dans les médias. J’ai alors énuméré les besoins de mon service et, avec ce qui pourrait s’apparenter à une sorte de chantage, obtenu ce jour-là tout ce que j’avais demandé sans rien avoir à modifier de l’orientation ni de l’accueil de ma consultation, au contraire.
Vous savez, les éboueurs de la Ville de Paris venaient à la consultation de la Pitié-Salpêtrière autant que les chefs d’État et les ministres africains. J’ai toujours eu beaucoup de joie à soigner les plus humbles aussi bien que les plus nantis, à leur écoute et chaleureusement, tous égaux devant leur médecin. À cet égard, le serment d’Hippocrate est clair.
Quelles étaient les pathologies les plus fréquemment rencontrées dans ces consultations ?
Avant tout la tuberculose. Dans sa forme pulmonaire, elle était contagieuse dans les foyers de migrants (mais pas pour les populations environnantes). La tuberculose était aussi souvent osseuse, vertébrale ou de toute autre localisation. En dehors de cette affection cosmopolite mais grave à cause de conditions de vie souvent déplorables, il y avait bien sûr les maladies parasitaires : le paludisme, les filarioses, les bilharzioses urinaire et intestinale. Ces dernières ne bénéficiaient pas encore des progrès thérapeutiques et étaient soignées avec des médicaments agressifs, pour la plupart injectables, douloureux et en partie toxiques. Les bilharzioses 5 concernaient à la fois des malades originaires d’Afrique subsaharienne et d’autres issus des départements et territoires d’outremer, en particulier des Antilles pour la forme intestinale. La bilharziose urinaire nous donnait des images effrayantes en urographie et en cystoscopie. De nombreux essais thérapeutiques ont été effectués et, progressivement, des médicaments oraux efficaces ont remplacé les injections algiques. On savait aussi que des recommandations de prévention simples, comme se tenir à distance de l’eau pour uriner ou déféquer, en Afrique, pouvaient déjà contrôler partiellement la bilharziose.
Quelle place justement pour ces mesures de prévention ?
En 1978, l’OMS rendait publique la « déclaration d’Alma-Ata » 6 [2] dans laquelle elle affirmait que la priorité devait être donnée aux soins de santé primaires, c’est-à-dire ceux relatifs à la prévention, l’éducation, la vaccination, la désinfection d’une plaie, etc. Les soins de santé secondaires (dans les centres de santé) et surtout les soins de santé tertiaires (dans les hôpitaux) étaient jugés trop onéreux. Les soins de santé primaires sont des soins élémentaires que même la famille peut administrer. À l’époque, pour les agents de santé susceptibles de prendre en charge ces soins, on parlait souvent de « médecins aux pieds nus » 7, concept promu en Chine dans les années 1960, que l’on a voulu politiquement généraliser, jusqu’à ce que les Chinois eux-mêmes rappellent qu’il y avait aussi en Chine une médecine moderne. Je me souviens de la venue d’un professeur chinois dans le service, auquel un externe zélé avait demandé de parler de ces « médecins aux pieds nus ». Mon collègue répondit qu’il accepterait d’évoquer cette démarche mais qu’il rappellerait surtout le travail, plus important, effectué par les universités. La déclaration d’Alma-Ata peut être résumée par la formule « un peu pour tous plutôt que tout pour quelques-uns », et fut en fait un fiasco. Elle relevait d’une conception naïve de la santé que l’épidémie de sida, trois ans plus tard, en 1981, est venue balayer : les soins de santé primaires ne suffisent pas.
À la même époque, l’OMS mettait en place une « stratégie mondiale » en vue d’atteindre « la santé pour tous en l’an 2000 » [3]. Aujourd’hui, l’institution évoque une probable maîtrise de l’épidémie de sida en 2030. Soyons prudents. Les organismes internationaux ne devraient pas faire des promesses et fixer des dates pour des objectifs sanitaires. En 1980, certains pensaient que les maladies infectieuses seraient vaincues avec la maîtrise de l’environnement, les antibiotiques et les vaccinations 8.
Et c’est à ce moment qu’est apparu le virus du sida.
Oui. Ce virus a soudainement émergé en 1981. Notre service s’est trouvé en première ligne de l’épidémie. Je rappelle que c’est à partir d’un ganglion prélevé sur un malade du service que je dirigeais à la Pitié-Salpêtrière et porté à l’Institut Pasteur qu’a pu être isolé le virus du sida, le VIH-1. Ceci a permis aux chercheurs de cet institut de recevoir le prix Nobel dix ans plus tard.
Ce virus, personne ne l’avait vu venir alors qu’il circulait depuis un certain temps dans le centre de l’Afrique. Et là, c’est une véritable révolution, un retournement de l’histoire, parce que, soudainement, les maladies infectieuses sont revenues au premier plan : politiquement, socialement, économiquement et, évidemment, médicalement. Les signes révélateurs de l’infection au VIH étaient souvent l’apparition de maladies parasitaires ou d’autres maladies opportunistes, telle la toxoplasmose cérébrale ou la pneumocystose. C’est ce qui fait que notre service a été aux premières loges, dès le début de l’affection.
Il aura fallu un peu de temps pour établir que ce n’était pas une « maladie des homosexuels » et que le principal foyer se trouvait en Afrique.
Au départ, le drame qui se jouait en Afrique était occulté par l’importance donnée au sida des homosexuels, des Haïtiens, des toxicomanes par voie intraveineuse et des malades infectés par du sang contaminé. Nombreux étaient ceux qui ne voulaient pas qu’on évoque l’Afrique, craignant de voir se disperser les moyens de lutte. J’ai eu la chance de pouvoir prévenir le maire de Paris de l’époque, Jacques Chirac, de la gravité de l’épidémie en Afrique. Comme le paludisme, c’est une infection qui est principalement répandue sur le continent africain. Les cartes d’incidence du sida et du paludisme sont presque superposables, bien qu’il s’agisse de pathologies différentes, la première à transmission essentiellement sexuelle, la seconde à transmission vectorielle (via les moustiques anophèles). La raison est simple : la pauvreté, l’éloignement des services de santé, l’inaccessibilité à des médicaments efficaces.
Oui, la pauvreté est vraiment la première des maladies.
En 1980, après des années difficiles de conquêtes de moyens et d’espaces, j’étais responsable d’un service qui venait enfin d’être inauguré, au sein du Pavillon Laveran 9 à la Pitié-Salpêtrière. Nous avions vingt lits « aigus », c’était suffisant pour le traitement des maladies tropicales d’importation. Mais, brusquement, nous nous sommes trouvés débordés par l’afflux de malades atteints d’affections parasitaires révélatrices d’une immunodéficience liée au sida. Par la volonté du maire, la mairie de Paris en charge de l’Assistance publique a imposé l’attribution de nouveaux lits. J’ai bénéficié de cinquante lits supplémentaires et du personnel associé, malgré une situation budgétaire qui conduisait déjà à la suppression de postes et de lits. Tout cela a été acquis de haute lutte et mal vu par certains collègues qui avaient aussi des besoins non satisfaits.
L’épidémie de sida a provoqué un changement majeur dans le paysage des maladies infectieuses et tropicales que vous traitiez en France. Comment décririez-vous la suite de l’histoire de votre discipline, entre les années 1980 et l’arrivée de la Covid-19 ?
Entre le sida et la Covid-19, il y a eu d’autres aventures virales sévères. Le virus Ebola, en particulier, a inquiété le monde entier et conduit à des fermetures de frontières et à l’interruption des liaisons aériennes, avec de graves conséquences économiques. Ce virus a d’abord été identifié en 1976 dans une petite rivière au nord du Zaïre (aujourd’hui République démocratique du Congo) et au sud du Soudan. Il avait une caractéristique majeure : il était extrêmement meurtrier en première ligne (avec un taux de létalité allant de 30 % à 90 %). Ce n’est donc pas un virus susceptible de créer des épidémies très larges : il tue, par exemple, dans l’environnement immédiat du chasseur qui ramène un gibier contaminé au sein de la famille, mais il est trop létal pour se propager plus loin. Cela n’a pas été le drame international redouté. Il y a eu aussi la fièvre de Lassa et des maladies hémorragiques ou non, qui ont inquiété tous les infectiologues.
Les maladies bactériennes avaient bénéficié de l’arrivée des antibiotiques et de leur utilisation jusqu’à l’excès. Les maladies virales, elles, n’avaient comme recours que le vaccin, lorsqu’il existait, mais souvent avec une efficacité remarquable, tel le vaccin anti-amaril, contre la fièvre jaune qui protège pour la vie en une seule injection. Les vaccins contre la rougeole ou la poliomyélite ont eu eux aussi des résultats spectaculaires.
Pour le sida, il faudra attendre 1996, avec l’apparition de médicaments extraordinairement efficaces. Je me souviens avoir reçu des malades arrivés sur une civière et avoué aux familles n’avoir plus d’espoir de les revoir vivants. Et c’est pourtant sur leurs jambes que j’ai revu ces patients, après un traitement par antirétroviraux.

La découverte des antirétroviraux est une des plus remarquables réussites de l’industrie pharmaceutique. Les laboratoires ont cherché, et ils ont trouvé. Comme pour le vaccin contre la Covid-19, la recherche intensive, qu’elle soit publique ou privée, a été fructueuse.
Bien sûr, le sida persiste, il y a malheureusement toujours des cas nouveaux. Les plus jeunes croient qu’avec la prise d’antiviraux avant et après un rapport sexuel, il est possible d’éviter le préservatif. C’est une erreur, et l’on voit même resurgir d’autres maladies sexuelles comme la syphilis, qui étaient maîtrisées.
Il faut rester extrêmement prudents : les maladies infectieuses, qu’on avait presque enterrées, ne sont malheureusement pas des maladies du passé. Et d’autres virus, en réserve, nous attendent. Les services d’infectiologie restent donc d’une cruelle actualité, et réclament des moyens à la hauteur des risques encourus.
Quelles leçons tirez-vous de la pandémie de Covid-19 ?
Les chaînes d’information en continu et la désinformation par les réseaux sociaux perturbent l’approche rationnelle de cette infection, et les conséquences sociales et humaines sont sans doute plus lourdes encore que les conséquences sanitaires. L’infection a tué des millions de gens, c’est attristant et regrettable. Mais, après avoir atteint les plus vieux, elle perturbe surtout l’avenir des plus jeunes. Globalement, les morts sont des gens de ma génération, ou à peine moins âgés. L’épidémie a surtout tué des personnes âgées et des personnes atteintes de comorbidités (obésité, diabète, cardiopathie…).
Affection grave et mondiale, elle surprend et épuise en « vagues successives ». On annonce la suivante, la précédente à peine entamée ! La vaccination a incontestablement protégé les personnes à risques de lourdes conséquences qui auraient nécessité de recourir aux services de réanimation, privant les autres malades de l’accès à ces services.
C’est une affection qui, médicalement, réclame rigueur, discipline et toute notre attention, mais en n’oubliant pas les conséquences autres que sanitaires : économiques, politiques et sociales. Bref, l’avenir.
Il y a eu une grande lassitude dans la société civile, qui a protesté contre les contraintes drastiques imposées parfois sans explications suffisantes ou rationnelles (masque systématique, distanciation prolongée, confinements répétés…). On peut discuter de tout cela. En revanche, être contre la vaccination est une aberration contre laquelle il faut lutter sans relâche.
Aujourd’hui, il faut apprendre à vivre avec le virus, l’épidémie est devenue une endémie. Ça ne veut pas dire vivre masqué en permanence, à distance les uns des autres, avec un flacon de désinfectant hydroalcoolique en main.
Et c’est une crise sanitaire mondiale…
La mondialisation de l’affection est un élément important qui caractérise cette crise, démontrant que « la santé sera mondiale ou ne sera pas ». Nous vivons dans un monde où nous sommes contraints à la solidarité et à l’interdépendance.
La solidarité internationale des riches vers les pauvres est aussi bénéfique pour les premiers. Le partage n’est pas qu’une question de cœur, c’est d’abord une question d’efficacité. Vous ne serez pas guéri définitivement si vous ne partagez pas les soins et l’accès à une médecine de qualité, avec des médicaments sûrs et des vaccins contrôlés. Le trafic de faux médicaments, de faux vaccins, de faux dispositifs médicaux est une autre « pandémie » qui frappe les plus démunis parmi les malades et contre laquelle nous sommes résolument engagés.
Cinq pays (Allemagne, États-Unis, France, Japon et Royaume-Uni), qui représentent 9 % de la population mondiale, dépensent à eux seuls une somme équivalente à 60 % des dépenses mondiale de santé [5]. Nous devons nous réjouir des moyens alloués à cette protection sociale, fiers de nous être battus pour les avoir obtenus. Cette situation explique en partie l’attrait que l’Europe exerce sur les populations désemparées, désespérées, dont les responsables politiques ne sont pas suffisamment à l’écoute des revendications légitimes de leurs jeunesses.
Le paludisme est une maladie qui a occupé une place centrale au sein des maladies tropicales.
Le paludisme (ou malaria) est dû à quatre formes du parasite, mais le plus dangereux est le Plasmodium falciparum, celui qui tue. Il s’agit d’une infection parasitaire mortelle quand elle n’est pas traitée. Lorsque j’ai commencé mes études, on estimait à un million le nombre de morts par an dues au paludisme. Actuellement, sans être maîtrisé complètement, il est davantage contrôlé, mais encore responsable d’au moins 500 000 morts par an, dont plus de 95 % en Afrique et plus de 80 % sont des enfants de moins de cinq ans [6] ! Les désordres organisationnels induits par l’épidémie de Covid-19 sont à l’origine d’un rebond désastreux.
L’OMS avait pensé, en 1955, parvenir à son éradication à un horizon de quinze ans. Qu’est-ce qui fondait cet optimisme ?
Cet optimisme était fondé sur la disponibilité de deux remèdes complémentaires : la pulvérisation de DDT (un insecticide) dans les habitations, pour tuer ou éloigner les moustiques vecteurs de la maladie, et la chloroquine administrée en prévention de l’infection ou de façon curative. Mais l’histoire ne s’est pas déroulée ainsi : l’objectif d’éradication a été remplacé par une plus modeste maîtrise de l’épidémie.
En dehors de son efficacité, à l’époque, la chloroquine avait des inconvénients découverts progressivement. En proposant une prophylaxie quotidienne à perpétuité sous les tropiques, on a vu apparaître des complications oculaires, pour certaines cécitantes. Le pouvoir létal de cette molécule, prise à haute dose, doit également être rappelé régulièrement. Mais surtout, des résistances du parasite sont advenues, rendant le traitement moins efficace.
Quant au DDT, c’est différent. Utilisé en agriculture, il permettait des récoltes saines, à l’abri de parasites qui les détruisaient. Mais les écologistes de l’époque ont dénoncé l’usage de ce pesticide sur les terres américaines, sans se préoccuper de ses avantages dans les pays où il était utilisé dans la lutte contre le paludisme. La lutte antivectorielle a dû être reconsidérée. Le DDT a des inconvénients, incontestablement, et il n’était pas suffisant à lui seul. En outre, des résistances sont apparues. Pour autant, il est resté longtemps un des rares moyens de lutte efficace.
La lutte antivectorielle reposait sur des méthodes simples : mise en place de protections tissulaires autour des maisons, des portes et fenêtres, etc. Les moustiquaires imprégnées d’insecticide ont été et restent un instrument efficace. Les moustiques n’ont pas disparu du continent africain !
Depuis 2020, l’irruption du Sars-Cov-2 a eu des conséquences sévères pour des maladies qui étaient en voie d’être contrôlées. Les équipes sanitaires itinérantes ou fixes ont été détournées vers cette virose, et les moyens de la lutte contre le paludisme et contre le sida ont été transférés, entraînant une reprise du paludisme et un mauvais contrôle des distributions des antirétroviraux pour le sida.
Au regard de toute votre carrière autour des maladies infectieuses, que l’on a rapidement évoquée, comment voyez-vous l’avenir ?
Je reste optimiste, tout en étant réaliste. Les avancées thérapeutiques sont extraordinaires. Un de nos grands patrons, Jean Bernard, avait préfacé un livre paru en 1983 intitulé Histoire de la médecine depuis 1940 – Plus de progrès en 40 ans qu’en 40 siècles. Ce titre était tout à fait exact. Rappelons-nous les médecins du Malade imaginaire de Molière réciter « Clysterium donare, postea seignare, ensuitta purgare » (donner un clystère, puis saigner, ensuite purger) pour la prise en charge de toutes les pathologies.
Les progrès de ces dernières décennies sont remarquables. Les générations actuelles ne se rendent pas compte de ce que l’antibiothérapie, née en 1940, a apporté. J’ai commencé mes études dans des services de tuberculeux où l’arrivée de la streptomycine a été une révolution thérapeutique aussi forte que celle de la pénicilline, dans d’autres secteurs infectieux, quelques années avant. J’ai vécu l’arrivée des antidiabétiques oraux. Plus récemment, les traitements antirétroviraux ont été un triomphe dans la lutte contre le sida. J’ai aussi participé à la mise en place d’antiparasitaires très efficaces. Les antibiotiques, les vaccinations, l’assainissement, je le répète, ont suscité l’espoir de voir les infections contrôlées et même définitivement maîtrisées. Mais il n’en a pas été ainsi.
Je pense cependant qu’on est sur la bonne voie. Les progrès attendus de la robotisation et de l’intelligence artificielle sont pleins d’espoir. Il ne faut pas les redouter. Ils ne mettront pas les médecins hors-jeu car le patient, c’est d’abord une personne qui souffre et qui a besoin de parler. L’un de mes collaborateurs, décédé depuis d’un cancer, me disait que, consultant le confrère qui s’occupait de lui, il était atterré parce que celuici ne quittait pas des yeux l’écran de l’ordinateur devant lui ; il ne le regardait jamais. Or le regard du soignant sur le soigné et l’écoute du patient sont fondamentaux, il faut le rappeler sans cesse au cours des études médicales et au-delà.
Récemment, à l’Académie des sciences d’outremer, j’ai évoqué un épisode survenu au début de mes études médicales et qui m’a marqué pour la vie. Jeune étudiant en médecine, j’ai été appelé à disséquer – on disséquait encore. On m’a donné la main d’un condamné à mort qui avait été guillotiné – c’était avant l’abolition de la peine de mort. La main à disséquer était fermée, j’ai eu beaucoup de mal à l’ouvrir. Dans cette main, il y avait un chapelet. Un rappel à l’humanité. Ce n’était pas une main à disséquer, c’était la main d’un être humain qui avait porté sa souffrance jusqu’à l’échafaud.
La disparition du « médecin à l’écoute de son patient » ouvrirait en outre la porte à la prolifération de « gourous » et à toutes les « médecines parallèles », fausses médecines et fausses illusions. Je ne crois pas que la science résolve tout et je sais bien que la vie est mortelle, que toute naissance est une mort programmée, mais je crois en la science, voie de progrès. Et je pense qu’une science à l’écoute de l’humanité à laquelle elle est destinée peut nous maintenir dans l’espérance d’une vie meilleure et solidaire.
1 | Organisation mondiale de la santé, « Rapport mondial sur le diabète », 2016. Sur apps.who.int
2 | Organisation mondiale de la santé, « Déclaration d’Alma-Ata », 1978. Sur apps.who.int
3 | Organisation mondiale de la santé, « La santé pour tous d’ici l’an 2000 : stratégie mondiale », rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif, 1980. Sur apps.who.int
4 | Snowden FM, “Emerging and re-emerging diseases : a historical perspective”, Immunol Rev, 2008, 225 :9-26.
5 | Organisation mondiale de la santé, « Dépenses mondiales de santé 2020 : affronter la tempête », Rapport mondial, 2021. Sur apps.who.int
6 | Organisation mondiale de la santé, « Paludisme : principaux faits », 8 décembre 2022. Sur who.int
1 C’est en 1957, pour les besoins de la guerre en Algérie, que la durée du service militaire est prolongée de 18 mois à 30 mois.
2 Le Soudan français est le nom de la colonie française couvrant le territoire de l’actuel Mali entre 1890 et 1899, puis de 1921 à 1958, date de l’Indépendance.
3 Les vecteurs sont des organismes vivants capables de transmettre des maladies infectieuses d’un hôte (animal ou humain) à un autre. Il s’agit souvent d’insectes hématophages, qui, lors d’un repas de sang, ingèrent des micro-organismes pathogènes présents dans un hôte infecté (homme ou animal), pour les réinjecter dans un nouvel hôte après une reproduction de l’agent pathogène. (Source : OMS, « Maladies à transmission vectorielle », 2 mars 2020).
4 La filaire de Médine est une maladie parasitaire due à un ver pouvant mesurer jusqu’à un mètre et qui vit et se déplace sous la peau.
5 Maladie provoquée par des vers parasitaires.
6 Almaty, ville du Kazakhstan s’appelait Alma-Ata pendant la période soviétique.
7 Les « médecins aux pieds nus » de la Chine de années 1960 et 1970 étaient des ruraux qui, après une courte formation médicale élémentaire étaient chargés des soins de première nécessité et de la promotion d’actions de prévention.
9 Du nom d’Alphonse Laveran (1845-1922), découvreur de l’hématozoaire du paludisme et premier Prix Nobel français de médecine en 1907.
Publié dans le n° 344 de la revue
Partager cet article
L' auteur

Marc Gentilini
Professeur émérite de la faculté de médecine (Pitié-Salpêtrière) et spécialiste des maladies infectieuses et (…)
Plus d'informationsMédecine

Tests microbiote, science ou pseudo-science ?
Le 31 mai 2023
Peut-on vraiment guérir d’un trouble psychique ?
Le 2 septembre 2023
Le regard d’un pionnier de la santé mondiale
Le 17 août 2023
Les populations sous-représentées dans les essais cliniques
Le 27 avril 2023
Maladies neurodégénératives : comment expliquer notre impuissance ?
Le 28 novembre 2022