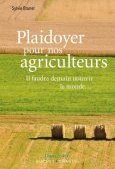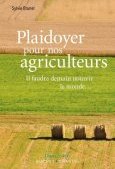La protection des cultures : était-ce vraiment mieux avant ?
Publié en ligne le 26 août 2019 - Agriculture -
Les méthodes récentes de protection des cultures mettant en œuvre la chimie ou la sélection végétale pour rendre les plantes cultivées plus résistantes aux insectes, maladies et mauvaises herbes sont décriées. D’aucuns voudraient un retour aux méthodes traditionnelles pratiquées par nos ancêtres. Mais de quelles méthodes parlet-on ? Et quelle était cette époque idéale ?
Des paysans et des dieux
La protection des cultures et des récoltes remonte sûrement aux premiers jours de l’agriculture, il y a environ 8 000 ans. Confrontés aux pullulations d’insectes et aux maladies des plantes, les hommes ont d’abord invoqué les dieux dont le mécontentement, pensaient-ils, se traduisait par ces « plaies » qui frappaient leurs cultures, et donc leur alimentation. Dans l’Avestale des Perses ou le calendrier rustique d’Hésiode (VIIe siècle avant notre ère), l’agriculture est un don des dieux. Les belles moissons reflètent la vertu et la piété du cultivateur. Les ravages des insectes et des maladies sur les cultures sont un fléau divin : « Je vous ai frappés par la rouille et la nielle, j’ai desséché vos jardins et vos vignes ; vos figuiers et vos oliviers, la sauterelle les a dévorés ; et vous n’êtes pas revenus à moi ! » (Amos – Oracle de Yahvé).
Jusqu’à la fin du XIXe siècle domine cette idée que les problèmes de protection des cultures sont liés aux croyances religieuses. La solution à ces maux ne pouvait donc venir que des autorités religieuses. Les paysans partageaient
leur temps entre labeur des champs et dévotion ! Depuis l’époque romaine, les paysans protègent leurs cultures par des rogations (du latin rogare : faire une requête), processions qui avaient pour objectif de demander la clémence des dieux. On trouvera même des dieux dédiés à tel ou tel ennemi des cultures tels qu’Erythibius que les Rhodiens invoquaient contre la nielle (la rouille) des blés, ou encore un Apollon-sauterelle contre les dégâts des criquets.

En 704 avant notre ère, Numa Pompilius, roi de Rome, institua les Robigalia, cérémonies vouées à Robigo qui se déroulaient le 25 avril, période où les rouilles deviennent particulièrement nuisibles aux céréales. Ovide, dans Les fastes (parus en l’an 15 de notre ère), décrit une cérémonie champêtre destinée à prévenir la colère du dieu Robigo, responsable de la rouille du blé.
Ces fêtes préfigurent les processions chrétiennes. Les rogations n’étant pas toujours suffisantes, les malheureux paysans voyant leurs cultures dépérir en appelaient aux autorités religieuses, comme l’atteste cette réponse ecclésiastique en 1514, citée par Balachowski (1951) : « Parties ouïes, faisant droit à la requête des habitants de Villenoxe, admonestons les chenilles de se retirer dans six jours ou à défaut de ce faire, les déclarons maudites et excommuniées ! » (cité dans [1]p. 9). En même temps, et sûrement par sécurité, chaque fois que nécessaire, ils mettaient en œuvre des méthodes palliatives ou intervenaient physiquement. La protection des cultures recoupe alors l’adage : « Aide-toi, le Ciel t’aidera ».

Le travail des hommes
Pour les maladies, il n’y avait pas d’autres solutions que le recours à la religion, faute de connaissances. La pathologie végétale et les microorganismes responsables de ces dégâts restaient à découvrir. En revanche, les insectes étaient visibles et leurs dégâts directement reliés à leurs pullulations. Rappelons que, de tout temps, la concentration de nourriture facilement accessible a naturellement attiré la convoitise d’organismes qui viennent prélever leur écot : rongeurs, oiseaux, criquets. Ainsi, les pullulations de ravageurs ne sont pas la caractéristique propre d’une agro-industrie « intensive ». Ces ravageurs sont mentionnés depuis les premiers âges de l’agriculture. Les agriculteurs ont donc rapidement compris qu’en ramassant « les chenilles et autres sauteriaux » et en les détruisant, on pouvait arrêter les dégâts causés aux récoltes. La destruction des chenilles, ou échenillage, fut une des grandes idées du XVIIIe siècle, appliquée à toutes sortes de chenilles parmi lesquelles on ne faisait guère de différence.
Depuis toujours, et selon les régions, les cultures étaient frappées par les « chenilles ». La première loi phytosanitaire fut, en France, celle du 26 ventôse an IV (16 mars 1796) « prescrivant l’échenillage obligatoire. » Malheureusement, cette loi fut inappliquée parce qu’inapplicable. En effet, enlever et détruire à la main les nids de chenilles perchés dans les arbres s’avère très fastidieux et assez peu efficace. On peut en juger, par analogie avec les nids de processionnaires du pin dont la destruction, malgré les moyens actuels, reste difficile et sans grand effet. À la suite de l’invasion du doryphore en France, l’idée fut reprise après 1922 pour juguler les dégâts sur les cultures de pommes de terre, et le ramassage de ces insectes était explicitement recommandé : « Le ramassage constitue à lui seul un système d’extinction… C’est une opération à la portée de tout le monde. Les femmes, les enfants peuvent y prendre part aussi bien sinon mieux que les hommes. Ayant moins à se baisser, étant plus souples et souvent plus observateurs, les enfants sont tout désignés pour y réussir. Aussi rien ne vaut une équipe d’écoliers… » ([2]p. 66). Jusqu’en 1944, les classes d’enfants furent ainsi réquisitionnées une demi-journée par semaine pendant les périodes de multiplication des doryphores pour ramasser les insectes à la main, sous la houlette de leur instituteur.
Il en fut de même des hannetons, dont les spécimens adultes étaient ramassés par centaines de milliers lors de campagnes villageoises. Concernant la pyrale, principal ravageur des vignes françaises, le baron Charles Walkenaer, préfet, entomologiste, géographe érudit, exposait en 1835, devant la Société entomologique de France, que le procédé le plus sûr et le plus efficace pour la combattre était la cueillette des feuilles au moment où elles renferment les pontes, les chenilles ou les chrysalides. La même année, le préfet du Rhône prescrivit l’enlèvement méthodique des pontes et un orateur s’écria dans un banquet en 1841 : « La pyrale est vaincue ! » En vérité, ce procédé assez coûteux ne donnait que des résultats très incomplets.
Tout comme la protection des cultures contre les insectes, la lutte contre les mauvaises herbes reposait elle aussi sur une main-d’œuvre abondante. Pratiquée dans des conditions difficiles, y compris sous la pluie ou le vent, dans des postures souvent courbées ou accroupies, voire à genoux au sol, elle occupait une bonne partie de la famille, femmes et enfants compris. Binages et sarclages font de l’agriculture « la plus pénible des industries » [3], loin de l’image idyllique que chantaient les « poètes qui célèbrent d’une même voix les plaisirs des travaux champêtres et les vertus des ruraux » [4].
Des armées de paysans, hommes, femmes et enfants, binent, sarclent, arrachent, coupent herbes et épines dans les céréales, les vignes, le lin, les légumes et bien d’autres cultures, tout cela pour faire taire le dicton : « les mauvaises herbes sont de la famille des mauvais agriculteurs » [5].
Pour ces travaux, un ouvrier peut sarcler en une journée 500 à 800 m² si l’enherbement n’est pas trop abondant, et 400 m² en cas d’herbes abondantes [6]. Au XIXe siècle, la durée d’une journée de travail n’est pas vraiment réglementée et varie de 8 heures à 16 heures selon l’urgence des travaux à exécuter et la durée du jour. Elle est plus longue pour les domestiques attachés à la ferme que pour les journaliers. Les domestiques doivent en effet se lever de bonne heure pour donner les soins aux animaux. Pour combattre les mauvaises herbes, les paysans utilisent des outils rudimentaires comme des couteaux allongés pour couper les herbes ou des tenailles en bois pour les arracher. Ce sont en majorité les femmes et les enfants qui se livrent à ce travail. Comme le rapporte P. Joigneaux, sénateur de la IIIe République et passionné d’agriculture : « Il va sans dire qu’on ne réussit pas à les détruire toutes mais c’est beaucoup déjà de les tourmenter ou de les empêcher de fleurir » [7].
Dans les cultures de lin, c’est à main nue que le désherbage se pratique. Là aussi, ce travail est généralement confié à des femmes et des enfants. Il est exécuté lorsque le lin atteint 4 ou 5 cm de haut. « Pour ne pas trop châtier la jeune plante, les ouvrières se débarrassent de leurs chaussures, s’agenouillent et enlèvent à la main toutes les mauvaises herbes. Si ce premier travail n’est pas suffisant on recommence l’opération au bout de 3 ou 4 semaines » [8].
Au début du XXe siècle, les jeunes paysans désireux de fonder un foyer ne trouvent pas de femmes qui consentent à accepter l’existence écrasante de la ferme partagée entre les travaux du ménage, de la cour et des champs. Les jeunes filles voient leurs parents prématurément vieillis et déformés par leur rude besogne. Les médecins ont un mot pour décrire cette déformation de la colonne vertébrale (cyphose) typiquement agricole : la plicature champêtre [9].
Ces travaux harassants vont décourager les enfants de suivre la même voie que leurs parents. L’industrie de la fin du XIXe siècle les séduit en proposant des conditions de labeur moins pénibles et un salaire fixe. Parallèlement, la terrible saignée que la Première Guerre mondiale inflige au monde paysan accentue encore le dépeuplement des campagnes.
Par ailleurs, en rendant l’école obligatoire, la Nation a permis à des générations d’enfants d’échapper aux travaux des champs. C’est l’École qui a comblé les vœux des agriculteurs tels que rapportés par Michelet en 1846 : « Le cultivateur, cet homme si avisé, si sage, a pourtant une idée fixe : c’est que son fils ne soit pas paysan » [10].

La science pour pallier le manque de main-d’œuvre
Mais cet exode rural que connaissent nos campagnes et toute la planète n’a pas fait disparaître les attaques d’insectes ravageurs, les maladies ni les mauvaises herbes. On considère que sans protection des cultures, c’est environ 40 % de la production agricole mondiale qui disparaîtrait [11]. Les techniques de protection des cultures, contrairement à une idée reçue, ont d’abord été le fruit d’observations des paysans. Elles ont été par la suite expliquées, améliorées par des entomologistes, des botanistes, des microbiologistes et des chimistes.
De longue date, les cultivateurs ont essayé des substances souvent issues de la pharmacopée humaine pour limiter les dégâts des ennemis des cultures : poudre de pyrèthres, jus de tabac (nicotine) contre les insectes, mélange de persicaire âcre et d’ail contre les charançons des grains, soufre… Au château Ducru-Beaucaillou, dans les années 1880, le régisseur Ernest David appliquait sur ses vignes du vert-de-gris (acétate basique de cuivre) ou du sulfate de cuivre pour éviter le grappillage de ses raisins par les maraudeurs. Cette habitude permit la découverte du rôle fongicide du cuivre contre le mildiou de la vigne. La formule améliorée par le chimiste Ulysse Gayon fut présentée par le botaniste Alexis Millardet en 1885 : la bouillie bordelaise était née. Elle fait encore aujourd’hui partie des solutions fongicides sur de nombreuses cultures, notamment en agriculture biologique.
Le désherbage des cultures a d’abord bénéficié des apports du machinisme. Les hommes ont été aidés par des machines tractées : bineuses, sarcleuses, houes, rasettes. Mais en 1896, Louis Bonnet, un viticulteur de Murigny (aujourd’hui, un quartier de Reims), fait une observation capitale aux retombées mondiales. Ayant observé plusieurs années de suite qu’en sulfatant ses vignes, les sanves et les ravenelles, des plantes nuisibles « dont la levée considérable dans certaines cultures… cause parfois de grands dommages », se desséchaient, et souhaitant détruire les sanves dans ses champs d’avoine, il expérimenta différentes doses et finit par obtenir de bons résultats avec une solution acide à 6 %. Louis Bonnet fit une communication au comice agricole de Reims : « Je fis l’application de cette solution à 6 % sur toute la surface et, au bout de trois jours, mon avoine débarrassée de l’ivraie se développa rapidement, ce qui me permit de faire une récolte satisfaisante ». L’idée du désherbage chimique des cultures était née. On sait aujourd’hui l’importance de cette technique dans le monde entier où le chiffre d’affaires du désherbage à l’aide de produits de synthèse dépasse les vingt milliards d’euros.
La méthode décrite par Louis Bonnet a été précisée et vulgarisée par Edmond Rabate, alors professeur départemental d’agriculture. Elle consiste à verser dix litres d’acide sulfurique dans 200 litres d’eau. C’est environ 120 litres d’acide sulfurique par hectare de céréales qui sont ainsi pulvérisés. Entre les deux guerres, cette utilisation d’acide va être généralisée sur les céréales françaises qui recevront chaque année environ 200 000 tonnes d’acide sulfurique ! Parallèlement, le machinisme agricole va développer des appareils de pulvérisation adaptés. Les paysans qui, à l’époque, n’ont pas de meilleures solutions pour éviter les pertes liées aux mauvaises herbes sur leurs blés, orges, avoines et seigles, vont massivement utiliser l’acide sulfurique. Les conditions de travail sont décrites dans la chanson du blé de J. Engelhard en 1937 : « Puis leur pulvérisation, au pas lourd d’un cheval haletant, projette en une pluie fine le liquide corrosif délicatement comme s’il s’agissait d’un parfum… Les hommes peinent à ce martyre. L’acide ronge les mains de profondes crevasses, brûle les yeux, fait virer au rouge les vieux vêtements bleus qui tombent en lambeaux. Le cuir des chaussures lui-même ne résiste pas à cette morsure. Et sur la croupe des chevaux, on étend de vieux sacs, comme des carapaçons de fer afin qu’ils soient protégés. On dirait un tournoi de chevaliers maudits… » [12].
Depuis, la chimie a fait de nombreux progrès pour la protection des cultures. La chimie minérale et les solutions à base d’acides, d’arsenic, de plomb sont progressivement abandonnées au profit de la chimie organique. Dès la fin des années 1930, les scientifiques se sont alarmés des risques que la manipulation de tels produits faisait courir aux agriculteurs et leurs proches.
En 1934, une « commission chargée d’étudier l’emploi des toxiques » est mise en place par le ministre de l’Agriculture, Henri Queuille. La première réglementation d’homologation fut adoptée en 1943. Le décret-loi du 2 novembre 1943 prévoit un contrôle des antiseptiques, fongicides, herbicides et de tous les produits concernant la destruction des vertébrés et invertébrés. Ce texte a pour principal objectif de protéger les agriculteurs des abus industriels en n’autorisant que les substances véritablement dotées d’une action efficace et de contrôler la composition des produits. Dès 1946, la commission mise en place par H. Queuille s’attache à étudier la toxicité des produits vis-à-vis de l’Homme et des animaux utiles. La toxicologie va dès lors connaître d’importants progrès. Dans les années 1970, notamment pour donner suite à la publication en 1962 de Silent spring (Le printemps silencieux), le livre de Rachel Carson, il devient nécessaire de mieux évaluer les effets sur l’environnement. Cette évolution sera formalisée dans l’adaptation de la loi d’homologation en 1972. Bernard Pons, alors secrétaire d’État à l’Agriculture, déclare : « L’esprit de la loi de 1943 visait essentiellement à protéger l’agriculteur. Et la modification qui vous est proposée aujourd’hui conserve, faut-il le dire, cette préoccupation. Mais une autre préoccupation retient en outre l’attention du législateur, celle de lutter contre la pollution, et notamment contre l’apparition de résidus chimiques dans les aliments et les eaux, ou contre les atteintes qui pourraient être portées à l’environnement par la destruction de la faune et de la flore. »
Sans cesse améliorées par les nouvelles connaissances et les nouvelles technologies, la toxicologie et l’écotoxicologie sont devenues des sciences à part entière. En toute logique, l’Union européenne s’est appuyée sur les lois nationales pour harmoniser cette réglementation à l’échelon communautaire pour les substances actives. La mise en marché des produits phytosanitaires est régie par le règlement n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Cet échelon est ensuite complété par une évaluation nationale pour les produits formulés.
Les progrès des connaissances et de la science expliquent que cette réglementation soit souvent remise en cause quant à la pertinence de telle ou telle étude. Dans le passé, ces évolutions ont conduit à des retraits de molécules (DDT, chlordécone, lindane) au regard de nouvelles connaissances ou de nouvelles exigences. C’est ainsi que l’atrazine, herbicide largement utilisé sur le maïs et pour le désherbage des voies ferrées, a été retiré dans l’Union européenne. Bien que sans risque sanitaire, sa détection dans les eaux de surface au-dessus du seuil de 0,1 µg/l a conduit à son retrait. Les États-Unis ou le Canada, plus permissifs, tolèrent respectivement 3 µg/l ou 5 µg/l, soit 30 à 50 fois plus. Ils se basent sur les seuils sanitaires de l’OMS. On le voit, le processus d’autorisation européen est l’un des plus stricts au monde, apportant une garantie au consommateur, à l’utilisateur, à la préservation de l’environnement. En ne retenant que les substances les mieux connues, il a aussi conduit à la réduction de leur nombre, passant d’un millier à environ 400. Ce processus fait référence dans de nombreux pays hors Europe. Il permet aussi un niveau de production agricole en quantité, répondant à une population toujours en croissance et en qualité, avec un taux d’aliments respectant les normes sanitaires dans l’alimentation avoisinant les 97 %.
C’était mieux avant ?
La protection des cultures reste une préoccupation majeure des agriculteurs. Elle l’a toujours été. Après les incantations diverses, les méthodes empiriques, elle est devenue scientifique. Elle doit pouvoir continuer à bénéficier des découvertes scientifiques et à suivre une trajectoire de progrès, au même titre que toutes les autres techniques. Ces progrès initiés depuis une centaine d’années s’appuient sur des sciences complémentaires : la physiologie végétale, la pathologie, l’entomologie, la botanique mais aussi la génétique, l’écologie, l’intelligence artificielle. Ce progrès est attendu par les agriculteurs du monde entier, confrontés chaque année aux ennemis des cultures. Ces derniers s’adaptent aux changements des systèmes culturaux, du climat, mais sont aussi confrontés à l’accélération des échanges commerciaux qui favorisent l’arrivée d’espèces invasives, remettant en cause les productions, comme c’est le cas par exemple pour la production de cerises qui fait face à une mouche d’origine asiatique (Drosophila suzukii) contre laquelle les producteurs sont démunis. Dans ce contexte, le retour en arrière auquel aspirent certains « qui souhaitent des coquelicots » fait appel à un passé fantasmé et revient à oublier l’histoire douloureuse de la protection des plantes cultivées et l’époque encore récente où la France n’était pas autosuffisante pour son alimentation.
Benoît Raclet, un sauveur de la vigne
Nos malheureux aïeux, qui ont connu tant de misères et de famines, qui viennent, à cette époque, de subir successivement la Révolution, la conscription, les batailles et l’occupation autrichienne, sont découragés par le fléau. Beaucoup abandonnent le pays. Le pain, même le pain noir, se cache. On boit de l’eau, ou quelque « rapé » souvent à moitié tourné, fait de « peloces » ou de « gratteculs », de sorbes que les « petits cadets » aux pieds nus cueillent dans les buissons. Les filles vont en condition. Les garçons se louent dans les pays de blé, jusque dans les Dombes marécageuses qui sont devenues le « bon pays ».
Devant l’impuissance des moyens de défense et l’inutilité de l’effort, les derniers vignerons parlent de jeter la pioche, d’arracher et de brûler les vieux ceps vaincus par le ver. Les pentes sacrées de Thorins ou de Chénas, au sol de grès effrité, qui s’accommodent si bien du fin sarment, vont-elles donc, comme au Moyen Âge, se recouvrir de seigle, ce frère inférieur du blé ?
Vous pensez bien qu’on ne se décida pas facilement à l’abandon de la vigne, de la pauvre vigne ancestrale, objet de tant d’attention et d’affection.
Tous les moyens, tous les remèdes, tous les procédés furent employés. Les inventeurs, les donneurs de conseils, officiels ou non, savants ou sorciers, ne manquèrent pas. Les expériences multiples, curieuses, plus ou moins secrètes, se poursuivirent avec des alternatives d’espoir et de découragement, parallèlement avec les manifestations de la piété.
Léon Foillard, Un sauveur de la vigne,
Benoît Raclet, Guillermet, 1934.
1 Regnault-Roger C, Produits de Protection des Plantes : Innovation et sécurité pour une agriculture durable, Lavoisier, 2014.
2 Feytaud J, Comment le Doryphore envahit l’Europe, Bordeaux : Société de zoologie agricole, 1936.
3 Leneveux HC, Le travail manuel en France, Germer, Baillière et Cie, entre 1881 et 1884.
4 Pitié J, L’homme et son espace : exode rural et migrations intérieures en France du XVIe siècle à nos jours, Éditions du CNRS, 1987.
5 Menault E, Rousseau H, Les plantes nuisibles en agriculture, Doin, 1902.
6 Silvestre C, Agenda des agriculteurs et des syndicats agricoles, Édition de Bureau, 1902.
7 Joigneaux P, Le livre de la ferme et des maisons de campagne, Masson et Delagrave, 1863.
8 Fritsch J, Culture des plantes oléagineuses et textiles, ed. Lucien Laveur, 1908.
9 Braibant M, L’agriculture française : son tragique déclin, son avenir, Armand Colin, 1936.
10 Maspetiol R, L’ordre éternel des champs. Essai sur l’histoire, l’économie et les valeurs de la paysannerie, Librairie de Médicis, 1946.
11 Oerke JC, “Crop losses to pests”, Journal of agricultural science, 2006, 144 :31-43.
12 Engelhard J., La chanson du blé, Horizons de France, 1937.
Pour en savoir plus
Bain C, Bernard JL, Fougeroux A, Histoire de la protection des cultures, Editions Champ libre Groupe France Agricole, 2010.
Balachowsky AS, La lutte contre les insectes, Payot, 1951.
Bernard JL, « Naissance de la protection des cultures : les agronomes de l’antiquité gréco-latine », Phytoma, 1988, 402 :18-23.
Regnault-Roger C, Fougeroux A, Santé du végétal : 100 ans déjà !, Presses des Mines, 2018.
Publié dans le n° 328 de la revue
Partager cet article
L' auteur

André Fougeroux
Membre correspondant de l’Académie d’Agriculture de France, président de la commission « ravageurs et auxiliaires » (…)
Plus d'informationsAgriculture
Thèmes connexes : Agriculture et alimentation bio, Alimentation
De l’agriculture de subsistance à la productivité
Le 18 juillet 2012
L’agriculture du Lauragais au milieu du XIXe siècle
Le 12 janvier 2022
Toxicocinétique et glyphosate
Le 13 avril 2021
Et si les plantes n’étaient pas aussi sourdes que leurs pots ?
Le 26 septembre 2019Communiqués de l'AFIS














![[Lyon - Mercredi 28 février 2024 à 20H30] Soirée Ciné-Café : Au pays de l'abeille noire](local/cache-gd2/41/504edd6b853ac09a87f1c6b0378d64.png?1707108191)
![[Paris – Mercredi 19 février 2020] La santé des végétaux : hier, aujourd'hui et demain](local/cache-gd2/ca/eab08e30987d14a14001908dcca94a.jpg?1675293099)