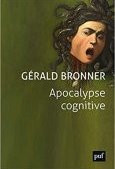Amitiés
Publié en ligne le 5 avril 2024Robin Dunbar
Markus Haller, 2023, 456 pages, 28 €

Les relations sociales influencent notre bien-être psychique et notre santé. Dans une vaste enquête qui permit de suivre la trajectoire de 1 132 familles entre 1947 et 1962, James Spence, professeur à Newcastle, a montré que les enfants ayant des interactions fréquentes avec leurs apparentés étaient moins victimes de maladies respiratoires [1]. Parmi les explications de ce lien entre santé physique et relations sociales figurent les mécanismes d’entraide entre proches, qui facilitent le rétablissement en cas de maladie, mais également le relâchement d’endorphine au contact des proches. Ce neurotransmetteur sécrété par notre cerveau diminue la douleur, augmente le bien-être et renforce notre système immunitaire [2]. À l’inverse, la solitude est associée à une concentration [3] accrue de fibrinogène dans le sang, entraînant une coagulation excessive et donc des risques de thrombose et d’AVC.
L’importance des relations sociales pour une bonne santé mentale et physique mérite que l’on comprenne leur fonctionnement. Existe-t-il un nombre limité d’amitiés que les humains peuvent entretenir ? Le cas échéant, qu’est-ce qui, dans la nature humaine, explique ces limites ? Et résistent-elles à l’avènement des réseaux sociaux ? C’est à ces questions que Robin Dunbar, directeur du groupe de recherche sur les neurosciences sociales et évolutionnaires du département de Psychologie Expérimentale d’Oxford, répond dans cet ouvrage, mobilisant neurosciences et primatologie pour comprendre l’origin(alité) des relations humaines.
Quelle est l’architecture de nos relations amicales ?
Dunbar a donné son nom au « nombre de Dunbar » dans les années 1990 ; une théorie qui met au jour une limite numéraire au nombre d’amis que les humains peuvent entretenir. S’appuyant sur des exemples variés – nombre de cartes de vœux envoyées dans les années 1980, taille moyenne des villes anglaises décrites par Guillaume le Conquérant en 1086 – Dunbar montre que les individus comptent en moyenne 150 amis (toute personne sur laquelle repose un sentiment d’obligation et un échange de faveurs – famille inclue). Ce nombre varie selon la personnalité, l’âge et le genre – les jeunes, les extravertis et les femmes en ont davantage – mais reste étonnamment stable dans des contextes variés. Cette stabilité s’est confirmée en dépit de l’avènement des réseaux sociaux : les usagers réguliers des réseaux sociaux n’ont pas plus de « vrais » amis qu’une population contrôle [4]. Internet n’a donc pas brisé la limite au nombre d’amis que les humains entretiennent.
Dunbar le souligne, bien que timidement : la contrainte qui agit sur la taille des communautés humaines est aussi bien cognitive que sociale. Il mentionne qu’une communauté composée de 150 individus permet un contrôle social par les pairs, sans une autorité chargée de faire respecter la loi. Autrement dit, la taille des communautés humaines dépend également du type d’institutions politiques en place, de la géographie (plaine, montagne), des facteurs assez peu explorés dans le livre de Dunbar, qui se penche davantage sur les explications biologiques à la taille limitée des groupes humains [5].
Enfin, chez les humains et d’autres primates non-humains, les réseaux sont organisés en strates : dans la première se trouve les individus très proches, et le degré de proximité émotionnelle diminue lorsqu’on s’éloigne du premier groupe. Là encore, Dunbar a constaté une récurrence numéraire : la strate n+1 est généralement composé de trois fois plus d’individus que la strate n, et les premières sont en général respectivement de cinq et quinze amis – une régularité que l’on retrouve même chez les usagers réguliers des réseaux sociaux.
Les fondements bio-cognitifs de la structure des relations humaines
Comment expliquer cette récurrence du nombre moyen de relations sociales entretenues chez les humains ? Pour répondre à cette question, Dunbar propose une perspective comparative. Parmi les primates, la taille moyenne du groupe est corrélée à la taille relative du néocortex (par rapport au reste du cerveau) : c’est « l’hypothèse du cerveau social ». On observe cette corrélation en comparant plusieurs espèces contemporaines, mais également en fouillant dans les traces de l’histoire évolutive des primates : systématiquement, une augmentation de la taille du groupe a coévolué avec une augmentation de la taille relative du néocortex. La vie en groupe procure des avantages pour se reproduire, se nourrir et se protéger des prédateurs, ce qui explique la pression de sélection à faire émerger des capacités cognitives sophistiquées favorisant la vie en groupe. Avoir des amis demande bien sûr du temps, mais surtout un ensemble de compétences cognitives et d’aptitudes complexes : capacité à exprimer ses émotions et à lire celles d’autrui pour pouvoir lui apporter du soutien, comprendre ses attentes et assurer des interactions fluides – ce que les psychologues nomment « théorie de l’esprit ». Par ailleurs, la vie commune nécessite d’inhiber ses désirs pour prendre en compte ceux d’autrui. Ce sont ces deux facultés – théorie de l’esprit et inhibition – qui sous-tendent les relations sociales complexes, et apportent une explication à l’hypothèse du cerveau social. Socialité et cerveau sont intimement liés.
À la différence des grands singes, pour qui les relations sociales passent essentiellement par l’épouillage et le contact physique, les humains ont la capacité de nouer des relations avec plusieurs dizaines de congénères, et via une diversité de pratiques. La musique, la danse, le chant et le sport sont autant d’activités sociales qui permettent aux humains de nouer des relations avec un nombre étendu d’individus, et qui sont communes à toutes les sociétés humaines. D’où vient cette capacité des humains à coopérer avec un large nombre d’individus ?
Sur le plan cognitif, réaliser une action coordonnée avec quelqu’un – comme pagayer sur un aviron – nous fait sécréter de l’endorphine (mesurée via la tolérance à la douleur) et augmente le sentiment de proximité des personnes qui partagent la même expérience. D’après Dunbar, la sécrétion d’endorphine lors d’activités synchronisées aurait évolué pour stabiliser la coopération de larges groupes sociaux, typique de notre espèce.
Ce même raisonnement évolutionnaire peut être appliqué au langage qui, pour Dunbar, a une fonction sociale. Selon lui, et d’autres théoriciens évolutionnaires du langage comme Steven Pinker [6], le langage a évolué pour coder des informations propositionnelles (telles que qui a fait quoi à qui, quand, où et pourquoi) dans le but d’échanger des informations sociales, nécessaires pour maintenir le lien entre individus qui n’ont pas de contact physique régulier. La taille étendue des groupes humains aurait rendu avantageux l’échange d’informations complexes sur nos compères pour maintenir un lien social via le commérage [7]. Pour d’autres, l’évolution du langage vers des formes toujours plus complexes n’est pas une adaptation biologique mais une conséquence de la transmission culturelle de celui-ci. Des modélisations de la transmission d’informations sur plusieurs générations suggèrent en effet que celles-ci se complexifient à mesure que les chaînes de transmission s’accroissent [8]. Quoi qu’en soit son origine, le langage est souvent utilisé à des fins sociales. Dans leur grande majorité, les sujets de conversation concernent d’autres individus et servent à s’informer sur le monde social. Autre preuve de la fonction sociale du langage, face à un récit, nous mémorisons davantage les intentions des individus à commettre une action plutôt que l’action en elle-même. Ce qui, d’après lui, n’est pas sans poser problème lorsqu’un individu témoigne lors d’un procès…
En amour comme en amitié, les humains suivent la règle du « qui se ressemble s’assemble ». Nous sommes statistiquement attirés par les individus qui partagent nos traits de personnalité, notre langue, notre ethnie et notre culture, un phénomène d’homophilie bien connu des sociologues. Dans des expériences psychologiques, la vue d’un être aimé – notre enfant, notre partenaire, ou plus surprenant, une figure religieuse – neutralise nos capacités critiques [9]. L’activité du cortex préfrontal, impliqué dans la pensée consciente et les jugements, est en effet inhibée lorsque les participants sont exposés à une photo d’un être aimé. Autrement dit, l’amour met le voile sur les défauts de l’autre, et Dunbar de conclure : « l’amour, comme l’amitié, résultent de notre mise en veilleuse délibérée de la réalité. »
Dunbar poursuit sur les différences entre femmes et hommes dans les styles de relations : les femmes ont des relations plus dyadiques (comprenant deux personnes) tandis que les hommes ont une sociabilité de groupe, comme le révèle une analyse des personnes présentes sur les photos de profil des réseaux sociaux [10]. En outre, les relations masculines s’établissent autour d’activités partagées, et celles des femmes autour des discussions. Dunbar nuance toutefois certains préjugés des différences de genre en soulignant que les femmes peuvent être aussi agressives que les hommes, mais de manière différente : elles répondent à la menace par la violence psychologique (commérage, exclusion du groupe, insultes) plus que physique [11]. Autre fait surprenant, la coopération entre femmes est davantage dégradée lorsqu’elles s’affrontent dans un jeu que celle des hommes. Pour l’évolutionniste, cette différence serait due à la plus grande nécessité pour les hommes de former une coalition en vue de se défendre dans l’environnement ancestral.
Les explications socio-culturelles ignorées et le risque de la naturalisation
On regrette toutefois l’absence de nuances lorsque Dunbar vient à expliquer les différences entre les sexes. Les hommes souriraient moins que les femmes en raison d’un dimorphisme de la mâchoire, leur voix moins aiguë les rendrait moins aptes à consoler les enfants. Les différences comportementales entre femmes et hommes ont toutes une origine biologique et évolutionnaire, et aucune place n’est réservée à des explications sociologiques (par exemple l’éducation donnée aux filles qui les incite à être plus aimables et empathiques).
Pourtant, les travaux récents en anthropologie évolutionnaire reviennent sur certains présupposés que Dunbar reprend à son compte. Par exemple, alors qu’on a longtemps considéré que les hommes étaient plus compétitifs et coopératifs. Compétitifs car ce sont les femmes qui choisissent leur partenaire. Coopératifs, car c’est une condition aux alliances masculines dans le cas de conflits guerriers, et en raison de la cohabitation plus fréquente d’hommes apparentés que de femmes apparentées, legs de la patrilocalité ancestrale (résidence du couple dans la famille du mari), et qui favorise les alliances masculines. Or, les études récentes montrent qu’il n’existe pas de type de résidence post-maritale déterminé chez les humains : celui-ci varie en fonction des périodes de la vie [12]. Les jeunes couples résident davantage dans la famille maternelle, probablement pour aider aux soins des enfants, et migrent par la suite. Les études ethnographiques regorgent d’exemples de coopération féminine qu’on aurait aimé lire sous la plume de Dunbar : la constitution de bandes de cueilleuses dès le plus jeune âge chez les Savannag Pumé du Venezuela, qui conservent un lien étroit toute leur vie, la coopération pour gérer les feux de camp ou la capture des poissons en Alaska, les systèmes d’alliance entre des femmes éloignées géographiquement chez les !Kung pour s’assurer en cas de pénurie (hxaro partners) [13].
Les études de Dunbar sont majoritairement réalisées dans des pays occidentaux ou industrialisés. Or, tous partagent une culture commune de religion monothéiste qui cantonne la femme à son rôle reproducteur de mère [14], d’agriculture intensive qui limite l’activité productive des femmes [15], ou encore des normes familiales patrilinéaires ou patrilocales qui restreignent son autonomie. Chez les Mosuo matrilinéaires de Chine, un des rares exemples de société qui échappe à la culture dominante mentionnée plus haut, les femmes ont un réseau social plus grand que les hommes [16], ce qui dément l’universalité supposée du « relations intimes entre femmes vs relations de bande entre hommes ». Les quelques exemples ci-dessus montrent que dans des sociétés où le périmètre des femmes s’étend au-delà de la sphère domestique, les relations entre femmes ne se limitent pas au soutien émotionnel mais incluent une collaboration économique et atténuent les différences de genre.
1 | Spence J, One Thousand Families in Newcastle, Oxford University Press, 1954.
2 | Jain A et al., “Beta endorphins : the natural opioids”, International Journal of Chemical Studies, 2019, 7 :323-32.
3 | Kim DA et al., “Social connectedness is associated with fibrinogen level in a human social network”, Proceedings of the Royal Society, 2016, 283 :20160958.
4 | Dunbar RI, “Do online social media cut through the constraints that limit the size of offline social networks ?”, Royal Society Open Science, 2016, 3 :150292.
5 | Brown P, Podolefsky A, “Population density, agricultural intensity, land tenure, and group size in the New Guinea highlands”, Ethnology, 1976, 15 :211-38.
6 | Pinker S, “Language as an adaptation to the cognitive niche”, Studies in the Evolution of Language, 2003, 3 :16-37.
7 | Dunbar RI, “Gossip in evolutionary perspective”, Review of general psychology, 2004, 8 :100-10.
8 | Christiansen MH, Kirby S, “Language evolution : consensus and controversies”, Trends in cognitive sciences, 2003, 7 :300-7.
9 | Acevedo BP et al., “Neural correlates of long-term intense romantic love”, Social cognitive and affective neuroscience, 2012, 7 :145-59.
10 | David-Barrett T et al., “Women favour dyadic relationships, but men prefer clubs : cross-cultural evidence from social networking”, PloS ONE, 2015, 10 :e0118329.
11 | Campbell A, “The evolutionary psychology of women’s aggression”, Philosophical Transactions of the Royal Society B : Biological Sciences, 2013, 368 :20130078.
12 | Kramer KL, Greaves RD, “Postmarital residence and bilateral kin associations among hunter-gatherers : Pumé foragers living in the best of both worlds”, Human Nature, 2011, 22 :41-63.
13 | Kramer KL, “Female cooperation : evolutionary, cross-cultural and ethnographic evidence”, Philosophical Transactions of the Royal Society B, 2023, 378 :20210425.
14 | Gilmore DD, Misogyny : the male malady, University of Pennsylvania Press, 2010.
15 | Alesina A et al., “On the origins of gender roles : Women and the plough”, The Quarterly Journal of Economics, 2013, 128 :469-530.
16 | Mattison SM et al., “Gender differences in social networks based on prevailing kinship norms in the Mosuo of China”, Social Sciences, 2021, 10 :253.
Publié dans le n° 348 de la revue
Partager cet article
Auteur de la note
Sociologie

Les Français et la science, une relation ambivalente
Le 11 mai 2023