Le rôle de l’épidémiologie dans la controverse « environnement et cancer »
Publié en ligne le 1er septembre 2009 - Causes de cancer -Sur le site du Centre International de Recherche sur le Cancer 1 (CIRC), on peut lire que la stratégie de recherche du centre est fondée sur l’idée largement acceptée que 80 % des cancers sont directement ou indirectement liés à l’environnement ; mal interprétée, par ignorance ou à des fins tendancieuses, cette « mise en accusation » de l’environnement a fourni des arguments à ceux qui pensent que sa modification récente est la cause principale des cancers qu’on observe aujourd’hui. D’où vient cette affirmation rapportée par une organisation internationale qui a autorité pour le faire, et que veut-elle dire ? Constatons, avant toute réponse, que c’est une bonne nouvelle, car si c’est l’environnement qui est en cause, cela implique que la prévention est possible ; mais c’est aussi un défi pour la communauté scientifique car cela n’implique pas que l’on connaisse les éléments de l’environnement responsables de la survenue de la maladie, et donc qu’on connaisse la cause de 80 % des cancers, ce qui permettrait en principe de les prévenir.
Rappelons ici, pour éviter tout malentendu, que l’environnement désigne non seulement l’ambiance chimique et biologique dans laquelle nous vivons mais aussi le milieu social et culturel, le cadre et le style de vie. Dans ce sens l’environnement s’oppose à la prédisposition génétique qui rend l’être humain plus ou moins susceptible de contracter une maladie ou plus ou moins apte à s’en défendre. Il est important de noter aussi que certains facteurs génétiques sont précisément des défauts congénitaux dans la capacité de réparer les agressions de l’environnement.
L’affirmation du CIRC n’est pas seulement fondée sur la découverte de facteurs de risque de l’environnement, mais est principalement le résultat de l’observation épidémiologique de la grande variabilité géographique de l’incidence 2 du cancer. En effet, celle-ci ne peut être expliquée par les différences de patrimoine génétique des populations, comme le montrent les études de migrants, qui acquièrent très vite l’incidence du pays d’accueil, et l’évolution chronologique de l’incidence du cancer qui montre de fortes croissances ou décroissances de l’incidence de certaines localisations de cancer dans des populations de patrimoine génétique approximativement constant. L’acceptation de ces idées a conduit les épidémiologistes de la deuxième moitié du 20e siècle à entreprendre des études qui devraient permettre une prévention efficace.
Environnement et cancer : quels sont les faits ?
Quelques exemples peuvent nous aider à comprendre l’importance de cette voie de recherche. Dans les années 1950, la croissance extraordinaire du cancer du poumon n’était pas comprise, mais le monde médical était persuadé qu’un facteur de l’environnement était en cause. Dans un article paru en 1950, Richard Doll écrivait : « deux causes principales [de l’augmentation] peuvent être mises en avant : (1) une pollution atmosphérique globale résultant des gaz d’échappement, des poussières des surfaces goudronnées et des gaz s’échappant des sites industriels et des centrales à charbon ; et (2) le tabagisme… ». C’était l’une des premières études qui mettait en cause le tabac 3. Mais c’est seulement lorsque des études de cohorte sur le sujet, dont celle des médecins britanniques du même auteur, ont été publiées que la majorité des scientifiques ont été convaincus que l’accroissement du cancer du poumon avait pour cause le tabagisme grandissant dans le monde entier. Les derniers résultats publiés sur la cohorte des médecins britanniques montrent que les fumeurs réguliers ont une espérance de vie 44 inférieure de 10 années à celle des non-fumeurs, et que la survie à 70 ans des fumeurs de plus de 25 cigarettes quotidiennes est de 50 %, alors qu’elle est de 80 % chez les non-fumeurs 5. En dépit de ces observations, il y a toujours des fumeurs et, parmi eux, des personnes qui craignent d’avoir été contaminées par les retombées de Tchernobyl ou qui pensent que les champs électromagnétiques de basse fréquence sont cancérogènes.
Le tabagisme en France reste important : en particulier les jeunes femmes françaises ont vu leur taux de mortalité par cancer du poumon multiplié par 4 entre 1985 et 2000, ce qui annonce un nombre très élevé de cancers du poumon pour ces générations, si rien n’est fait pour les prévenir. Ainsi, même lorsque la cause est identifiée, la prévention reste une entreprise difficile.

De la même façon, l’épidémiologie a démontré le rôle de l’alcool dans les cancers des voies aéro-digestives supérieures, le rôle de l’exposition au soleil dans le mélanome 6, le rôle du virus des hépatites B et C dans la survenue du cancer du foie 7 et celui du papillome dans le cancer du col de l’utérus. En revanche, la décroissance spectaculaire et continue de l’incidence du cancer de l’estomac est l’objet d’hypothèses assez probables, mais est le résultat d’une évolution favorable et imprévue de l’environnement qui n’est pas complètement expliquée.
Une démarche épidémiologique bien conduite a ainsi été à l’origine d’importants succès dans la mise en évidence effective du rôle de l’environnement dans la survenue de nombreux cancers et dans l’identification de facteurs de risque dont le contrôle devrait permettre d’éviter la maladie. On doit aussi ajouter à cette réussite indéniable les résultats obtenus dans la recherche spécifique de facteurs de risque de cancers liés à l’activité professionnelle qui ont permis une prévention efficace dans de nombreux cas.
L’origine d’une controverse
Il semble donc, que l’épidémiologie ait fait son travail de façon assez exemplaire et que la piste de l’environnement soit une bonne voie de recherche pour prévenir le cancer. D’où vient la controverse ? Elle vient d’abord du désir louable de quelques-uns de protéger la planète de la pollution. La peur du cancer est utilisée pour convaincre de l’importance du problème. En 2004, une réunion à l’UNESCO 8 a stigmatisé la pollution chimique en utilisant la croissance du cancer comme preuve de la nocivité d’une exposition croissante à des produits chimiques de synthèse connus sous le nom de CMR (Cancérogène, Mutagène, Reprotoxique). Le premier « dogme », maintenant largement médiatisé, est le suivant : le nombre de cas de cancer a presque doublé entre 1980 et 2005 9, cette croissance n’est pas expliquée par celle de l’exposition au tabac et à l’alcool, elle est donc due à la pollution chimique. Les prémisses de ce raisonnement sont absolument correctes, mais aucun fait ne permet d’en tirer la conclusion retenue.
Le deuxième « dogme » est le fait que, selon ses tenants, tout cancérogène agit dès le premier contact du sujet exposé avec l’agent pathogène et qu’il n’y a pas de doses sans danger. Ainsi une population nombreuse exposée à de faibles doses verra un grand nombre de cancers se développer en son sein. Naturellement, cette relation dose-effet sans seuil n’a jamais été démontrée non plus.
Un troisième argument assez surprenant est que l’augmentation du cancer ne peut être associée au mode de vie parce que, à part le tabac, aucun des facteurs identifiés dans ce domaine n’est mutagène. Ceci permet aux auteurs de ces points de vue de distinguer l’environnement subi (pollution atmosphérique, rayonnement ionisant, amiante, champs électromagnétiques de basse fréquence, « pollution chimique », tabac passif, additif alimentaire…) de l’environnement choisi (tabagisme, alcoolisme, abus de l’exposition au soleil, alimentation déséquilibrée, comportements sexuels…). Ce serait, selon eux, l’environnement subi qui serait le responsable de l’épidémie de cancer observée ces dernières années. À partir de là, la controverse devient idéologique. D’un côté, on soutient que l’industrie et le progrès technologique sont responsables de tous nos malheurs et qu’il est urgent d’appliquer le principe de précaution, de l’autre, on explique que le progrès technologique a sauvé beaucoup de vies, que rien n’a été formellement démontré au sujet des dangers supposés de la modification de l’environnement dont ces progrès seraient responsables et qu’il est urgent d’attendre. Si on ne veut pas rester à ce niveau de débat, il est important d’analyser correctement les faits et d’identifier les voies de recherche fécondes. Il ne sert en effet à rien d’opposer au propos sans doute un peu trop optimiste des seconds, les arguments des premiers qui sont, au mieux, des raisonnements par analogie et qui ne reposent sur aucun fait démontré.
Une épidémie de cancer ?

L’argument, désormais classique et répété à l’envie pour « démontrer » l’effet de « l’environnement » sur la survenue du cancer, est la constatation d’une prétendue épidémie de cancer concomitante à la détérioration de l’environnement. En réalité si on analyse avec un peu de soin l’évolution du cancer en France 10, on constate qu’il n’y a pas d’épidémie de cancer mais une « épidémie » de cancer du sein chez la femme et une « épidémie » de cancer de la prostate chez l’homme. Pour le comprendre, il est nécessaire d’adopter une approche quantitative qui ne demandera pas un trop grand effort mathématique. Dans une population de 100 000 femmes représentative de la population féminine française, sauf pour l’âge qui est maintenu à une distribution constante égale à celle de la « population mondiale », il y a eu, en 2005, 75 cas de cancer de plus qu’en 1980. Si on regarde la composition de cet accroissement, on observe qu’il y a eu 45 cas de cancer du sein, 10 cas de cancer de la thyroïde, 9 cas de cancer du poumon et 5 cas de mélanome en plus qu’en 1980, les trois dernières localisations n’ayant pas une étiologie bien mystérieuse 11. Si on fait le même exercice chez l’homme, on a 98 cancers en plus toutes localisations confondues, et 95 cancers de la prostate en plus : en d’autres termes en l’absence du cancer de la prostate l’incidence du cancer chez l’homme resterait pratiquement constante sur cette période.
Pour apprécier la valeur de cet argument il faut rappeler que l’environnement évolue parfois de façon favorable et qu’il y a des cancers dont l’incidence diminue. Le cancer du col de l’utérus chez la femme a régressé de 50 % sur 25 ans grâce au dépistage, celui des voies aéro-digestives supérieures chez l’homme de 46 % grâce à la diminution de la consommation d’alcool ; enfin le cancer de l’estomac a diminué dans les deux sexes d’environ 50 %, grâce à une évolution favorable et non planifiée de notre environnement alimentaire ! Prenant ces données en compte, le cancer du sein et de la prostate constituent, malgré tout, largement plus de 50 % des cancers qui augmentent. Dans une approche qui se soucie de la santé publique, on doit donc en priorité chercher à comprendre ce qui s’est passé pour ces deux localisations de cancer.

Pour le cancer du sein, l’explication de l’augmentation de l’incidence est complexe. Cette augmentation est très ancienne et liée au changement de style de vie des femmes 12. La compréhension du phénomène est loin d’être complète mais son ancienneté, son universalité et sa chronologie, différente selon les pays ayant le même niveau de « pollution industrielle », laissent peu de place à une explication liée à la détérioration de l’environnement. Avec l’apparition du dépistage dans les années 80, le phénomène s’est amplifié et dans certains pays comme la France et les États-Unis, la détection de très petites tumeurs a joué un rôle important dans l’augmentation observée. Un marqueur de cette évolution est le cancer du sein in situ 13 dont l’incidence a été multipliée par 7 entre 1980 et 2000 aux États-Unis 14. De ce point de vue, il est instructif de consulter les données historiques du registre du cancer du Connecticut 15. Les cancers du sein in situ, localisés, régionaux et métastatiques, ont augmenté au même rythme jusqu’au début des années 80, puis leurs incidences ont divergé avec l’avènement du dépistage. Seuls les cancers in situ et localisés ont continué à croître, mais à un rythme beaucoup plus élevé que précédemment, tandis que les autres cancers diminuaient, mais assez modestement comparé à l’augmentation des premiers, suggérant l’existence d’un sur-diagnostic 16.
Pour le cancer de la prostate, la situation semble plus simple dans la mesure où une large part de l’augmentation de l’incidence est expliquée par l’avènement des tests de dépistage PSA 17. Par exemple en Scandinavie, le Danemark était hostile à l’usage du PSA, alors que le test était pratiqué en Finlande et en Suède ; l’incidence du cancer de la prostate des deux derniers pays était, en 2000, deux fois celle du Danemark, alors que la mortalité était la même dans les trois pays 18. Si la pratique du PSA n’explique pas la totalité de l’augmentation du cancer de la prostate, elle en explique une très grande partie.
En conclusion, même si « l’environnement » de nos compatriotes est pollué par des « facteurs de risque exogènes », dont on ignore aujourd’hui la nature, il ne faut pas s’attendre à ce que des investissements dans la recherche de ces facteurs et la prévention qui peut en résulter conduisent à éviter un grand nombre de cancers. Naturellement cela n’exclut pas la recherche dans ce domaine, en particulier pour les cancers dont l’incidence et la mortalité augmentent simultanément, mais il est important de ne pas s’engager dans des impasses sur la base de résultats épidémiologiques incertains ou mal interprétés.
L’épidémiologie est-elle arrivée à la limite de ses possibilités ?
Il y a quelques années un article de Gary Taubes avait posé cette question dans Science 19 en mettant en avant de nombreux résultats incertains ou de véritables « faux positifs » produits par la discipline. Cet article intitulé « Epidemiology faces its limits » (« L’épidémiologie est confrontée à ses limites ») reste une lecture instructive : il met en évidence les difficultés d’interprétation des études d’observation que sont les études épidémiologiques, et l’alliance involontaire entre certains scientifiques et les médias pour produire des inquiétudes injustifiées dans le grand public. Publié en 1995, cet article permet aussi d’évaluer la faible distance parcourue vers une amélioration des règles de publication de la discipline. Il est inévitable que le besoin de publier, associé à une générale absence de réflexion sur l’intérêt des études négatives, conduise à biaiser la littérature scientifique avec un nombre croissant d’études positives de faible précision. Dans ce contexte le calcul de risque attribuable, l’utilisation de la relation linéaire sans seuil et la pratique de la méta-analyse conduisent à des messages incompréhensibles, voire contradictoires. Il y a alors de grandes chances pour que l’épidémiologie devienne une nuisance pour la société comme le suggérait Dimitri Trichopoulos, un épidémiologiste de renom, dans l’article de Taubes cité plus haut.
Lorsque l’Institut National du Cancer annonce que 13 % des cancers du poumon sont dus au radon, 10 à 20 % à des expositions professionnelles, et qu’il est admis que près de 90 % de ces cancers sont dus au tabagisme, le lecteur non initié est certainement troublé par la forte contribution apparente du radon, mais aussi par une somme de pourcentages supérieure à 100 %. Il serait souhaitable de lui expliquer que la majorité des cancers du poumon causés par le radon sont dus à l’exposition conjointe radon+tabac, et que l’abandon du tabac est un moyen de prévention des effets du radon plus efficace que la transformation de l’habitat. Un article récent 20 montre du reste que la prise en compte de l’exposition au radon dans l’habitat neuf est probablement utile, mais que la transformation de l’habitat ancien pour se protéger du radon n’est pas justifiée économiquement : ce dernier résultat devrait permettre d’établir des priorités dans les projets de rénovation de l’habitat « insalubre ».
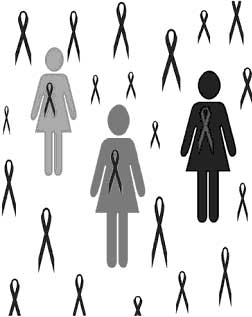
La relation linéaire sans seuil, utilisée dans la plupart des études épidémiologiques pour donner plus de puissance à la mise en évidence d’un effet, est trop souvent utilisée par la suite comme « vérité d’évangile » pour calculer le risque attribuable. Il suffit alors d’avoir assez de sujets exposés à de très faibles doses – pour lesquelles le risque n’est pas avéré –, pour que le risque attribuable soit substantiel. Rappelons que les études épidémiologiques sont dans leur grande majorité, trop peu puissantes pour évaluer le risque aux faibles doses. À titre d’exemple,prétendre que l’alcool est cancérogène dès le premier verre est peut-être un argument dissuasif, mais n’est certainement pas un fait épidémiologique avéré, pas plus pour le cancer du sein que pour les autres cancers liés à l’alcool. Le fait qu’un modèle avec seuil ne soit pas retenu, quand il est testé contre le modèle linéaire, montre simplement qu’on n’a pas assez d’information aux faibles doses pour défendre un modèle plus complexe que le modèle linéaire sans seuil. Cette remarque est valable pour les rayonnements ionisants, exposition pour laquelle le débat a été le plus spectaculaire 21.
Forces et limites des méta-analyses
Les épidémiologistes sont donc contraints de trouver des solutions pour évaluer l’effet des faibles doses d’un cancérogène avéré ou le rôle d’une exposition dont l’effet est apparemment faible. À cette fin, ils ont adopté un outil très utilisé en recherche clinique : « la méta-analyse ». On rassemble les données de tous les articles publiés sur le sujet et on procède à une analyse commune. Appliquée à des essais randomisés 22, comme en recherche clinique, cette méthode a montré son efficacité. Appliquée à des études d’observation, cette méthodologie se heurte à de nombreux écueils. En effet ces études sont sujettes à des biais non identifiables qui peuvent se répéter de la même façon dans toutes les études, permettant de passer de plusieurs résultats incertains à un résultat unique précis, mais faux.
Un deuxième écueil est le « biais de publication » : alors que les études négatives et imprécises ne sont généralement pas publiées, les études imprécises et positives le sont souvent. Un exemple intéressant est celui de la méta-analyse des études des dioxines comme facteur de risque du lymphome non-hodgkinien, rapporté dans un article récent 23. Les études imprécises sont toutes positives, alors que celles qui sont les plus précises se distribuent plus largement entre études positives et négatives. Cet article discute aussi d’autres difficultés inhérentes aux études d’observation et à leur interprétation, et mérite une lecture attentive.
Le troisième problème est lié au fait que les études rassemblées ont souvent des protocoles différents et qu’il faut trouver un « plus petit dénominateur commun » pour pouvoir procéder à une analyse statistique conjointe. On est ainsi amené à supprimer des sujets qui figuraient dans les études initiales et à changer des mesures d’exposition en se privant de certaines informations seulement présentes dans un petit nombre d’études, qui étaient souvent les mieux conçues. L’exemple le plus frappant est sans doute celui de deux méta-analyses de l’effet des champs magnétiques de très basse fréquence, qui a conduit le CIRC à classer cette exposition comme un cancérogène « possible 24 » pour les leucémies de l’enfant 25. Suite à de telles manipulations de données, des études publiées comme négatives par leurs auteurs sont devenues positives dans la première méta-analyse 26. L’auteur de l’autre méta-analyse, après une étude de la fiabilité du résultat, conduite après le classement du CIRC, conclut 27 : « these analyses support the idea that the public health impact of residential fields is likely to be limited, but both no impact and a substantial impact remain possibilities in light of the available data ». Ce qui veut dire en résumé qu’il n’y a aucune information sur le sujet dans les études épidémiologiques publiées. Comme il n’y a aucun autre résultat permettant d’incriminer cette exposition, les tenants de sa nature cancérogène ne disposent en réalité d’aucun fait solide permettant de défendre leur point de vue, et doivent faire appel à des « arguments d’autorité » tels que le classement du CIRC ou de l’OMS, qui semble leur donner raison à condition de confondre « possible » et « probable ».
La responsabilité de l’épidémiologie et des épidémiologistes
L’épidémiologie est une science d’observation qui fonctionne par accumulation de résultats concordants obtenus par différentes approches et dans différentes populations. La méthode épidémiologique est rigoureuse et ne peut pas être tenue pour responsable d’une mauvaise utilisation de ses principes et des modèles mathématiques indispensables à sa démarche.
Les praticiens de la discipline savent qu’ils produisent des résultats qui ont un impact important sur la société et devraient donc faire preuve d’une plus grande prudence lorsqu’ils interviennent dans des médias qui sont friands de résultats inquiétants très favorables à leurs ventes. La publicité ainsi faite à un résultat isolé, avec la participation de ceux qui l’ont obtenu, est néfaste à la crédibilité de la discipline. Si des scientifiques, sur la base d’une étude isolée, annoncent des résultats qui sont démentis quelques mois plus tard par une autre étude, la confiance dans l’approche scientifique se dégrade et des polémiques se développent où chacun invoque le résultat de l’une ou l’autre étude en fonction de ses convictions idéologiques. Rappelons de nouveau qu’on aura toujours tendance à retenir l’étude positive, c’est-à-dire l’affirmation inquiétante, même si son démenti est plus convaincant. Par exemple, la saccharine dont la nocivité a été démentie dans une immense et coûteuse étude est restée longtemps suspecte et l’est peut-être encore aux yeux de certains consommateurs.
Le doute et la remise en cause des théories antérieures font partie de la démarche scientifique : l’acquisition progressive de résultats dont la synthèse est de plus en plus valide demande du temps et, dans un monde idéal, l’information ne devrait sortir du laboratoire que lorsqu’un niveau de certitude suffisant est atteint. Certaines études mal conçues n’atteindront jamais ce niveau. Par exemple, évaluer le nombre de cas de cancer au voisinage des centrales nucléaires, des lignes à hautes tensions et bientôt des antennes relais, sont des réponses non scientifiques à des problèmes de société ; positives ou négatives, ces études ne font pas progresser la connaissance 28, même si le service de communication d’EDF est heureux de pouvoir annoncer qu’il n’y a pas d’excès de cancer au voisinage de ses centrales, comme si le fait qu’il n’y ait pas de dose significative de rayonnement était insuffisamment convaincant. En dépit de leur faiblesse méthodologique évidente, on trouvera pourtant des épidémiologistes et des financements, ceci expliquant sans doute cela, pour conduire ce genre d’études.
L’épidémiologie manque d’ésotérisme : le nombre de cas de cancer ou de décès est une mesure concrète, prétendument compréhensible par tous 29, alors que les becquerels, les sieverts ou les teslas n’évoquent pas grand chose. Tout un chacun pense être en mesure de discuter les conséquences de Tchernobyl ou le danger des antennes relais, en s’appuyant sur des résultats douteux ou mal compris ; en revanche les résultats des sciences « dures » intéressent assez peu le grand public et atteignent rarement les premières pages des journaux.
Si les résultats épidémiologiques sont perçus comme aussi incertains, tout devient possible : les médias reprennent les thèses d’experts « indépendants » autoproclamés utilisant des procédés très douteux pour mettre en cause l’indépendance financière de chercheurs compétents qui s’opposent à leur point de vue. Une approche scientifique devient presque inaudible dans un monde enclin à souscrire à la théorie du complot : « ils » nous ont menti, « on » ne nous dit pas tout !
1 Agence de l’OMS située à Lyon et dédiée à la recherche sur le cancer, connue aussi sous le sigle IARC pour International Agency for Research on Cancer.
2 On entend ici par incidence, sauf indication contraire, l’incidence standardisée (ou normalisée), c’est-à-dire celle qu’on observerait dans la même population si elle avait la structure d’âge de la population « mondiale ». Elle n’est donc pas influencée par les caractéristiques démographiques de la population, mais seulement par les facteurs de risque qui y sont présents.
3 Voir « Quand l’industrie du tabac cache la vérité scientifique » de Gilbert Lagrue, Science et pseudo-sciences n° 284, janvier 2009 (Ndlr).
4 L’indicateur publié est en fait la survie médiane, proche de l’espérance de vie, et qui divise la population en deux groupes d’effectifs égaux, de survie respectivement inférieure et supérieure à cette valeur médiane.
5 Doll et al. "Mortality in relation to smoking : 50 years’ observations on male British doctors" 2004 BMJ 328 ;1519.
6 Voir « Les rayonnements ultraviolets : amis et ennemis invisibles » de Jean-Pierre Césarini dans ce numéro de Science et pseudo-sciences.
7 C’est la prévalence élevée de l’infection et de la maladie en Afrique de l’ouest qui a conduit au résultat. En France la majorité des cancers du foie sont liés à l’alcoolisme chronique.
8 Colloque organisé par L’Association pour la Recherche Thérapeutique Anti-Cancéreuse le 7 mai 2004 à l’issue duquel a été signé l’Appel de Paris, qui est une sorte de pétition pour la défense de l’environnement.
9 Il a augmenté en 25 ans de 93 % chez l’homme et de 84 % chez la femme entre 1980 et 2005 (Belot et al 2008, RES 56 159-75.).
10 Belot et al. "Cancer incidence and mortality in France over the period 1980–2005." Revue d’épidémiologie et de santé publique 56.3 (2008) : 159-175.
11 La croissance du cancer de la thyroïde est largement due à la découverte fortuite de la maladie au cours d’examens sophistiqués pratiqués au voisinage de cette glande pour d’autres raisons.
12 Estève 2007, La presse médicale, 37, n02, 315-21.
13 Le cancer in situ par opposition au cancer infiltrant ne s’est pas encore propagé au-delà de la membrane basale et il ne donne généralement aucun symptôme. La plupart d’entre eux n’auraient pas évolué et n’auraient jamais été identifiés en l’absence de dépistage.
14 SEER Cancer Statistics.
15 Anderson et al. Breast cancer res.&treat. 2006, 99 333-40.
16 C’est-à-dire la détection de cancers qui n’auraient pas donné de symptômes du vivant des sujets dépistés.
17 PSA pour Prostate Specific Antigen, une protéine fabriquée par la prostate dont le taux s’élève en cas de pathologies malignes ou bénignes de la prostate.
18 Cancer incidence in five continents vol IX ; WHO database on mortality from cancer.
19 Gary Taubes, Science, 1995 Vol 269, 161-169.
20 Gray et al 2009 BMJ 338 a 3110.
21 Voir Estève 2009, Radioprotection 44, 1, 13-20, et les références de cet article.
22 Études dans lesquelles le facteur étudié (le traitement dans les essais cliniques) est attribué au hasard aux sujets inclus dans l’étude. Dans les études d’observation la présence du facteur est déterminée par l’ensemble de l’environnement du sujet et en est plus difficilement séparable même si des méthodologies existent pour le faire.
23 Boffetta et al. 2009, JNCI 100,14,988-95.
24 Classement 2B, qui n’implique aucune preuve de cancérogénicité, mais suggère le besoin de recherches complémentaires.
25 Voir le dossier « Ondes électromagnétiques : mythes, peurs et réalités », Science et pseudo-sciences n° 285, avril 2009.
26 Elwood, J. Mark. "Childhood leukemia and residential magnetic fields : Are pooled analyses more valid than the original studies ?." Bioelectromagnetics 27.2 (2006) : 112-118.
Estève 2006, ERS, vol.5,6, 459-66.
27 Greenland et al. 2006, Risk anal. 26,471-82.
28 La variabilité géographique du cancer est suffisante pour produire des faux positifs, et la précision de ces études est généralement trop faible pour que des résultats négatifs prouvent quoi que ce soit.
29 Mon expérience avec les étudiants m’a enseigné que la variabilité aléatoire de ce nombre ainsi que l’impossibilité d’évaluer la signification statistique d’un « cluster » après l’avoir détecté, étaient des concepts assez difficiles à comprendre.
Thème : Causes de cancer
Mots-clés : Écologie
Publié dans le n° 286 de la revue
Partager cet article
Causes de cancer
Assiste-t-on à une "épidémie de cancers" ? Quelles sont les principales causes de cancer ? Ces questions font l’objet de nombreuses controverses.
Que savons-nous des causes du cancer ?
Le 4 mars 2019













![[Conférence en ligne - Mardi 23 avril 2024 à 20h00] Les révolutions de la recherche sur le cancer](local/cache-gd2/ec/12735272a34aefb87f65b995407f51.png?1713241730)









