Les revues prédatrices : un concept dépassé ?
Publié en ligne le 9 janvier 2023 - Science et médias -
Dans un précédent article [1], nous décrivions l’apparition du terme « revues prédatrices » au début des années 2010 dans le contexte de la transformation de l’édition scientifique, du format papier payant vers des revues électroniques gratuites. La disparition progressive de l’abonnement (qui réservait les résultats de recherche à des privilégiés) a laissé place à un nouveau modèle économique : gratuité pour le lecteur et frais de soumission des articles par les auteurs (FTA, ou frais de traitement des articles). Ainsi, le modèle classique « lecteur-payeur » tend à être remplacé par un nouveau modèle « auteur-payeur ». Les revues prédatrices ont ainsi émergé et nous rappelions la définition donnée par un groupe de travail rassemblant scientifiques et éditeurs [2] : « Les revues et les éditeurs prédateurs sont des entités qui privilégient l’intérêt personnel au détriment de l’érudition et se caractérisent par des informations fausses ou trompeuses, un écart par rapport aux bonnes pratiques rédactionnelles et de publication, un manque de transparence et/ou le recours à des pratiques de sollicitation agressives et sans discernement. »
Mais la situation a beaucoup évolué en une dizaine d’années : les éditeurs de revues prédatrices ont constaté que la communauté scientifique prenait conscience du danger et mettait en place des mesures pour les ostraciser, pour faire en sorte que les chercheurs les identifient rapidement et les évitent. Ils se sont alors adaptés et professionnalisés pour survivre. En 2022, il existe peu de revues prédatrices selon la définition initiale, mais beaucoup de revues naviguant dans la zone grise d’une qualité faible ou douteuse.
Un rapport de l’InterAcademy Partnership (IAP, un réseau international qui regroupe 149 académies 1) publié en mars 2022 alerte la communauté scientifique sur les mutations en cours dans le monde des revues prédatrices [3, 4]. Dans cet aboutissement d’une étude de deux ans auprès de 1 800 chercheurs de 112 pays, les auteurs notent que les pratiques prédatrices se diversifient et se sophistiquent, et qu’il est ainsi « de plus en plus difficile [de les] identifier » et « de les distinguer en toute confiance de celles qui sont frauduleuses, mal financées ou de piètre qualité ».
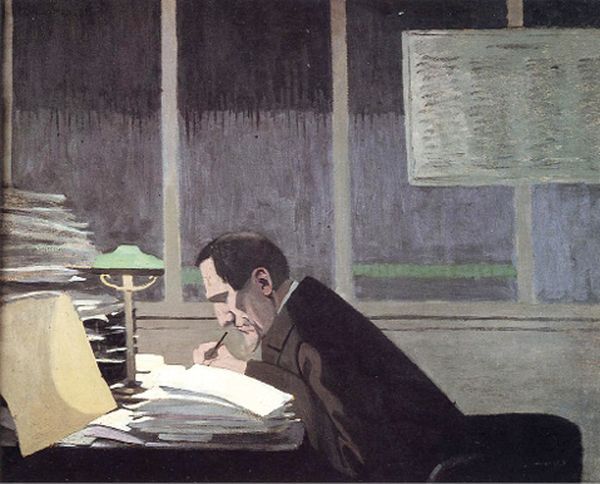
Félix Vallotton (1865-1925)
Félix Fénéon, critique d’art et directeur de revue, joue un rôle notable dans la vie intellectuelle française des XIXeet XXesiècles. Sa sympathie pour le mouvement anarchiste est bien connue. À la tête de la rédaction de La Revue blanche, il contribue notamment à défendre l’honneur du capitaine Dreyfus dans les années 1890.
Les listes noires faisant l’inventaire des revues prédatrices et des revues légitimes sont vouées à ne jamais être à jour et deviennent ainsi inutiles, voire « risquent de désavantager les revues et les conférences moins bien établies et de négliger les pratiques douteuses qui s’infiltrent dans les pratiques établies ». À la place, l’IAP propose une analyse fondée sur une échelle faisant la distinction entre « la fraude pure et simple, les pratiques de mauvaise qualité, douteuses et contraires à l’éthique, et les bonnes pratiques ». Le réseau des académies constate que les « pratiques contraires à l’éthique » peuvent se retrouver partout, autant chez « des éditeurs traditionnels réputés et établis » que chez des « éditeurs émergents et en libre accès ».
Comment expliquer cette évolution ?
Les éditeurs de revues prédatrices ont progressivement appris à intégrer tous les outils électroniques de gestion des revues (par exemple la soumission par courriel avec une simple pièce jointe a été remplacée par la soumission en ligne sur le site de l’éditeur). Ils ont amélioré l’orthographe de leurs sites Internet et courriers de sollicitation, intégré des instructions aux auteurs et facilité la navigation sur leurs sites. Ils se sont domiciliés dans d’autres endroits qu’en Inde, dans des pays tels que les Émirats arabes unis, la Suisse, la Belgique, etc. Ils ont salarié des équipes de doctorants souvent domiciliés en Chine et sous-payés, capables de procéder à une évaluation grossière des articles. Ils ont augmenté les frais demandés aux auteurs pour les rapprocher de ceux des grandes revues scientifiques. Ils ont recruté des juristes pour dissuader les chercheurs et les institutions qui pourraient inciter ouvertement à ne pas publier chez eux. Distinguer ces revues douteuses ou de faible qualité des revues légitimes est devenu difficile et nécessite un travail complexe alliant examen des articles produits, analyse du fonctionnement de ces éditeurs, de l’usage des noms de domaines, des adresses Internet, etc.
Par ailleurs, la naïveté ou la complaisance de chercheurs a favorisé cette évolution. En quête de reconnaissance, certains acceptent très facilement d’être membres fantômes de comités de rédaction. D’autres, plus établis, se retrouvent rédacteurs en chef de plusieurs revues sans réellement pouvoir justifier d’une quelconque activité (les « petites mains chinoises » évoquées plus haut sont les chevilles ouvrières de ces revues). Ainsi, ils cautionnent par leur nom des revues douteuses et peuvent, en outre, tirer profit d’une grande rapidité d’acceptation de leurs propres articles, avec une évaluation par les pairs peu exigeante. Ces chercheurs publient beaucoup et leurs articles sont très vite acceptés (en moins d’un mois entre la soumission et la publication), à la grande satisfaction de leurs institutions. Certaines de ces institutions acceptent de payer les frais de soumission des articles, même si d’autres ont commencé à limiter cette prise en charge uniquement pour les revues prestigieuses.
Les articles publiés rapidement par ces revues douteuses ne sont pas tous de piètre qualité. Il peut s’agir de recherches méthodologiquement correctes mais refusées par des revues prestigieuses. La solution de facilité peut être alors de payer pour se voir publié.
Les conclusions de l’InterAcademy Partnership
Le rapport de l’IAP constate que les définitions actuelles des revues et conférences prédatrices sont inopérantes et qu’il est nécessaire de mieux comprendre les pratiques et comportements prédateurs de plus en plus sophistiqués. Il souligne le risque de voir « revues et conférences prédatrices […] s’enraciner dans la culture de la recherche » avec, comme conséquence, une situation où « la confiance du public dans la recherche et [son] intégrité » serait minée. De plus, il constate un « gaspillage important des ressources de recherche ». Enfin, le réseau des académies note que les pratiques prédatrices tirent profit de la « monétisation et la commercialisation de rapports de recherche académique », des défauts des systèmes d’évaluation de la recherche et des « faiblesses du système de révision par les pairs [manque de transparence dans le processus de révision par les pairs, manque de formation, de moyens et de reconnaissance des réviseurs] ».
L’IAP formule des recommandations détaillées en direction de plusieurs acteurs du monde de la recherche scientifique : la communauté de chercheurs, les établissements d’études supérieures, les organisations multilatérales (comme l’Unesco), les académies, les bailleurs de fonds, les ministères en charge de la recherche, les éditeurs, les bibliothèques et les services d’indexation, les organisateurs de conférences.
Parmi les recommandations de l’IAP, il y a celle invitant à « étudier l’intérêt de la fondation d’un organisme d’accréditation international à but non lucratif ou d’un consortium d’intervenants existants pour la publication et les conférences académiques ». C’est un projet ambitieux qui ne manquera pas de rencontrer des résistances.
La situation décrite par l’IAP peut être vue comme une conséquence directe du modèle publish or perish (publier ou périr) qui incite les chercheurs à publier beaucoup d’articles et à beaucoup les citer. Toutes les propositions pour évaluer différemment les recherches, par exemple en privilégiant la qualité du travail au détriment du nombre de publications, sont variées et bienvenues. Mais il reste à les mettre en œuvre et faire en sorte qu’elles deviennent la norme.
Enfin, ces réflexions ne sont pas sans rapport avec la question de l’accès libre aux résultats de la recherche. Ainsi, dans un communiqué publié en avril 2022 [5], le CNRS, dans le cadre de sa politique de science ouverte, « encourage ses chercheurs et ses chercheuses à se tourner vers les modèles de publication gratuits à la fois pour les auteurs et les lecteurs ». Il s’agit de favoriser le modèle dit « diamant » des revues, c’est-à-dire financé par des subventions académiques (voir encadré ci-dessous).
L’open access des publications permet la gratuité de lecture et la liberté de réutilisation. Il se décline en différentes voies qui ont toutes pour finalité la diffusion sans entrave des publications. Les deux plus connues sont la voie verte et la voie dorée.
La voie verte consiste en l’auto-archivage par les chercheurs de leurs publications dans des archives ouvertes nationales, institutionnelles ou thématiques (en France, par exemple, l’archive nationale HAL a été créée en 2001 et soutenue financièrement par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation).
La voie dorée est celle dite « auteur-payeur » (paiement de frais de traitement des articles lors de l’acceptation). Cette voie concerne les revues nativement open access (PLoS et BiomedCentral sont les premiers éditeurs de ce type) et des revues établies qui changent leur modèle économique (appelées transformative journals). La voie dorée utilise le plus souvent des licences d’utilisation libre, les licences Creative Commons ; les articles remplissent donc d’emblée les critères de l’open access (gratuité de lecture et liberté de réutilisation).
La voie diamant ou voie platine permet aux scientifiques de publier en accès ouvert et sans frais. Ce sont des revues ou plateformes de publication, financées en amont par un bailleur, une université, une organisation à but non lucratif. La voie diamant est donc gratuite pour les lecteurs et pour les auteurs. De plus, les auteurs conservent leurs droits d’auteurs via l’utilisation de licences libres Creative Commons. Les revues ou plateformes appliquant le modèle diamant peuvent être subventionnées ou générer leurs revenus grâce au modèle freemium (service de base gratuit et services complémentaires payants). Par exemple, seul l’accès au texte de l’article est libre, les services complémentaires (fichier PDF, statistiques…) sont payants.
Certains financeurs ont mis en place des plateformes selon le modèle diamant afin de permettre aux chercheurs qu’ils financent de publier en open access sans frais supplémentaires. C’est le cas par exemple du Wellcome Trust avec la plateforme Wellcome Open Research ou de la Commission européenne avec la plateforme Open Research Europe, [ou encore de la fondation Bill & Melinda Gates avec la plateforme Gates Open Research].
Source
Blog sur la science ouverte réalisé par les documentalistes de la bibliothèque du CeRIS (Centre de ressources en information scientifique) de l’Institut Pasteur (openscience.pasteur.fr) : « La voie verte et la voie dorée de l’Open Access », 12 mars 2021, et « La voie diamant de l’Open Access », 23 avril 2021.
1 | Maisonneuve H, « Les revues prédatrices », SPS n° 332, octobre 2020.
2 | Grudniewicz A et al., “Predatory journals : no definition, no defense”, Nature, 2019.
3 | The Interacademy Partnership, “World academies call for a concerted action to combat predatory journals and conferences”, communiqué de presse, 11 mars 2022.
4 | Maisonneuve H, « Le réseau des Académies (IAP) lutte contre les revues prédatrices : sont-ils seuls ? », 27 avril 2022.
5 | Centre national de la recherche scientifique, « Le CNRS encourage ses scientifiques à ne plus payer pour être publiés », communiqué de presse, 7 avril 2022.
1 Académies des sciences, de médecine, de technologies. En France, l’Académie des sciences et l’Académie nationale de médecine en sont membres.
Publié dans le n° 341 de la revue
Partager cet article
L' auteur

Hervé Maisonneuve
Médecin de santé publique, il est consultant en rédaction scientifique et anime le blog Rédaction Médicale et (…)
Plus d'informationsScience et médias
Le traitement de l’information scientifique dans les médias.
Les médias et la science
Le 4 juillet 2020
Les revues prédatrices : un concept dépassé ?
Le 9 janvier 2023
Les Lumières à l’ère du numérique : entretien avec Laurent Cordonier
Le 2 septembre 2022
Influence de la Lune : une histoire à dormir debout
Le 22 mars 2022Communiqués de l'AFIS
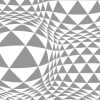
Glyphosate, médias et politique : la science inaudible et déformée
Le 20 octobre 2023


























