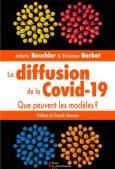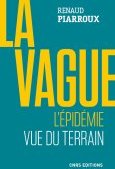Quelle place pour la psychologie scientifique dans la pandémie de Covid-19 ?
Publié en ligne le 12 octobre 2020 - Covid-19 -
Comment l’être humain se comporte-t-il lors d’une épidémie ? Question simple, dont la réponse va déterminer l’évolution de la maladie et les démarches à entreprendre pour en limiter les dégâts. Surtout que l’ennemi est aujourd’hui identifié : ce sont des pathogènes qui exploitent des organismes vivants complexes comme réservoirs, véhicules et transmetteurs. Bactéries, champignons, parasites, protozoaires, virus et prions ont de tout temps été une menace capitalisant sur nos modes de vie, nos interactions, nos comportements, nos structures sociales. Par l’opération aveugle de la sélection naturelle, certains se trouvent mieux adaptés à nos habitudes, leur permettant de survivre et de proliférer, sans égards, bien entendu, pour nos propres intérêts.
Contre eux, nous disposons de nos connaissances acquises, de notre raison et de notre capacité à adapter nos comportements. Nous pouvons trouver des remèdes et changer nos attitudes, court-circuiter la logique parasitaire par l’isolement, la protection, la méfiance ou la prudence, nous unir par notre force de solidarité et l’empathie qui nous rend sensible au sort de nos proches. Ce n’est pas rien ! Il s’agit ni plus ni moins d’un combat séculaire pour sauvegarder notre existence même. Un combat qui repose, dans le fond, sur la connaissance que nous avons de notre propre espèce. Cette connaissance est-elle bien mise à profit ?
Il semble malheureusement que la question ne soit pas tranchée.
Nos comportements ont-ils évolué au fil des siècles ?

commémorer la fin de la peste de 1630, Francesco Guardi (1712-1793)
L’évolution de la pandémie de Covid-19, telle qu’elle s’est déployée mondialement de décembre 2019 à juin 2020, jette une lumière inquiétante sur notre niveau de préparation et notre capacité à faire face, collectivement, à une menace somme toute prévisible, tant notre histoire est jalonnée d’épisodes semblables. Dans La Guerre du Péloponnèse [1], Thucydide rapportait déjà les réactions irrationnelles lors de la « peste » qui frappa Athènes de 430 à 427 avant notre ère : paniques désordonnées, prières collectives, accusations fantaisistes, médecins débordés, inégalités flagrantes, prophéties gratuites... Deux mille ans plus tard, reconstituant la peste londonienne de 1665, Daniel Defoe décrivait les mêmes comportements, soulignant les querelles politiciennes, l’essor de la pensée magique, le désespoir général, mais aussi le remarquable courage et l’altruisme des uns et des autres [2].
Avons-nous réellement progressé depuis ces épisodes historiques tragiques ? L’heure n’est pas encore au bilan, et il y a fort à parier que cette crise du nouveau coronavirus réserve encore bien des surprises et des rebondissements. Mais un rapide survol des événements récents n’encourage guère à l’optimisme : dès le début, on a vu proliférer les « remèdes » douteux, les « experts » improvisés, les prophéties péremptoires, les théories du complot les plus absurdes, les comportements risqués et irrationnels, la politisation de la science, la polarisation des opinions, bref, une confusion diffuse que l’Organisation mondiale de la santé a nommé « infodémie », avant même de décréter l’état de pandémie.
Mais attirons ici l’attention sur un problème peut-être plus profond, et dans un sens plus embarrassant encore. Que nous apprend cette crise sur l’état de l’expertise réelle ? On voudrait, plus que jamais, pouvoir s’en remettre aux connaissances les plus solides, aux faits les mieux établis, aux voix les plus fiables. En particulier, en plus de notre savoir médical et sanitaire, on pourrait penser que la somme considérable des connaissances acquises sur la cognition et le comportement humain pourraient nous venir en aide dans une situation telle que la nôtre. Après tout, l’issue d’une épidémie dépend largement des comportements individuels et collectifs d’une population, des décisions et des affects de chacun, des croyances partagées ou rejetées, des micro-gestes du quotidien, comme se laver les mains, se tenir à distance des autres, rester le plus possible chez soi, éviter les rassemblements, suivre les recommandations officielles, penser aux personnes vulnérables... En d’autres termes, l’évolution d’une épidémie trouve une partie de ses explications aussi bien dans des facteurs psychologiques propres aux individus, qui déterminent leurs comportements, que dans des facteurs biologiques liés à la structure et aux mécanismes du virus lui-même.

Paul Klee (1879-1940)
Or, le moins que l’on puisse dire, c’est que la science psychologique, comme bien d’autres domaines, est une victime de plus de la Covid-19. Je l’écris avec d’autant plus d’amertume que cette discipline est mon activité professionnelle principale, que j’y ai consacré ma carrière, et qu’elle constitue une base incontournable de l’exercice de l’esprit critique, puisqu’elle détaille par le menu nos biais, nos faiblesses, nos illusions et nos erreurs. À quoi ont servi toutes ces recherches si elles ne sont pas en mesure de nous éclairer et de nous guider de manière fiable lorsqu’on en aurait vraiment besoin ? C’est l’âpre débat qui agite en ce moment le milieu des sciences du comportement, et la psychologie en particulier.
Les sciences comportementales à l’épreuve de l’épidémie
Esquissons ici les grandes lignes de cette controverse suffisamment riche d’enseignements pour intéresser les chercheurs dans d’autres disciplines ainsi que le public en général, tant elle offre une lumière crue sur nos limites face à un danger collectif et invisible. C’est l’histoire d’une débâcle, d’une frénésie et d’un conflit ouvert.
La débâcle est sarcastiquement documentée par le psychologue britannique Stuart Ritchie [3]. Il note que dès le mois de février 2020, les plus grands noms de la psychologie du raisonnement, considérés comme des parangons de la pensée critique et des spécialistes des biais cognitifs, se sont bousculés pour dénoncer ce qui, selon eux, relevait d’un alarmisme irrationnel. David DeSteno, Paul Slovic, Cass Sunstein et Gerd Gigerenzer, véritables stars de l’étude de la perception des risques et des croyances irrationnelles, ont tous publié des tribunes ou donné des interviews où ils déploraient que la peur l’emporte si facilement sur la raison (avec des titres tels que « Les biais cognitifs qui nous font paniquer face au coronavirus » [4], « Comment la peur déforme notre réflexion sur le coronavirus » [5], « Coronavirus : l’illustration de toutes nos incapacités à évaluer les risques » 1 [6]). Les chiffres, disaient-ils à ce moment, montrent que nous surestimons clairement le danger. Nous serions victimes de notre « négligence des probabilités » et du « biais de représentativité », entre autres, qui nous portent à prendre des mesures drastiques et à nous inquiéter excessivement parce que, simplement, nous accordons trop de crédit aux mauvaises nouvelles et nous ignorons les chances immenses de ne jamais attraper ce malheureux virus dont on fait tant de cas. Naturellement, les comportements d’achats compulsifs et la pénurie de certaines denrées constituaient alors l’illustration rêvée d’une telle méconnaissance du raisonnement probabiliste, bien que la part du rationnel et de l’irrationnel ne soit pas toujours facile à déterminer dans des circonstances aussi inédites [7].
La suite des événements n’a évidemment pas tardé à donner tort à ceux qui exigeaient un retour à la raison, ce qui a conduit à un renversement de perspective assez amusant : désormais, au lieu de le surestimer, nous étions soudainement devenus aveugles au danger. Et ce sont parfois les mêmes qui ont repris la plume pour, cette fois-ci, nous mettre en garde contre le « biais d’optimisme », le « biais de confirmation » et le « biais de croissance exponentielle » [8] ! Loin d’être porté à surestimer les risques du coronavirus et à négliger les chances d’en réchapper, le cerveau humain serait désormais précâblé pour nous faire succomber à une menace imminente et sournoise. Avec une période d’incubation asymptomatique allant jusqu’à deux semaines [9], le virus peut se répandre de façon multiplicative à notre insu : pendant ce temps, notre cognition nous persuaderait que cela ne nous concerne pas, nous porterait vers des informations confirmant cet optimisme et nous cacherait l’ampleur du désastre qui se profile à brève échéance et à plus long terme. Qui plus est, un mécanisme de « réactance psychologique » (voir encadré) pourrait conduire certains à transgresser délibérément les privations de liberté que les autorités prétendent imposer, d’où les scènes de comportements irresponsables de foules qui ont apparemment oublié qu’elles surestimaient complètement les risques quelques jours auparavant.
L’impression qui se dégage de ces prises de position, c’est qu’il existe toujours un phénomène psychologique disponible pour servir d’explication à n’importe quelle situation, et que le comportement des individus s’expliquerait essentiellement par ces biais de raisonnement. Bien sûr, ces revirements peuvent éventuellement s’expliquer par une évolution dynamique de la situation, elle-même reflétée par des changements dans le discours des autorités et la couverture médiatique, passant en quelques jours d’une épidémie touchant essentiellement la Chine et des cas isolés à une pandémie où tout le monde doit se confiner et où le nombre de morts fait l’objet d’une comptabilisation détaillée à chaque bulletin d’information. De ce point de vue, il est possible que beaucoup de gens aient effectivement eu tendance à sous-estimer (puis à surestimer) non pas le risque réel (mal connu), mais les messages délivrés. Mais dans ce cas, l’explication en termes de biais cognitifs ne fournit qu’un éclairage ponctuel et superficiel de la situation, et ne constitue en rien un de ses déterminants principaux.
Négligence des probabilités. Lorsqu’un danger et ses conséquences négatives sont présents à l’esprit, la probabilité de son occurrence tend à être surévaluée. L’idée d’« attraper le coronavirus » l’emporte donc sur les faibles chances de l’attraper en réalité, et la peur induite est égale ou même supérieure à celle que l’on ressentirait si l’on était certain de l’attraper.
Biais de représentativité. Un événement (ou ses chances de nous toucher) est évalué en fonction de notre capacité à nous le représenter mentalement, selon les analogies qui nous viennent à l’esprit. Proche du biais de disponibilité (une chose est jugée plus probable si l’on en a déjà entendu parler), la « représentativité » induit des erreurs d’évaluation des risques dans la mesure où elle rend « le pire » saillant et dévalue les possibilités qui ne sont pas aussi frappantes.
Biais de croissance exponentielle. L’issue d’un phénomène exponentiel est sous-estimée parce qu’elle est anticipée de façon linéaire. Une épidémie est typiquement exponentielle (au moins dans la première phase de son développement) : si un individu en contamine trois autres, puis ces trois en contaminent chacun trois autres, et ainsi de suite, notre représentation mentale de cette évolution tend à grossièrement à sousestimer la rapidité de son évolution, et nous porte par conséquent à réagir trop tard.
Biais d’optimisme. Nous jugeons qu’un événement négatif à moins de chances de nous arriver qu’à autrui. Cette asymétrie augmente la prise de risque personnelle, dans la mesure où nous nous croyons indûment à l’abri des conséquences qui frapperaient autrui pour le même comportement. L’idée que le coronavirus est principalement un danger pour les autres peut conduire au non-respect des consignes sanitaires de sécurité.
Biais de confirmation. Une croyance est protégée par la perception, la sélection et la mémorisation préférentielle des informations qui la confirment, au détriment de celles qui la réfutent. Une idée préconçue sur le coronavirus, ses effets et les mesures visant à le contenir pourra ainsi se renforcer à mesure que nous lui accordons notre attention, et négligeons ce qui ne va pas dans son sens.
Réactance psychologique. La sensation désagréable d’être privé de son autonomie lorsque des décisions qui nous concernent sont prises à notre place (même s’il s’agit des décisions que nous aurions prises nous-mêmes), et l’adoption qui s’ensuit de comportements contraires à ces décisions. La réactance peut donner lieu à des attitudes paradoxales où les individus font des choix qu’ils jugent eux-mêmes peu appropriés, dangereux ou irrationnels, dans le seul but de réaffirmer leur liberté d’agir.
Certes, ce sont là de simples « opinions » d’experts, qui courent toujours le risque d’être dans l’erreur. Est-ce que cela porte vraiment à conséquence ? L’exemple britannique le laisse penser. Conforté par les recommandations de ses experts du Behavioural Insights Team [10], une équipe de spécialistes de la psychologie et du comportement aussi appelée Nudge Unit 2, le gouvernement Johnson avait initialement opté pour une stratégie controversée basée sur l’idée d’« immunité grégaire » (herd immunity). Dans le contexte de la Covid-19, le terme a été popularisé par David Halpern, psychologue et directeur de cette unité dédiée à fournir des avis sur la base des sciences comportementales les plus pointues.
Le même Halpern s’est rendu célèbre en mettant en avant les bénéfices d’un confinement tardif : commencer trop tôt risquerait d’induire une « fatigue comportementale » telle qu’au moment du pic épidémique les gens ne respecteraient plus les consignes de sécurité. Mieux valait laisser courir le virus aussi longtemps que possible et imposer des mesures strictes au moment où elles seraient absolument nécessaires (l’idée, on l’a vu, n’a pas eu le succès escompté). Une tribune signée par plus de 600 psychologues et experts [11] a exigé d’en savoir plus sur le fondement scientifique de cet étrange et nouveau concept de « fatigue comportementale ». Il est apparu que les psychologues « experts » appointés par le gouvernement ne faisaient que donner leur opinion, largement improvisée et basée sur d’obscures intuitions, plutôt que de se fonder sur les meilleures données et preuves scientifiques...
Des connaissances encore trop théoriques

Roger Mathieu (1920-1992)
Voilà pour la débâcle. Malgré des milliers de recherches et de départements entièrement consacrés à l’étude de la psychologie humaine, la contribution de celle-ci à l’explication et à la gestion de la pandémie a été, jusque-là, pour le moins décevante. Et ce d’autant plus que la psychologie, bien évidemment, dispose de ressources tout à fait pertinentes pour nous aider à comprendre nos comportements paradoxaux et à mettre en place des mesures effectives. Mais ces ressources semblent encore confinées à un niveau théorique et abstrait. À témoin, la frénésie des recherches sur la psychologie de la Covid-19 qui submerge actuellement la discipline. On compte à ce jour près de 300 études publiées ou pré-publiées, et au moins autant en préparation et en cours de réalisation sur ce seul sujet (une liste est disponible, régulièrement mise à jour par Moin Syed, de l’université du Minnesota [12]). Elles portent sur les effets émotionnels du confinement, les variables influençant le respect des normes sanitaires, les facteurs politiques de la distanciation, les prédicteurs de l’acceptation d’un éventuel vaccin, le rôle de l’empathie dans les campagnes d’information de santé publique, la perception des personnes portant un masque, les avantages cognitifs du télétravail, les différences interculturelles et socio-économiques face à la crise, et même l’impact de la longueur des doigts sur la compréhension de la Covid-19... Quantité de sujets certes intéressants, mais qui à nouveau donnent une forte impression d’improvisation, voire d’un certain opportunisme.
C’est en fait du jamais vu, et on peut s’interroger sur la priorité soudaine donnée à cet unique objet de recherche. On peut le comprendre pour les sciences médicales et éventuellement économiques, étant donné l’urgence de la situation et ses conséquences catastrophiques. Mais pourquoi les psychologues, dont on penserait qu’ils sont censés en savoir déjà assez sur le comportement humain pour nous préparer aux situations de crise, agissent-ils en masse comme s’il fallait tout reprendre à zéro dans la crise actuelle ? Il y a sans doute plusieurs explications.
Certains profitent de l’occasion pour tester (rapidement) telle ou telle théorie, d’autres sont contraints par les circonstances de se détourner de leur sujet de recherche habituel, et d’autres encore espèrent peser sur les débats par leurs trouvailles inédites. Quoi qu’il en soit, cette frénésie de recherche a presque immédiatement donné lieu à des querelles internes qui se manifestent aujourd’hui sous forme de conflit ouvert.
Une discipline en conflit interne
L’illustration la plus nette de ce conflit se trouve dans une frénésie parallèle de publications portant, cette fois-ci, non pas sur la psychologie de la Covid-19 en tant que telle, mais justement sur le rôle que les sciences comportementales ont à jouer dans cette crise. L’opposition se cristallise entre, d’une part, des chercheurs qui défendent l’importance des connaissances psychologiques et revendiquent la solidité de ce savoir pour intervenir dans la sphère publique [13] et, d’autre part, des chercheurs qui au contraire en appellent à davantage d’humilité et décrètent que la psychologie est non seulement impuissante à nous guider dans des circonstances aussi graves, mais qu’il serait même dangereux qu’elle le fasse [14].
Le fond de ce débat n’est pas nouveau, il repose sur ce qu’on a appelé la « crise de réplicabilité » en psychologie [15]. Depuis une dizaine d’années, il est devenu clair que beaucoup de résultats influents et classiques de la psychologie moderne étaient, au mieux des artefacts expérimentaux peu fiables, au pire le fruit de fraudes délibérées (voir la page « Research misconduct » de l’American Psychological Association [16]). Une longue tradition en psychologie expérimentale consiste à prononcer des jugements et des leçons définitives concernant la nature humaine sur la base d’études de laboratoires effectuées sur de petits échantillons d’étudiants principalement nord-américains. Non seulement nombre de ces résultats ne résistent pas à la réplication avec de plus grands échantillons et dans des conditions accrues de contrôle, mais en plus ils s’avèrent impossibles à généraliser à d’autres populations, et inefficaces quand on cherche à les appliquer à grande échelle dans la vie réelle. Pourquoi, dans ces conditions, faudrait-il faire confiance à la psychologie dans une situation d’urgence où des milliers de vies sont en jeu, sans parler des retombées économiques désastreuses ?
Hans Ijzerman, de l’université Grenoble Alpes, et d’autres psychologues partageant son point de vue, sont très clairs à cet égard. Prenant exemple sur les critères d’applications technologiques de la Nasa, qui fournissent neuf niveaux de « préparation » pour juger si une innovation doit être considérée comme « prête à l’emploi » [17], ces chercheurs jugent [18] que la psychologie ne dépasse que rarement le premier niveau, c’est-à-dire celui où un problème, un mécanisme ou un effet a simplement été identifié et défini. De là à en faire une loi prête à être appliquée pour limiter les dégâts d’un virus globalisé, il y aurait encore huit paliers de tests, d’évaluations, de comparaisons et de mises en situation à franchir, lesquels ne sont quasiment jamais effectués en psychologie...
Pour un usage raisonné de la psychologie comportementale
Peut-être ne s’agit-il là que des jeux d’influences inhérents à chaque discipline, des querelles d’experts sans grand intérêt pour les problèmes réels auxquels nous devons, d’une manière ou d’une autre, faire face. Et il ne s’agit bien évidemment pas de dire, pour toutes les parties concernées, que la psychologie est une pseudoscience qui ne sert jamais à rien ! Au contraire, nos connaissances sur l’esprit et le comportement sont plus précieuses que jamais pour nous aider à distinguer le vrai du faux. La psychologie scientifique sera toujours l’alliée de la pensée critique, mais c’est précisément à ce titre qu’elle doit sans cesse s’interroger sur ses possibilités et ses limites. Elle ne peut à elle seule prétendre fournir une grille d’explication complète. En particulier, une situation comme cette pandémie doit nous mettre en garde contre l’usage abusif et automatique de nos connaissances, comme celle des biais classiques de raisonnement, pour expliquer le comportement « des gens », mais aussi faire réfléchir les chercheurs aux priorités et au sens de leurs investigations, ainsi qu’à leurs responsabilités dans la manière dont leurs résultats sont présentés au public, et éventuellement appliqués dans la vie réelle.
Comme souvent, c’est en situation d’urgence que se révèlent nos angles morts, nos divergences et nos présupposés, autant d’obstacles que ne connaissent pas les virus. À ce titre, et sans doute pour longtemps encore, il est sans doute bon de garder à l’esprit que nos pires ennemis nous connaissent souvent beaucoup mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes.
1 | Thucydide, La Guerre du Péloponnèse, livre II, chapitres 47 à 54.
2 | Defoe D, Journal de l’année de la peste, 1722.
3 | Ritchie S,“Don’t Trust the Psychologists on Coronavirus”, UnHerd, 31 mai 2020.
4 | Sunstein CR,“The Cognitive Bias That Makes Us Panic About Coronavirus”, Bloomberg, 28 février 2020.
5 | DeSteno D, “How Fear Distorts Our Thinking About the Coronavirus”, The New York Times, 11 février 2020.
6 | Fisher M, “Coronavirus ‘Hits All the Hot Buttons’for How We Misjudge Risk”, The New York Times, 13 février 2020.
7 | Luscombe B,“Why Overreacting to the Threat of the Coronavirus May Be Rational”, Time, 11 mars 2020.
8 | Kunreuther H, Slovic P, “What the Coronavirus Curve Teaches Us About Climate Change”, Politico, 26 mars 2020.
9 | OMS, « Maladie à coronavirus 2019 (Covid-19) : questionsréponses », consulté le 4 juin 2020.
10 | Hutton R,“Keep Calm and Wash Your Hands : Britain’s Strategy to Beat Virus”, Bloomberg, 11 mars 2020.
11 | Hahn U et al.,“Why a Group of Behavioural Scientists Penned an Open Letter to the U.K. Government Questioning Its Coronavirus Response”, Behavioral Scientist, 16 mars 2020.
12 | Psychology of COVID-19 Preprint Tracker.
13 | Van Bavel JJ et al., “Using Social and Behavioural Science to Support COVID-19 Pandemic Response”, Nature Human Behaviour, 2020, 4 :460-71.
14 | Ijzerman H et al., “Psychological Science is Not Yet a CrisisReady Discipline”, PsyArXiv Preprints, 27 avril 2020.
15 | Klein RA et al., “Investigating variation in replicability”, Social Psychology, 2014, 45 :142-52.
16 | “Research misconduct”, American Psychological Association, sur apa.org
17 | NASA, “Technology Readiness Level”, 2012, sur go.nasa.gov
18 | Lewis Jr N, “How many (and whose) lives would you bet on your theory ?”, The Hardest Science, 1er mai 2020.
C’est au Royaume-Uni, en 2010, que la première nudge unit chargée d’appuyer les différents services gouvernementaux voit le jour. Intitulée Behavioral Insights Team [1], elle est mise à contribution sur différents sujets (améliorer la collecte des impôts et des amendes, réduire les erreurs de prescription médicale, inciter à donner un jour de salaire à une œuvre caritative, incitation à réaliser des travaux d’efficacité énergétique, etc.). Ses services ont été partiellement privatisés en 2014. Aux États-Unis, c’est en septembre 2015 que le président Obama met officiellement en place 3 la Social and Behavioral Sciences Team avec pour objectif affiché d’apporter l’appui de cette discipline pour la mise en œuvre et l’amélioration des programmes fédéraux : « Un gouvernement efficace et efficient doit […] refléter notre meilleure compréhension du comportement humain –comment les gens s›engagent avec les politiques et les programmes, y participent et y répondent » [2]. Avec l’arrivée du président Trump, l’activité de cette équipe s’est éteinte. En France, le président Macron qui a eu recours lors de sa campagne électorale aux conseils de la nudge unit de l’entreprise BVA [3], instaure en mars 2018 une nudge unit à la française au sein de la Direction interministérielle de la transformation publique [4]. Son objectif est de « s’appuyer sur les connaissances en sciences comportementales afin d’améliorer l’efficacité des politiques publiques ». Pour la gestion de la crise du coronavirus, cette équipe s’est appuyée sur celle de l’entreprise BVA pour conseiller le gouvernement [3].
Références
1 | Site de la Behavioural Insights Team avant sa privatisation partielle. Sur www.gov.uk
2 | Site de la Social and Behavioral Sciences Team (site gelé en 2017). Sur sbst.gov
3 | Woessner G, « Emmanuel Macron et le pouvoir du “nudge” », Le Point, 4 juin 2020.
4 | « Les sciences comportementales au service de la transformation publique ». Sur modernisation.gouv.fr
1 Traduction par nos soins.
2 En référence à la théorie des nudges(« coups de pouce »), proposée par Sunstein et Thaler, selon laquelle il est possible de modifier des comportements des personnes d’une manière prévisible, sans pour autant les restreindre ou les forcer dans leurs choix.
3 En réalité, depuis 2009, le président Obama s’appuyait sur les conseils d’une équipe dirigée par Cass Sunstein.
Thème : Covid-19
Mots-clés : Psychologie
Publié dans le n° 333 de la revue
Partager cet article
L' auteur

Sebastian Dieguez
Chercheur en neurosciences au Laboratoire de sciences cognitives et neurologiques de l’université de Fribourg en Suisse.
Plus d'informationsCovid-19

Science, expertise et décision à l’épreuve de la pandémie de Covid-19
Le 15 juillet 2020
Covid-19, hydroxychloroquine et traitement médiatique
Le 9 janvier 2023
Mauvaises conduites et Covid-19
Le 11 octobre 2022
Restaurer l’intégrité scientifique après la crise Covid-19
Le 4 octobre 2022Communiqués de l'AFIS









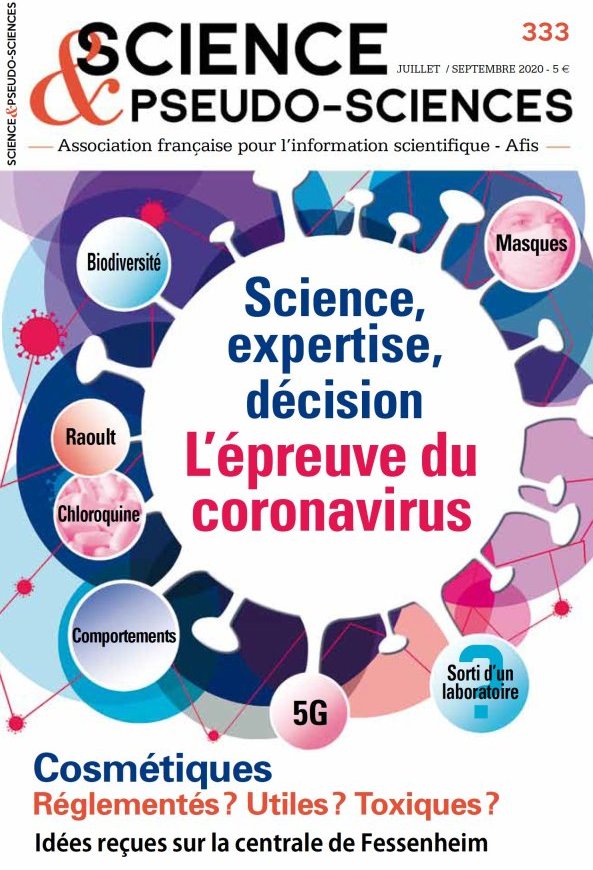





![[16 juin 2022 - Paris] Covid-19 : Deux ans d'épidémie, qu'avons-nous appris ?](local/cache-gd2/0f/33c69087dceb597afeb0e562895a7f.jpg?1675291840)