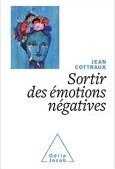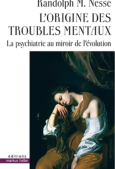La mémoire manipulée - L’audition des témoins perturbée par les croyances et le sens commun
Publié en ligne le 19 août 2015 - Psychologie -Sans formation et sensibilisation, nous sommes de piètres détecteurs du mensonge puisque nous ne faisons pas mieux que le hasard et l’apparent bon sens (pile ou face, soit une chance sur deux de nous tromper à la question « cette personne ment-elle ? »). Si nos performances sont aussi faibles, c’est avant tout parce que nous appuyons nos décisions sur nos croyances, sur nos représentations naïves, sur les mythes diffusés par des séries télévisées. Mais nos croyances sont très souvent en décalage notable avec la réalité. En d’autres termes, nous décidons selon des éléments non pertinents, ce qui explique nos échecs.
L’impact néfaste des connaissances naïves (c’est-à-dire des connaissances construites lors d’interactions sociales, de pratiques quotidiennes, etc. et n’ayant pas fait l’objet d’un apprentissage portant sur des observations scientifiques) se retrouve dans des domaines fondamentaux de l’enquête judiciaire, comme l’audition des témoins et victimes de bonne foi. Le fondement de l’entretien judiciaire est l’exploitation de la mémoire humaine : une personne va rechercher ses souvenirs pour les livrer aux enquêteurs. Mais le fonctionnement optimal de la mémoire repose sur des principes qu’il convient de respecter afin de préserver la pertinence et la qualité des informations (précision, exactitude).
Des croyances ancrées chez les professionnels...
Cependant, de nombreuses études expérimentales réalisées en psychologie ont montré que, hormis chez les spécialistes, nos savoirs dans ce domaine sont éloignés de la réalité. À partir du questionnaire sur les connaissances relatives aux comportements des témoins (14 questions), Deffenbacher et Loftus (1982) [1] ont établi qu’environ 36 % seulement des réponses étaient correctes. Un an plus tard, Yarmey et Tressillian Jones (1983) [2] ont reproduit cette recherche avec différentes populations plus ou moins expertes dans le domaine de la mémoire : les professeurs d’université ont produit 77 % de réponses correctes, suivis par un groupe, uniforme dans leurs performances (pas de différences “significatives”) composé d’étudiants en droit (50 %), de professionnels du monde judiciaire (47 %), d’étudiants (42 %) et de novices (41 %). D’autres études ont toutes montré des résultats similaires, qu’elles aient concerné le lien entre la certitude affichée et l’exactitude de la reconnaissance, l’impact du stress, des violences, la procédure d’audition, la reconnaissance d’une personne appartenant à une ethnie différente, l’hypnose, la détection du mensonge, l’interprétation des preuves, etc.
Un fait troublant est toutefois apparu : très majoritairement, les professionnels du monde judiciaire ne sont pas plus protégés des mythes que les jurés potentiels ou les citoyens.

Par exemple, Wise et Safer (2004) [3] ont demandé à 160 magistrats de répondre selon leurs connaissances et sans aide extérieure à une quinzaine de questions portant sur les aspects essentiels du témoignage oculaire en général concernant la focalisation sur l’arme, le lien entre les performances mnésiques et le temps écoulé depuis le crime, etc. (« Lors d’un procès, la confiance d’un témoin oculaire est un bon prédicteur de l’exactitude de son identification de l’accusé comme auteur du crime »). Mais ils ont aussi demandé d’évaluer ce qu’un juré “standard” aurait répondu aux mêmes questions. Les auteurs ont constaté que plus de 80 % des juges ont répondu faux à environ 80 % des questions (en moyenne 3 réponses correctes sur 14 pour 80 % d’entre eux). Et le nombre d’années d’expérience en tant que procureur ou juge ou avocat ne modifie en rien les connaissances. Mais le plus étonnant est que les professionnels ont sous-estimé notablement les supposées connaissances possédées par les citoyens-jurés. Par exemple, ils ont été 69 % à déclarer, avec justesse, que l’arme focalisait l’attention d’une victime (et donc nuisait à la qualité du récit futur), mais ont considéré que seuls 24 % des jurés ont connaissance d’un tel phénomène, ce qui est bien en deçà des résultats observés par Yarmey et Tressilian Jones (1983) [2].
Globalement, toutes les professions gravitant autour de la résolution des crimes présentent des caractéristiques similaires, que l’on parle des enquêteurs, des avocats, voire – et c’est encore plus troublant – des experts des différents domaines (par exemple Kassin, Tubb, Hosch, & Memon, 2001) [4]. En l’absence de connaissances précises issues de travaux scientifiques ou d’évaluations rigoureuses aboutissant à des formations professionnelles, l’activité des enquêteurs ou de toute personne qui pratique des entretiens ou des auditions (recruteurs, médecins, journalistes, etc.) se construit à partir des croyances ou connaissances naïves par rapport à ce que l’on estime efficace ou non.
Des croyances qui éloignent de l’expertise

Il est pourtant facile de supposer que les professionnels pourraient, par autocorrection et avec un apprentissage de type essais-erreurs au vu du nombre d’expériences et de situations variées rencontrées, accéder à des pratiques plus performantes. Cependant, rappelons que Wize et Safer (2004) [3] et d’autres chercheurs n’ont jamais mis en évidence le moindre lien entre le nombre d’années passées dans l’activité et les compétences dans une tâche. En effet, en l’absence de retour sur la justesse ou l’exactitude d’une pratique, l’amélioration des performances est compromise. Pour se corriger, il faut d’abord prendre conscience que l’on fait une erreur. Sans cela, la pratique reste bloquée à un niveau « naïf », présentant de nombreux décalages avec la pratique optimale et interdisant aux professionnels d’accéder à des niveaux élevés de performances. L’absence de connaissances fiables est également le terreau idéal pour tous les sens communs fondés sur le rappel d’anecdotes, sur l’observation d’un cas marquant mais isolé et jamais ré-observé (l’un des critères définissant les pseudosciences), dont on sait qu’ils conduisent à des préjugés et des généralisations.
Ceci rejoint d’ailleurs les travaux menés par Cochran, Weiss et Shanteau, les créateurs de l’indice CWS [17], concernant les performances des experts. Ils définissent et montrent qu’un expert n’est pas une personne qui a de l’expérience, du talent, de l’entraînement, ou une aisance dans la discipline, ou qui, pour diverses raisons plus ou moins valables, est médiatiquement importante. Pour eux, la notion d’expert ou plutôt d’expertise renvoie à un comportement, un savoir, et non à une personne. Quelqu’un peut tout à fait exceller dans un domaine et n’avoir aucune compétence dans un domaine proche. Mais le plus important est que l’expertise se définit avant tout par rapport à la maîtrise des dernières connaissances, impliquant, de fait, leur mise à jour permanente. Ainsi, une personne jeune, qui sort de l’université, peut tout à fait être considérée comme experte si elle maîtrise les derniers savoirs.

Et cette maîtrise la conduira, pour une même situation, à toujours donner les mêmes solutions et réponses (constance), et, pour des situations différentes, à différencier ses avis (discrimination). Au contraire, une personne avec de l’expérience mais des connaissances anciennes pourrait, au vu de ces deux critères, ne pas être qualifiée d’experte (et ne le devrait pas…).
La notion d’expertise doit s’appliquer également à la discipline ou à la pratique concernée. Une discipline ou une pratique experte est définie selon les mêmes critères de constance (tous les experts, selon les connaissances de leur communauté scientifique, donnent une même réponse face à un même cas) et de discrimination (tous les experts, selon les connaissances de leur communauté scientifique, doivent être capables de distinguer des cas différents). Mais l’application stricte de l’un et l’autre de ces deux critères exclut de fait certaines professions pourtant régulièrement appelées à la barre (ou susceptibles de l’être), au premier rang desquelles figurent la psychologie clinique “classique”, le profilage criminel, la graphologie “personnalisante” et, surtout, la psychanalyse et ses dérivés.
Il en va de même pour l’ensemble des outils de mesure de la personnalité, puisqu’ils présentent – à quelques rares exceptions près – des qualités métrologiques proches du mètre élastique (quasi-absence de la réplication des mesures dans une fourchette acceptable, très forte sensibilité à l’auto-présentation et au contexte, etc. ; consulter [5] pour une présentation des faiblesses inhérentes à l’un des outils les plus utilisés et renommés) et qu’ils ne sont reliés que très faiblement à des dimensions plus susceptibles d’intéresser directement les magistrats (par exemple, la probabilité de récidive, la capacité de réinsertion, etc.) [6] [7]. Ceci réduit d’autant plus leurs performances prédictives. Leur utilisation comme, celle d’autres disciplines et méthodes, risque donc de nuire à la capacité de discernement du magistrat, en introduisant des paramètres et éléments peu, voire pas, pertinents pour sa prise de décision.
L’entretien n’est pas une pseudoscience
L’expertise est donc caractérisée avant tout par la maîtrise des plus récentes connaissances scientifiques et, en corollaire, par l’évitement impérieux de l’appel aux pseudosciences (par exemple, psychanalyse, profilage, graphologie, etc.). Au sujet de ces dernières, Scott Lilienfield et Kristin Landfield ont recensé en 2008 les dix critères d’alerte qui permettent aux professionnels de la Justice de les détecter [8] (cf. tableau). On trouve notamment l’absence de réfutabilité (Popper, 1959) [9] – l’une des principales critiques faites à la psychanalyse – (critère n°1), l’absence voire l’impossibilité d’examen des résultats par les pairs (critère n°2), aucune auto-correction des connaissances (pas de « sélection naturelle » des théories les plus faibles et les moins documentées, critère n°3), l’absence de protections contre le biais de confirmation (habitude à ne retenir dans nos décisions que les éléments qui supportent notre point de vue et à minimiser, ignorer ou distordre ce qui ne le supporte pas, critère n°4), ou encore l’appel à la tradition (arguments ad antequitem, « on a toujours fait comme ça… », critère n°7).
selon Lilienfeld et Landfield [1]
- Absence de réfutabilité. Toute hypothèse doit pouvoir être infirmée. Cela doit conduire à une modification du contenu de la théorie et augmenter son pouvoir prédictif.
- Absence d’expertise par les pairs. Bien que n’étant pas infaillible, l’expertise par les pairs constitue une manière d’évaluer les qualités intrinsèques d’une recherche. Il faut les opposer aux recherches réalisées et évaluées par un seul chercheur ou équipe et publiée sans regard extérieur.
- Absence d’auto-correction. Les sciences et les connaissances scientifiques évoluent au cours du temps. Elles se corrigent. Par exemple, l’astrologie n’est pas une science car ses principes vieux de près de 4000 ans sont toujours appliqués sans aucune modification.
- Absence de protection contre le biais de confirmation. La science nécessite de considérer tant les résultats qui confirment une théorie que ceux qui l’infirment.
- Surestimation de l’importance des anecdotes et des faits isolés. Déclarer qu’une méthode ou une technique ont été utiles dans un cas ne peut pas amener à conclure à une efficacité, mais doit seulement inciter à systématiser les recherches dans ce domaine.
- Déclarations extravagantes. La recherche et la science sont des prescriptions pour l’humilité. Les conclusions ne sont que ponctuelles et sont susceptibles d’être remises en cause un jour ou l’autre.
- Appel à la tradition. Le fait qu’une pratique ou une connaissance soit ancienne n’en garantit pas l’exactitude.
- L’inversion de la charge de la preuve. C’est au tenant d’une hypothèse d’en démontrer la pertinence et la véracité, pas à ceux qui la contredisent (par exemple, les sceptiques). Et une hypothèse ne peut pas être considérée comme vraie simplement parce que l’on n’a pas encore pu montrer son inexactitude.
- Absence de liens avec d’autres disciplines scientifiques. La science est cumulative. La construction de la connaissance se fait par ajouts successifs. Mais les pseudosciences existent souvent isolément des autres disciplines, signifiant qu’elles n’intègrent pas les connaissances antérieures pour se construire.
- Utilisation de termes très techniques, de jargons ou de néologismes. Un vocabulaire difficile à comprendre ne garantit pas la véracité des déclarations et des connaissances. Des nouveaux termes ou concepts sont acceptables dès qu’ils renvoient à des notions intelligibles. Un jargon spécialisé peut donner l’impression d’une autorité dans une discipline, mais n’en garantit pas la légitimité scientifique.
1 | Lilienfeld, S. O., & Landfield, K. (2008). “Science and pseudoscience in law enforcement : A user-friendly primer”. Criminal Justice And Behavior, 35(10), 1215-1230.
Au vu de ces éléments, peut-on considérer que l’activité d’audition des témoins et victimes repose sur des connaissances scientifiques et qu’elle est une activité experte ? Rappelons qu’elle repose avant tout sur l’exploitation de la mémoire humaine, c’est-à-dire l’un des domaines de recherche les plus étudiés en psychologie et médecine (la simple utilisation du mot-clé « memory » dans les principales bases de données bibliographiques renvoie à près de 400 000 occurrences.). Concernant les méthodes d’entretien spécifiquement destinées à recueillir les souvenirs des témoins – et notamment l’entretien cognitif –, elles ont fait l’objet de plus de 400 publications scientifiques dans des revues à comité de lecture (critères n°1 et n°2 de Lilienfield & Landfield, 2008 [8]), avec parfois des débats âpres concernant entre autres la validité des groupes contrôles (critère n°4).

L’entretien cognitif : une méthode experte
La méthode de l’entretien cognitif a été créée en 1984 par deux chercheurs nord-américains, Edward Geiselman et Ronald Fisher [10] (pour une version française, consulter Demarchi & Py, 2006) [11]. Ils ont notamment pris le contrepied des techniques antérieures qui reposaient essentiellement sur la conduite de l’entretien par l’enquêteur (critère n°7). Les auteurs ont, contrairement à l’habitude, donné une place centrale au témoin, car lui seul possède les informations recherchées. Il faut donc éviter de perturber son souvenir, notamment en l’interrompant fréquemment. Par ailleurs, ces versions permettent, dès lors que le protocole est suivi rigoureusement, d’éviter les mauvaises interprétations des propos des témoins et d’empêcher les biais de confirmations d’hypothèses [12]. Ces erreurs sont supprimées parce que l’activité des enquêteurs (en termes de temps et de volume de paroles) est réduite au minimum et guidée par les seuls propos du témoin. Le protocole, fondamentalement non directif, préconise l’utilisation des récits spontanés et non interrompus, l’emploi de mnémotechnies destinées à faciliter la restitution des souvenirs afin d’avoir à poser le moins de questions possible, et ainsi éviter la survenue accidentelle de questions dirigées et négatives qui orientent la mémoire des déposants selon les préconceptions des enquêteurs. La structuration de ce protocole empêche ainsi l’expression des croyances et des mythes qui gravitent autour de la mémoire humaine et de la restitution des souvenirs, et de leur corollaire que sont les pratiques naïves contreproductives [13] [14].
Depuis, la version originale a fait l’objet de nombreuses mises à jour et adaptations en fonction des connaissances nouvellement acquises et des observations de terrain (critère n°3). Les versions récentes ont été testées de nombreuses fois en laboratoire et par des professionnels, et des bénéfices importants en termes de complétude et d’exactitude des souvenirs ont été constatés. Il ne s’agit donc pas d’un artefact ou d’une amélioration anecdotique (critère n°5) [15] [16]. Pour une description du protocole de ce type d’entretien, voir La mémoire manipulée - Les faux souvenirs dans les entrevues d’enquête auprès des témoins ou victimes
Au vu de la constance des résultats expérimentaux (laboratoire, études de terrain, étude en situations réelles), un consensus s’est établi dans la communauté scientifique autour de cette méthode dès lors qu’il s’agit d’auditionner des témoins ou des victimes, y compris celles et ceux présentant des particularités (personnes âgées, enfants, déficients mentaux). L’utilisation de l’entretien cognitif garantit une amélioration de la complétude et de la qualité des discours par rapport à des méthodes standards d’audition, ou des méthodes plus difficiles à mettre en œuvre comme l’hypnose. Cette dernière présente notamment un risque accru de suggestions chez les témoins et victimes, ce qui rend son utilisation plus hasardeuse (et donc moins experte). Un examen approfondi de la littérature permet également d’identifier d’autres protocoles – souvent français –, mais ceux-ci sont toujours le fait d’une équipe isolée qui présente ses constats empiriques et sans appuyer les arguments de résultats d’études scientifiques, ce qui est loin des critères signant l’expertise...
1 | Deffenbacher, K. A., & Loftus, E. F. (1982). “Do jurors share a common understanding concerning eyewitness behavior ?”. Law And Human Behavior, 6(1), 15-30.
2 | Yarmey, A. D., & Tressillian Jones, H.P. (1983). “Accuracy of memory of male and female eyewitnesses to a criminal assault and rape”. Bulletin of the Psychonomic Society 21 (2) :89-92.
3 | Wise, R. A., & Safer, M. A. (2004). “What US Judges Know and Believe About Eyewitness Testimony.” Applied Cognitive Psychology, 18(4), 427-443.
4 | Kassin, S. M., Tubb, V. A., Hosch, H. M., & Memon, A. (2001). “On the ‘general acceptance’of eyewitness testimony research : A new survey of the experts.” American Psychologist, 56(5), 405-416.
5 | Azar, B. (2008, July/August).“ IAT : Fad or fabulous ?” Monitor on Psychology, 39(7), 44.
6 | Babchishin, K. M., Nunes, K. L., & Kessous, N. (2014). “A multimodal examination of sexual interest in children : A comparison of sex offenders and nonsex offenders”. Sexual Abuse : Journal Of Research And Treatment, 26(4), 343-374.
7 | Nunes, K. L., Firestone, P., & Baldwin, M. W. (2007). “Indirect assessment of cognitions of child sexual abusers with the Implicit Association Test”. Criminal Justice And Behavior, 34(4), 454-475.
8 | Lilienfeld, S. O., & Landfield, K. (2008).“ Science and pseudoscience in law enforcement : A user-friendly primer”. Criminal Justice And Behavior, 35(10), 1215-1230.
9 | Popper, K. R. (1959). The logic of scientific discovery. Oxford, England : Basic Books.
10 | Geiselman, R. E. (1984). “Enhancement of eyewitness memory : An empirical evaluation of the cognitive interview”. Journal Of Police Science & Administration, 12(1), 74-80.
11 | Demarchi, S., & Py, J. (2006). « L’entretien cognitif : son efficacité, son application et ses spécificités ». Revue Québécoise de Psychologie, 27, 177-196.
12 | Launay, C., & Py, J. Méthodes et objectifs de l’audition des témoins adultes : Analyse des pratiques professionnelles [Methods and aims of investigative interviewing of adult witnesses : An analysis of professional practices]. Pratiques Psychologiques.
13 | Blank, H., & Launay, C. (2014). “How to protect eyewitness memory against the misinformation effect : A meta-analysis of post-warning studies.” Journal of Applied Research in Memory and Cognition, 3, 77-88.
14 | Ginet, M., Colomb, C., Wright, D., Demarchi, S., & Sadler, C. (2013). “Back to the Real : Efficacy and Perception of a Modified Cognitive Interview in the Field”. Applied Cognitive Psychology, 27, 2-8.
15 | Köhnken, G., Milne, R., Memon, A., & Bull, R. (1999). “A meta-analysis on the effects of the Cognitive Interview”. Special Issue of Psychology, Crime, &Law, 5, 3-27.
16 | Memon, A., Meissner, C. A., & Fraser, J. (2010). “The Cognitive Interview : A meta-analytic review and study space analysis of the past 25 years.” Psychology, Public Policy, And Law, 16(4), 340-372.
17 | http://www.k-state.edu/psych/cws/ (disponible sur archive.org—31 mai 2020)
Le psychologue et neurologue suisse Édouard Claparède (1873-1940) a mené auprès de ses étudiants des expériences pionnières, alors qu’il enseignait à la Faculté de Droit de Genève. Elles sont décrites par Roger Mucchielli dans son livre L’observation psychologique et psychosociologique (ESF Editeur, 1996). Nous nous inspirons ici très largement de cet ouvrage.

La mémoire des locaux de l’université
L’une des ces expériences consistait à poser à ses étudiants une vingtaine de questions relatives aux locaux de l’Université. Par exemple : « Y-a-t-il une fenêtre donnant sur le corridor de l’Université à gauche en entrant par la porte des Bastions ? Quelle est la couleur des rideaux de cette fenêtre ? », « Les colonnes du vestibule du premier étage de la Faculté sont-elles rondes ou carrées ? Quel est le nombre de ces colonnes ? » ou encore,
« Quelle est la distance en mètres qui sépare les deux ailes de l’Université ? ».
Sur 54 étudiants qui ont répondu au questionnaire, aucun n’a été capable de produire un témoignage entièrement correct. Ceux qui fréquentaient la Faculté depuis longtemps ne se sont pas montrés plus performants que les étudiants arrivés en début de semestre. À propos de la question relative à la fenêtre du corridor, 44 des 52 étudiants qui ont répondu ont nié l’existence de cette fenêtre (pourtant bien réelle). Exemple de témoignages concordants mais erronés.
Dans son ouvrage, Roger Mucchieli rapporte également la nette tendance à surévaluer les petites grandeurs et sous-évaluer les grandeurs importantes.
Témoin d’un incident préfabriqué (1905)
Un individu masqué fait irruption dans la salle de cours et se met à gesticuler en proférant des paroles incompréhensibles. Édouard Claparède lui ordonne, sans succès, de quitter les lieux. L’enseignant le mettra alors par lui-même dehors. L’intermède durera au total une vingtaine de secondes. Quelques jours après, Édouard Claparède revient sur l’incident en posant à ses étudiants diverses questions (sur les événements qui se sont déroulés, sur la durée de l’incident, sur les habits de l’intrus, etc.). Bien entendu, l’intrus était un comparse et l’incident avait été entièrement fabriqué.
Sur 12 questions posées, les étudiants ne savent répondre qu’à 7,7 questions en moyenne. Les descriptions de l’intrus sont très variables et parfois bien peu concordantes avec la réalité. Certains se souviennent d’un chapeau de paille (alors qu’il portait un chapeau mou), d’un pantalon à carreaux (alors qu’il avait un pantalon foncé, presque caché par une blouse en toile grise). Si les deux tiers des étudiants ont bien observé le port d’un foulard, un nombre significatif l’a vu rouge alors qu’il était brun clair et blanc. Une majorité va nier qu’il portait des gants blancs (alors que c’était bien le cas). Pour Édouard Claparède, ces erreurs s’expliquent en partie par la perception globale de l’individu : c’est un trublion, un voyou... Dans l’imaginaire des étudiants, de tels individus portent plutôt des foulards rouges et n’ont pas de gants blancs.
Publié dans le n° 312 de la revue
Partager cet article
L' auteur

Samuel Demarchi
Samuel Demarchi est maître de conférences dans le Laboratoire Parisien de Psychologie Sociale (EA4386) de (...)
Plus d'informationsPsychologie

Avez-vous parfois l’impression d’être observé ?
Le 27 décembre 2023
Histoire de la « psychothérapie centrée sur la personne »
Le 22 décembre 2023















![[Grenoble – 19 mars 2024 de 18h30 à 20h30] Mémoire retrouvée ou faux-souvenirs : la controverse](local/cache-gd2/79/419cf1f740c4bc59f2c1f9602683c5.png?1709235433)