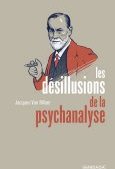Le freudisme et les rationalismes
Publié en ligne le 15 février 2008 - Psychanalyse -Texte remanié d’une conférence donnée à l’Union rationaliste de Lyon, le 21 octobre 2006, et au Laboratoire de zététique de Grenoble, le 23 mars 2007.
Il y a une trentaine d’années, René Zazzo, un des plus éminents psychologues du XXe siècle, organisait un colloque de l’Union Rationaliste sur le thème « Psychanalyses et rationalisme ». Les communications ont été publiées dans Raison Présente en 1978. Dans le titre du colloque, le mot « psychanalyse » était au pluriel. Zazzo, dans son exposé, mettait l’accent sur » la diversité des écoles » de psychanalyse.
Dans la communication qui suivait celle de Zazzo, le psychanalyste Didier Anzieu employait le terme « psychanalyse » au singulier, comme synonyme de « freudisme ». Dans son exposé, intitulé « Rationalité dans la théorie et dans la pratique de la psychanalyse », il commençait par dire que « tout au long de sa vie, Freud fut un homme profondément rationaliste » (p. 9). Ensuite, il évoquait la psychanalyse jungienne, pour aussitôt la décrier aux yeux des rationalistes auxquels il s’adressait. Il disait : « Freud a été profondément rationaliste. Si l’on doit évoquer la première scission à avoir eu lieu dans le monde psychanalytique, c’est celle qui se produisit entre Freud et Jung. Et il importe de préciser qu’indépendamment de la dévaluation de la sexualité par Jung celui-ci était occultiste, végétarien, mystique. Ce profil — pour rapide qu’il soit — est aux antipodes de celui de Freud et montre suffisamment que Jung était voué à la marginalité par rapport à la psychanalyse conçue comme science » (p. 11).
Cette présentation d’Anzieu est un échantillon typique de la manière dont les freudiens font l’histoire de la psychanalyse. Anzieu sélectionne et interprète des faits de façon à faire croire que Freud a créé une véritable « science » et qu’il en est l’incarnation. Cette présentation hagiographique appelle au moins quatre remarques.
1. La première scission dans la saga freudienne n’est pas l’exclusion de Jung en 1913 mais, deux ans plus tôt, celle d’Alfred Adler, qui allait alors fonder, avec d’autres psychanalystes de la première génération, la « Société pour la libre recherche psychanalytique ». L’objectif déclaré de cette société concurrente à celle de Freud était, selon les mots d’Adler, de « respecter les principes fondamentaux de la recherche scientifique », notamment le fait de « ne pas être lié par certaines formules et de ne pas être empêché de rechercher de nouvelles solutions. » (cité par Borch-Jacobsen & Shamdasani, 2006, p. 123)
2. Jung ne « dévaluait » pas la sexualité. Simplement, il refusait d’expliquer tout trouble mental par la sexualité, ce que Freud faisait à l’époque et a continué à faire jusqu’à la fin de sa vie. Faut-il rappeler que, dès 1896, celui-ci écrivait que « Le résultat le plus important auquel on arrive en poursuivant l’analyse de façon conséquente est celui-ci : de quelque cas et de quelque symptôme que l’on parte, on finit toujours immanquablement au domaine de l’expérience sexuelle » (1896b, p. 434). Dans son dernier livre, quarante-trois ans plus tard, il répétait : « Les symptômes névrotiques sont dans tous les cas soit la satisfaction substitutive d’une tendance sexuelle, soit des mesures pour l’entraver ou encore, cas les plus fréquents, un compromis entre les deux » (1940, XVII, p. 112).
3. Anzieu souligne que Jung était « occultiste » et « végétarien ». Que Jung était végétarien est sans doute un fait peu significatif. En tout cas, ce n’est pas un trait caractéristique d’irrationalisme. Par ailleurs, Freud, comme bien d’autres « psys » de son époque, était intéressé par l’occultisme et il a été toute sa vie un homme superstitieux. Sur la question des superstitions de Freud et de son intérêt pour l’occultisme, je renvoie à l’ouvrage, très bien documenté, de Jacques Bénesteau, Mensonges freudiens, qui y consacre un long chapitre (2002, p. 101-120).
4. Enfin, il est simpliste de faire du freudisme une « science » et de considérer les autres formes de psychanalyse comme irrationnelles et « marginales ». Anzieu, en mettant en avant la rupture de Freud avec Jung — qu’il qualifie de « mystique » —, présente le premier comme un vrai rationaliste. À y regarder de près, si l’on compare Freud à Adler, le premier dissident — dont Anzieu se garde de rappeler l’existence —, on peut dire que la théorie de Freud s’apparente plutôt à la philosophie romantique et à l’irrationalisme, tandis que celle d’Adler s’apparente à la philosophie des Lumières et au rationalisme. C’est la conclusion du plus célèbre des historiens de la psychiatrie, Henri Ellenberger, au terme d’une comparaison minutieuse des deux théories (1970/1974, p. 538).
Je voudrais développer ici les idées suivantes : Freud se pensait comme un rationaliste. En certains sens, il l’était assurément, notamment dans sa critique des croyances religieuses. Toutefois, sa volonté de rationalisme ne l’a pas préservé d’utiliser des méthodes pseudo-scientifiques. En fin de compte, le freudisme a contribué à développer certaines formes d’irrationalité et a sapé la foi dans l’importance de la démarche scientifique.
1. « Freudisme » et « psychanalyse »
Avant de développer ces points, je m’explique sur l’utilisation du mot « freudisme », plutôt que « psychanalyse ». C’est une question riche d’enseignements pour juger du degré de scientificité de la pensée freudienne. La citation d’Anzieu en est une bonne introduction.
Freud a commencé à faire ce que nous appelons aujourd’hui de la « psychothérapie » à partir de 1886. Il a d’abord désigné son activité par les expressions « hypnose », « traitement psychique » (Psychische Behandlung) et « traitement de l’âme » (Seelenbehandlung). Il a ensuite parlé d’« analyse psychique » et d’« analyse psychologique » (1895). Cette dernière expression, faut-il le rappeler, est celle d’un Français, Pierre Janet, qui l’a utilisée dès la fin des années 1880, pour désigner l’étude détaillée de la vie d’un individu. Lorsque Freud, en 1896, emploie pour la première fois le mot « psycho-analyse », il s’inspire fort probablement de l’expression « analyse psychologique » de Janet. Fait particulièrement intéressant, il désigne par ce mot « le procédé explorateur de J. Breuer » (1896a, p. 416). En effet, jusque dans les années 1910, le terme « psychanalyse » a été utilisé pour désigner diverses formes de psychothérapies centrées sur les propos des patients et, plus particulièrement, la méthode attribuée à Joseph Breuer. Par exemple, le psychiatre suisse Ludwig Frank a publié, en 1910 à Munich, un ouvrage intitulé Die Psychanalyse, où il critiquait « la déviation » que constitue la psychanalyse de Freud par rapport à la vraie psychanalyse, celle de Breuer. Frank reprochait à Freud notamment l’importance attribuée au facteur sexuel (voir Borch-Jacobsen & Shamdasani, 2006, p. 116).
Notons que Frank et d’autres psychiatres suisses germanophones, comme Auguste Forel et Dumeng Bezzola, écrivaient « Psychanalyse » sans « o » et se moquaient quelque peu de Freud, qui semblait ignorer les règles de la formation des mots composés à partir du grec. En effet, en allemand comme en français, on ne dit pas « psychoiatre » mais « psychiatre », on ne dit pas « psychoasthénique » mais « psychasthénique » (id., p. 95). Il faut donc dire, en allemand comme en français, « Psychanalyse » et non « Psychoanalyse ».
Jusqu’aux environs de 1910, Freud n’avait pas d’objection à l’utilisation du mot « psychanalyse » — avec ou sans « o » — par d’autres psychothérapeutes que lui. Lorsqu’il fut invité à parler à l’université Clark en 1909, il commença sa présentation en disant : « Ce n’est pas à moi que revient le mérite — si c’en est un — d’avoir fait naître la psychanalyse. Je n’ai pas participé à ses débuts. J’étais encore étudiant, absorbé par la présentation de mes derniers examens, lorsqu’un médecin viennois, le Dr. Joseph Breuer, appliqua pour la première fois ce procédé à une jeune fille souffrant d’hystérie (1880-1882). Nous devons donc nous occuper d’abord de l’histoire de cette malade et de son traitement » (1910a, p. 3).
Freud est-il un homme modeste, qui admet qu’il ne fait que prolonger la conception de Breuer ? Nullement. Faut-il rappeler qu’il s’est autoproclamé l’auteur de la troisième grande révolution intellectuelle de l’Humanité, après celle de Copernic — la « vexation cosmologique » — et celle de Darwin — la « vexation biologique ». Freud a dit de lui-même qu’il a infligé à l’Humanité « la plus sensible des blessures narcissiques » : la « vexation psychologique », c’est-à-dire la démonstration que « le moi n’est pas maître dans sa propre maison » (1917b, p. 11). S’il déclarait encore en 1909 que Breuer est le créateur de la psychanalyse, c’est parce que c’est l’opinion de ses confrères et probablement aussi la sienne.
Dans les années 1910, Freud va être de plus en plus connu et de plus en plus contesté, y compris par de proches collègues et amis, comme Adler, Jung et Stekel. C’est à cette époque qu’il va s’employer à faire du terme « psychanalyse » sa propriété et à paraître le maître souverain d’une nouvelle discipline, le seul à pouvoir décider de son contenu. Alors qu’il déclarait en 1909, « Ce n’est pas à moi que revient le mérite d’avoir fait naître la psychanalyse », il écrira en 1914 : « La psychanalyse est ma création. Pendant dix ans j’ai été le seul à m’en occuper. (...) Personne ne peut, mieux que moi, savoir ce qu’est la psychanalyse, en quoi elle diffère d’autres modes d’exploration de la vie psychique et ce qui doit être désigné par son nom » (1914, p. 44). Alors qu’il racontait quelques années plus tôt que le traitement d’Anna O par Breuer était la première application de la psychanalyse, Freud souligne désormais ce qui différencie sa méthode de celle de Breuer. Dans des conversations avec des confrères qu’il jugeait alors fiables, notamment Jung et Ferenczi, il fait tout pour discréditer Breuer et va même jusqu’à dévoiler qu’Anna O n’avait pas du tout été guérie ! (voir Ellenberger, 1970 ; Borch-Jacobsen, 2005 ; Borch-Jacobsen & Shamdasani, 2006, p. 123).
En 1909, Forel, le professeur de psychiatrie de Zürich, fonde la Société internationale de psychologie médicale et de psychothérapie dans le but de promouvoir la psychothérapie d’orientation scientifique et de lutter contre les magnétiseurs et les charlatans. Il propose à Freud et à Jung d’en faire partie. Freud réagit en créant l’année suivante sa propre société, l’Association internationale de psychanalyse, en vue, dit-il, de faire barrage aux « analystes sauvages ». Il déclare à cette occasion : « La psychanalyse ne peut pas être apprise dans les livres et assurément elle ne peut être trouvée qu’au prix de grands sacrifices de temps, d’efforts et de succès. » (1910b, p. 124) « Il n’est agréable ni à moi ni à mes amis et collaborateurs de monopoliser le droit à l’exercice d’une technique médicale. Mais face aux dangers que la pratique prévisible d’une psychanalyse “sauvage” entraîne pour les malades et pour la cause de la psychanalyse, il ne nous restait rien d’autre à faire. (…) En vérité, c’est bien à la cause, plus qu’à tel ou tel malade, que nuisent les analystes sauvages. » (id., p. 125) Notons bien la dernière phrase : en créant son association, Freud a moins le souci de protéger des patients, que sa « cause », contre les « analystes sauvages », c’est-à-dire ceux qu’il n’a pas lui-même autorisés à porter le titre de psychanalyste. Il veut monopoliser à son profit le terme « psychanalyse » qu’utilisaient également des confrères qui n’avaient pas la même théorie, ni la même technique que lui.
À ma connaissance, Janet, qui a forgé l’expression « analyse psychologique » et qui savait ce qu’est l’esprit scientifique, n’a jamais déclaré que lui seul pouvait codifier ce qu’on entend par cette expression. Frederik van Eeden et A. W. van Renterghem, les médecins hollandais qui semblent être les premiers à avoir utilisé le mot « psychothérapie » (Ellenberger, 1970/1974, p. 625), n’ont pas affirmé que personne ne pouvait, mieux qu’eux, savoir ce qu’est la psychothérapie et ce qui doit être désigné par son nom. On imagine difficilement qu’Auguste Comte, qui a forgé le mot « sociologie » (en 1830), ait affirmé être le seul à pouvoir réglementer l’utilisation de ce terme.
À partir des années 1910, Freud et les disciples restés fidèles ont tout fait pour que le mot « psychanalyse » ne désigne que la seule doctrine freudienne. N’empêche : le terme va être utilisé par d’autres psys, pour désigner la recherche d’explications psychologiques de comportements, de phénomènes sociaux et de productions culturelles. En 1920, Ernest Jones, un des élèves toujours fidèles au maître, s’en désole. Il écrit au Comité secret (destiné à veiller à l’orthodoxie freudienne et composé de cinq disciples fiables réunis autour de Freud) : « Sur la base de divers rapports que j’ai eus dernièrement d’Amérique et de la lecture de la littérature récente, je suis au regret de dire que j’ai une très mauvaise impression de la situation là-bas. Tout et n’importe quoi passe pour de la psychanalyse, pas seulement l’adlérisme et le jungisme, mais n’importe quelle sorte de psychologie populaire ou intuitive. Je doute qu’il y ait six personnes en Amérique qui puissent dire quelle est la différence essentielle entre Vienne et Zurich, du moins clairement. » (cité dans Borch-Jacobsen & Shamdasani, 2006, p. 435) Récemment, Robert Wallerstein, le président de l’Association internationale de psychanalyse, écrivait : « Nous vivons dans un monde de diversité psychanalytique croissante, un monde de psychanalyses multiples (et divergentes), avec des frontières traçables de façons conceptuellement divergentes, ce qui bien sûr rend difficile d’établir une distinction d’ensemble entre psychanalyse et psychothérapie. » (id., p. 439)
Que conclure sur l’usage du mot « psychanalyse » ?
1. Dans le grand public, mais aussi chez un certain nombre de psys, ce mot désigne à peu près n’importe quelle pratique psychothérapeutique. Dans un sens plus restreint, il désigne toute conception selon laquelle il y a un Autre à l’intérieur de nous et seuls ceux qui s’appellent psychanalystes sont habilités à le révéler. Pour les freudiens orthodoxes, « psychanalyse » ne peut désigner que la théorie et la pratique basées sur les textes freudiens, tout le reste n’étant que des conceptions abâtardies ou erronées.
2. Vu la polysémie du mot « psychanalyse », il est préférable d’utiliser des termes comme « freudisme », « lacanisme », « jungisme », « kleinisme », etc., que le terme générique. « Psychanalyse » et « freudisme » ne sont pas davantage synonymes que « christianisme » et « catholicisme romain ». L’éditeur de la collection « Que sais-je ? » a été bien inspiré en publiant d’une part « La psychanalyse » et d’autre part « Le freudisme ». Ici je me contenterai de parler du freudisme. Il ne sera guère question de Jung, d’Adler, de Stekel, de Rank, de Ferenczi et d’autres, dont les théories et méthodes peuvent parfaitement s’intituler « psychanalyse » quand bien même elles diffèrent plus ou moins fortement de celles de Freud. En effet, eux aussi font des « analyses psychologiques », eux aussi affirment qu’il y a un « Au-delà » en nous, qu’eux seuls sont capables de le comprendre et de le révéler. Le freudisme n’est qu’une des innombrables formes de psychanalyse.
3. À travers la lutte de Freud pour monopoliser l’utilisation d’un mot, nous constatons que Freud n’apparaît pas comme un rationaliste dans tous les sens du terme. Avant de préciser en quel sens lui et ses disciples sont rationalistes et en quel sens ils ne le sont pas, nous devons rappeler les diverses significations de ce terme.
2. Les rationalismes
Le Dictionnaire historique de la langue française d’Alain Rey (1992) nous apprend que le mot « rationaliste » a commencé par désigner, au XVIe siècle, un médecin qui suit un raisonnement, par opposition au médecin « empirique » dont la pratique se réduisait à une expérience personnelle sans formulation rationnelle. Le terme est recréé au XVIIIe siècle pour qualifier « un penseur ou une théorie qui prétend ne s’appuyer que sur la raison ».
Aujourd’hui, le mot « rationalisme » a de multiples acceptions. Je propose d’en distinguer cinq.
1. Pris dans son sens le plus large, ce terme désigne la conviction que la réflexion rationnelle est le meilleur moyen d’obtenir des connaissances valides. Ce type de rationalisme n’exclut pas d’autres formes de connaissances, même la foi religieuse, mais celles-ci sont considérées comme moins assurées. Selon cette acception, une bonne proportion d’intellectuels sont des rationalistes.
2. Une autre forme de rationalisme consiste à penser que la réflexion rationnelle est le seul moyen d’obtenir des connaissances sûres et que les données sensorielles ne peuvent fournir qu’une vue provisoire ou déformée de la vérité. Ce type de rationalisme a été éminemment représenté par René Descartes. Il s’oppose à l’empirisme ou à l’empiricisme, selon lesquels les connaissances valides reposent essentiellement sur l’observation et l’expérience sensible. John Locke en est un représentant bien connu de cette position. Karl Popper a proposé d’appeler « intellectualisme » ce type de rationalisme (1966/1979, p. 153). Notons que cet intellectualisme ne s’oppose pas par principe à des croyances religieuses. Ainsi Descartes, par l’exercice de sa raison, prétendait affirmer sa propre existence (« Je pense, donc je suis »), mais aussi celle de Dieu.
3. Une troisième forme de rationalisme consiste à penser sans aucun égard pour les vérités révélées et les sacro-saintes traditions. Elle est synonyme d’athéisme ou d’attitude antireligieuse.
4. Une forme moderne de rationalisme considère que la recherche scientifique est le seul moyen de produire des connaissances éprouvées. Elle est synonyme de « positivisme » ou de « scientisme ».
5. Une cinquième position est celle que Popper appelle le « rationalisme critique » (1966/1979, p. 153-173) et qui correspond à la position des Unions rationalistes d’aujourd’hui, en France et en Belgique par exemple. Ce rationalisme est en fait l’attitude de l’homme de science qui tente de résoudre autant de problèmes que possible par le recours au raisonnement, à l’observation méthodique et à l’expérimentation, mais qui demeure toujours ouvert à la critique et à la remise en question. Le rationaliste « critique » pense que le progrès des connaissances suppose la coopération et la confrontation des idées. Il ajoute que, pour que soit féconde la confrontation de théories, il importe de respecter des règles, en particulier : il faut s’abstenir d’utiliser des « stratégies immunisantes » qui protègent une théorie contre tout risque de réfutation.
En résumé, nous pouvons distinguer au moins cinq formes de rationalisme : le rationalisme au sens large (qui affirme simplement la prééminence de la raison), l’intellectualisme (comme épistémologie opposée à l’empirisme), l’athéisme, le scientisme et le rationalisme critique (qui se confond avec le véritable esprit scientifique). Ainsi on peut être rationaliste de multiples façons. On peut l’être dans un secteur de l’existence et non dans un autre.
3. En quels sens le freudisme est-il rationaliste ?
Freud est rationaliste selon les quatre premiers sens ici distingués. Il ne l’est pas selon le cinquième.
1. Freud a été largement inspiré par des philosophes, comme Schopenhauer, von Hartmann et Nietzsche, qui accordent une place centrale aux désirs, aux instincts, aux forces inconscientes. Pour lui, « Les hommes sont bien peu accessibles aux justifications rationnelles, ils sont entièrement dominés par leurs souhaits pulsionnels » (1927, p. 370, tr. p. 188). Néanmoins, il voit dans la raison le principal espoir pour l’avenir de l’humanité. Il écrit en 1933 : « L’intellect ou la raison est l’une des puissances dont on est le plus en droit d’attendre une influence unificatrice sur les hommes. (…) Notre meilleur espoir pour l’avenir, c’est que l’intellect — l’esprit scientifique, la raison — parvienne de haute lutte, avec le temps, à la dictature dans la vie d’âme humaine. » (1933, p. 185, tr. p. 256)
D’autre part, la façon dont Freud pratique la psychothérapie s’inscrit dans une perspective « rationaliste » de l’homme. Son fondement tient en ces deux propositions : les troubles mentaux résultent toujours de processus inconscients ; pour les faire disparaître, il suffit de les « analyser » et de décoder leur signification. Freud écrit, par exemple dans les Conférences d’introduction à la psychanalyse : « J’entends affirmer avec Breuer ce qui suit : chaque fois que nous sommes en présence d’un symptôme, nous pouvons en conclure qu’il existe chez le malade des processus inconscients déterminés qui justement contiennent le sens du symptôme. Mais il est nécessaire aussi que ce sens soit inconscient afin que le symptôme se produise. À partir
de processus conscients il ne se forme pas de symptômes ; dès que les processus inconscients en question sont devenus conscients, le symptôme doit disparaître. Vous reconnaissez ici, d’un seul coup, un accès à la thérapie, une voie pour faire disparaître des symptômes. C’est par cette voie que Breuer a de fait rétabli sa patiente hystérique, c’est-à-dire l’a libérée de ses symptômes ; il trouva une technique pour amener chez elle à la conscience les processus inconscients qui contenaient le sens du symptôme, et les symptômes disparurent. (1917a, p. 288s, tr. p. 289).
Soulignons toutefois le pessimisme de Freud quant à la possibilité de changer la condition de la majorité de ceux qui souffrent de troubles psychologiques. Alors qu’Adler par exemple écrivait des ouvrages destinés à aider tous ceux qui souhaitaient vivre mieux, Freud ne croyait pas à la possibilité de changements importants en dehors de sa technique, longue et coûteuse.
2. Freud est un rationaliste au sens 1 du terme. Il l’est également dans le deuxième sens. Il est, selon le vocabulaire de Popper, un « intellectualiste ». Certes, lui et ses disciples n’ont cessé de répéter que sa théorie est bâtie sur des « faits » empiriques, qu’il n’avait pas d’attentes préalables à ses observations cliniques. En réalité, Freud a très rapidement constitué le fondement de sa théorie, que nous venons de rappeler, sur la base de lectures de philosophes, comme Schopenhauer, et d’informations reçues de médecins, notamment Wilhelm Fliess et Joseph Breuer.
Dès le début de sa carrière « psy », Freud a bien davantage appliqué un schéma théorique qu’il ne s’est mis à l’écoute de ses patients sans a priori. C’est ce qu’ont clairement établi des historiens indépendants — c’est-à-dire non inféodés au Mouvement psychanalytique — comme Ellenberger (1970), Frank Sulloway (1979 ; 2005), Mikkel Borch-Jacobsen et Sonu Shamdasani (2006). C’est aussi le principal reproche énoncé par des confrères de Freud de son vivant. Déjà en 1901, son ami Wilhelm Fliess lui reprochait d’être un « lecteur de pensée (Gedankenleser) qui ne lit chez les autres que ses propres pensées. » (cité dans Freud, 1950, p. 358) Quelques années plus tard, Albert Moll, le célèbre psychiatre et sexologue, écrit : « Mon impression est que Freud et ses disciples basent les histoires de cas sur la théorie de Freud et non pas la théorie sur les histoires de cas. » (cité par Borch-Jacobsen & Shamdasani, 2006, p. 177) William James, le grand psychologue de Harvard, écrivait en 1909, après avoir entendu Freud à l’université Clark : « Freud et ses élèves ne peuvent manquer de jeter quelque lumière sur la nature humaine, mais j’avoue que personnellement il [Freud] m’a fait l’impression d’un homme obsédé par des idées fixes » (id.).
Une des principales légendes freudiennes, servant de pierre angulaire au freudisme, est que Freud aurait fait ses principales découvertes grâce à des auto-observations. Ernst Kris, qui signe l’introduction de la publication des lettres de Freud à Fliess, raconte que Freud a procédé à une auto-analyse longue, pénible et extrêmement féconde. Kriss répète ainsi, en 1950, ce que Freud et ses disciples ont commencé à affirmer à partir des années 1910, lorsque éclatèrent des conflits d’interprétation et de théorisation au sein du groupe des freudiens, et surtout après 1925, lorsque les freudiens décideront que, pour être reconnu « psychanalyste » par l’Association internationale, il faut effectuer une analyse didactique chez un analyste patenté. Freud n’ayant pas été psychanalysé, lui et ses disciples fidèles affirmeront alors qu’il s’est psychanalysé lui-même, un « travail » que lui seul était capable de réussir.
Lorsqu’on prend la peine de lire attentivement les lettres de Freud à Fliess — comme l’ont fait par exemple Sulloway (1979), Borch-Jacobsen et Shamdasani (2006) — on constate facilement trois faits : (a) l’auto-analyse de Freud a été fort brève : six semaines (du début octobre à la mi-novembre 1897) et non plusieurs années, comme cela sera raconté dans la légende freudienne ; (b) cette auto-analyse a été fort décevante selon Freud lui-même, du moins si l’on s’en tient à ce qu’il écrit à l’époque à Fliess (voir la lettre du 14 novembre 1897) et non à ce qu’il dira publiquement dix ans plus tard ; (c) last but not least, Freud n’a guère « découvert » de nouvelles lois psychologiques en analysant ses rêves, fantasmes, oublis et symptômes. Il a retrouvé en lui « le sentiment amoureux pour la mère et la jalousie pour le père », qu’il a lus dans Œdipe-Roi (lettre à Fliess, le 15-10-1897). Il a observé en lui ce qu’enseignait Griesinger — qu’il citera d’ailleurs (1900, p. 95) — à savoir que le rêve est « l’accomplissement d’un désir ». Ses idées sur le refoulement, les lapsus, le rôle pathogène de la répression sexuelle et bien d’autres, ces idées lui sont venues principalement de lectures, de cours qu’il a suivis et de conversations. Comme le dit Sulloway — un historien des sciences qui avait commencé à étudier les écrits de Freud en toute sympathie avec lui —, « cette auto-analyse compte parmi les plus grandes légendes de l’histoire des sciences » (cité par MBJ, p. 39).
3. Freud était rationaliste au troisième sens du terme : il était non-croyant, il était même athée militant. À la fin de sa vie, il écrivait : « Vous savez que le combat de l’esprit scientifique contre la vision du monde religieuse n’a pas pris fin, il se déroule encore sous nos yeux, dans le présent. Si peu que la psychanalyse fasse d’ordinaire usage de l’arme de la polémique, nous n’allons tout de même pas nous refuser de chercher à y voir clair dans cette dispute. » (1933, p. 182, tr., p. 253)
Freud a souvent dit que la religion est une « illusion nuisible ». Il lui reproche notamment de favoriser la mauvaise foi, l’inhibition de la pensée et des troubles névrotiques. Ainsi, dans L’avenir d’une illusion, il écrit : « Lorsqu’il s’agit de questions de religion, les hommes se rendent coupables de toutes les malhonnêtetés, de toutes les inconvenances intellectuelles possibles » (1927, p. 355, tr., p. 173). « Celui qui est parvenu à accepter sans critique toutes les absurdités que lui offrent les doctrines religieuses, et même à fermer les yeux sur leurs mutuelles contradictions, n’est pas quelqu’un dont la faiblesse de pensée doive nous surprendre outre mesure » (p. 371, tr., p. 188). Dans La nouvelle suite des leçons d’introduction à la psychanalyse, il répète : « L’interdit de pensée que la religion édicte au service de son autoconservation n’est pas totalement sans danger ni pour l’individu ni pour la communauté humaine. L’expérience analytique nous a enseigné qu’un tel interdit, même s’il est à l’origine limité à un domaine particulier, est porté à s’étendre et devient alors une cause d’inhibitions graves dans la conduite de vie de la personne. On peut d’ailleurs observer cet effet dans le sexe féminin, comme conséquence de l’interdiction de s’occuper de la sexualité, ne serait-ce qu’en pensée. » (1933, p. 185, tr., p. 256)
Les arguments de Freud contre la religion sont d’un intérêt très relatif. En effet, on peut dire à leur sujet ce qu’Alfred Hoche, professeur de psychiatrie à l’université de Fribourg, disait en 1908 des explications de Freud sur l’hystérie : » Il est certain qu’il y a du nouveau et du bon dans la doctrine freudienne de la psychanalyse de l’hystérie ; malheureusement, le bon n’est pas neuf et le neuf n’est pas bon. » (cité par Borch-Jacobsen & Shamdasani, 2006, p. 98) Notons que Freud, lorsqu’il présente son analyse de la religion, se montre modeste. Il écrit : « Je n’ai rien dit que d’autres hommes plus autorisés n’aient dit avant moi de façon plus complète, plus vigoureuse et plus impressionnante. (…) Je n’ai fait qu’ajouter quelque fondement psychologique à la critique de mes grands devanciers » (1927, p. 358, tr., p. 176). Nous savons par une lettre à Ludwig Binswanger (22.11.1925) que Freud, dans sa jeunesse, avait « lu Feuerbach avec plaisir et ardeur ».
Comme ses grands devanciers, Freud pense que la religion répond à un besoin de protection, qu’elle aide à supporter les souffrances corporelles et les contraintes imposées par la vie en société, qu’elle réconcilie avec la cruauté de la vie, en particulier avec la mort. Comme Ludwig Feuerbach, dans L’essence du christianisme (1841), il voit dans la religion une projection de désirs humains et une objectivation de l’essence idéale de l’homme. Comme Karl Marx, il pense que la religion trouve son origine dans la détresse humaine. Il écrit : « L’action des consolations religieuses peut être assimilée à celle d’un narcotique » (1927, p. 372, tr., p. 190).
L’originalité de l’analyse freudienne de la religion se ramène principalement aux points suivants :
a) Freud utilise un vocabulaire psychologique pour qualifier le caractère infantile et aliénant de la religion. Il la qualifie de « névrose universelle » (id., p. 367, tr. p. 184). Tantôt, soulignant ses rites contraignants, il la compare à la névrose obsessionnelle (id.) ; tantôt, soulignant le « déni de la réalité effective », il la compare à une psychose, plus précisément : « la confusion hallucinatoire bienheureuse » (p. 367, tr. p. 185). Le principal mérite de la religion, ajoute-t-il, est qu’elle « dispense de la tâche de former une névrose personnelle » (id.).
b) Freud pense que si la croyance religieuse se développe facilement, c’est parce que des traces « historiques » se sont transmises génétiquement dans l’espèce humaine. Il postule qu’au début de l’histoire de l’Humanité, à l’époque de la horde primitive, les fils se sont rebellés contre le père – qui deviendra l’image originaire de Dieu –, qu’ils l’ont tué et qu’ils ont ensuite fait un pacte entre eux pour respecter sa volonté (1927, p. 365s). Pour lui, les religions, depuis le totémisme jusqu’au christianisme, sont fondées sur ce péché originel : la révolte contre le Père.
Notons ici que pour expliquer les troubles psychologiques, Freud a toujours recherché des souvenirs de l’enfance — des souvenirs d’événements réels ou imaginés. Pour expliquer la « névrose universelle », il adopte le même principe. Jusqu’à la fin de sa vie, il dira que la religion doit son caractère compulsif à une « vérité historique » : l’histoire de la famille humaine primitive (Freud, 1939).
La démystification de la religion, opérée par Freud, a sans doute eu un impact important sur bon nombre d’intellectuels occidentaux et assurément sur les psychanalystes. Dans mon université, qui est une université catholique, la psychanalyse a fonctionné comme un cheval de Troie de l’athéisme. Quand j’étais étudiant, dans les années 60, les autorités étaient méfiantes à l’égard du freudisme, mais dès les années 70, l’ensemble de la psychologie clinique et de la psychiatrie était aux mains de psychanalystes. Des collègues philosophes et même théologiens s’intéressaient de plus en plus à la psychanalyse ou devenaient eux-mêmes psychanalystes. Dans l’association de psychanalyse dont je faisais partie — l’École freudienne de Belgique —, la religion était régulièrement égratignée, puis discréditée. Aujourd’hui la proportion de psychanalystes qui adhèrent à des croyances religieuses est minime. Après avoir publié L’avenir d’une illusion, Freud écrivait : « Je veux protéger l’analyse contre les médecins et contre les prêtres. J’aimerais la confier à une corporation qui actuellement n’existe pas, une corporation laïque de ministres des âmes qui n’auraient pas besoin d’être médecins et n’auraient pas le droit d’être prêtres. »
(Lettre à Pfister, 25-11-1928) Il serait sans doute ravi de constater que son œuvre a contribué à une érosion de la foi religieuse. Des rationalistes peuvent y voir son principal titre de gloire.
Le mode freudien d’interprétation, toujours orienté vers le démasquage de souvenirs infantiles et de pulsions primitives, mène-t-il nécessairement à l’athéisme ? Nullement. L’herméneutique freudienne peut toujours démontrer une chose et son contraire. Celui qui veut garder sa foi, et en Freud et en Dieu, a tout le loisir de penser que Freud est le génie de la psychologie qui s’est trompé seulement sur la question de la religion et cela parce qu’il n’a pu assumer sereinement un événement majeur de son enfance, que lui-même raconte dans L’interprétation des rêves :
« Je devais avoir dix ou douze ans quand mon père commença à m’emmener dans ses promenades et à avoir avec moi des conversations sur ses opinions et sur les choses en général. Un jour, pour me montrer combien mon temps était meilleur que le sien, il me raconta le fait suivant : “ Une fois, quand j’étais jeune, dans le pays où tu es né, je suis sorti dans la rue un samedi, bien habillé et avec un bonnet de fourrure tout neuf. Un chrétien survint ; d’un coup il envoya mon bonnet dans la boue en criant : Juif, descends du trottoir ! ”— Et qu’est-ce que tu as fait ? — J’ai ramassé mon bonnet, dit mon père avec résignation. Cela ne m’avait pas semblé héroïque de la part de cet homme grand et fort qui me tenait par la main. À cette scène, qui me déplaisait, j’en opposais une autre, bien plus conforme à mes sentiments, la scène où Hamilcar fait jurer à son fils, devant son autel domestique, qu’il se vengera des Romains. Depuis lors Annibal tint une grande place dans mes fantasmes » (1900, p. 203, tr. p. 175).
Pour un psychanalyste chrétien, il suffit de s’appuyer sur ce récit pour affirmer que la vision que Freud se faisait de la religion était une « rationalisation » de sa haine pour la chrétienté. Les psychanalystes expliquent d’ailleurs souvent les objections envers leur doctrine par la « haine ». À titre d’exemple, rappelons qu’Élisabeth Roudinesco, la principale avocate du freudisme en France, a intitulé « Pourquoi tant de haine ? » le petit livre dans lequel elle essaie de répondre aux 830 pages du Livre noir de la psychanalyse.
Quand un psychanalyste chrétien interprète les propos de Freud sur la religion comme rien d’autre que l’expression d’une vengeance qui remonte à l’enfance, il raisonne en pleine conformité avec les principes de la psychanalyse. Freud est alors le guerrier carthaginois parti à l’assaut de Rome, la capitale du christianisme, pour venger son père. Notons toutefois que cette interprétation cadre davantage avec la psychanalyse adlérienne (où la motivation fondamentale est « la volonté de puissance ») qu’avec la freudienne (où la motivation fondamentale est la pulsion sexuelle).
Quoi qu’il en soit, cette « analyse psychologique » ou « psychanalyse » est totalement en accord avec la stratégie adoptée par Freud vis-à-vis de tous ses opposants, à savoir : discréditer leurs observations et théories en invoquant des motivations « inconscientes », infantiles ou névrotiques. Le premier exemple, historiquement, est celui d’Adler. Freud, pour défendre sa conception contre celle d’Adler, ne fait pas référence à des faits précis, mais se contente de dire qu’Adler « sous-estime les forces inconscientes ». Il écrit : « Ce faisant, Adler procède comme tous nos malades et comme notre pensée consciente en général, c’est-à-dire en ayant recours à ce que Jones appelle la “rationalisation”, afin de dissimuler le mobile inconscient » (1914, p. 96). En privé, Freud liquidait la théorie d’Adler par une étiquette bien plus expéditive de son auteur. Il écrivait par exemple à James Putnam : « Adler est un paranoïaque malfaisant » (cité par Borch-Jacobsen & Shamdasani, 2006, p. 131).
La tactique de la psychiatrisation a été utilisée par les psychanalystes depuis le début du Mouvement. Dans Les illusions de la psychanalyse, j’ai consacré cinq pages (1980, p. 64-67) à des exemples de « diagnostics » décernés par Freud à des disciples dissidents (Adler, Stekel, Jung, Bleuler, Hirschfeld) et à des psychiatres ou des psychologues émettant des critiques (Bratz, Morton Prince, Hellpach et d’autres). Je me contente ici de citer brièvement quelques-unes de ces étiquettes : résistance homosexuelle, ambivalence obsessionnelle, inconscient pervers, moi paranoïaque, imbécillité affective, bêtise arrogante, fâcherie homosexuelle, délire de grandeur, fou accompli.
Certes, il est intéressant d’analyser les mobiles psychologiques et politiques ou les contextes historiques et sociaux d’une théorie. Cela permet d’expliquer la genèse de la théorie, mais non d’évaluer son degré de scientificité. La valeur scientifique d’une théorie s’établit uniquement par des vérifications empiriques d’implications testables. Par exemple, on peut expliquer l’omniprésence du thème de la sexualité dans la théorie freudienne par le fait que Freud, à partir de 1893, souffre d’importantes frustrations sexuelles, mais seules des observations méthodiques permettent de valider ou de réfuter cette théorie.
Freud a eu la sagesse d’écrire (une seule fois, me semble-t-il) que « le fait qu’une doctrine soit psychologiquement déterminée n’exclut en rien sa validité scientifique » (1913, p. 407). En fait, lui-même et ses disciples ont constamment bafoué ce principe épistémologique élémentaire, jusqu’à aujourd’hui. En 1997, les réactions à la parution des Impostures intellectuelles, de Sokal et Bricmont, en ont fourni des exemples stupéfiants. Ainsi Philippe Sollers, dans une interview du Nouvel Observateur intitulée « Réponse aux imbéciles », « argumentait » : « Leurs vies privées méritent l’enquête : Qu’est-ce qu’ils aiment ? Quelles reproductions ont-ils sur leurs murs ? Comment est leur femme ? Comment toutes ces belles déclarations abstraites se traduisent-elles dans la vie quotidienne et sexuelle ? » (cité dans Sokal & Bricmont, 1999, p. 24).
4. Freud est encore un rationaliste au sens 4 du terme. Selon lui, la science est le seul moyen de produire des connaissances vraies. Lacan a très justement souligné cette caractéristique de la pensée freudienne. Il écrit : « Nous disons, contrairement à ce qui se brode d’une prétendue rupture de Freud avec le scientisme de son temps, que c’est ce scientisme même qui a conduit Freud, comme ses écrits nous le démontrent, à ouvrir la voie qui porte à jamais son nom. Nous disons que cette voie ne s’est jamais détachée des idéaux de ce scientisme. » (1966, p. 857)
On pourrait évoquer ici les nombreuses professions de foi de Freud dans la Raison et la Science. Je me contente de citer son opinion sur une forme de connaissance tantôt complémentaire, tantôt rivale de la science : la philosophie. Freud écrit, à la fin de sa vie : « Il est inadmissible de dire que la science est un domaine de l’activité d’esprit de l’homme, la religion et la philosophie en étant d’autres, de valeur au moins équivalente à elle, et que la science n’a pas du tout à se mêler des deux autres ; qu’elles ont toutes le même droit à prétendre à la vérité et que tout homme est libre de choisir d’où il veut tirer sa conviction et où il veut placer sa croyance. Une telle manière de voir passe pour particulièrement distinguée, tolérante, largement compréhensive et libre de préjugés étroits. Malheureusement, elle n’est pas soutenable, elle participe de tous les aspects nocifs d’une vision du monde absolument non scientifique et lui équivaut pratiquement. Or c’est un fait que la vérité ne peut pas être tolérante, qu’elle n’admet ni compromis ni restrictions, que la recherche considère tous les domaines de l’activité humaine comme lui étant propres et qu’il lui faut devenir inexorablement critique lorsqu’une autre puissance veut en confisquer un morceau pour soi. (…) Méthodologiquement, la philosophie s’égare en surestimant la valeur de connaissance de nos opérations logiques et en reconnaissant, par exemple, encore d’autres sources de savoir, telles que l’intuition. Et bien souvent, on estime que la raillerie du poète (H. Heine) n’est pas sans fondement, quand il dit du philosophe : « Avec ses bonnets de nuit et sa robe de chambre en guenilles, Il bouche les trous de l’édifice du monde. » (1933, p. 172s, tr., p. 244s)
En privé, Freud tenait des propos plus radicaux. Il écrivait par exemple à Ludwig Binswanger (1966, p. 277) que « La philosophie est une des formes les plus convenables de sublimation d’une sexualité refoulée, rien de plus. »
5. Freud, malheureusement, n’est pas rationaliste selon le cinquième sens que nous avons distingué. En effet, le rationalisme moderne, que Popper appelle « critique », est étroitement apparenté à l’esprit scientifique tel qu’il est pratiqué par la grande majorité des chercheurs, qu’ils soient physiciens, médecins ou psychologues. Cet esprit se caractérise par le souci de raisonner avec rigueur, de communiquer de façon claire et honnête, de soumettre ses propres idées à la critique des autres chercheurs et au verdict de faits observés de façon objective et systématique, de ne pas céder à la tentation d’utiliser des stratégies qui immunisent contre toute possibilité de réfutation et d’avoir le courage de mettre à la poubelle les hypothèses réfutées par les faits observés. Freud et la majorité des freudiens ne se caractérisent guère par cet esprit.
Sans doute Freud a-t-il publié des réflexions épistémologiques qui vont dans le sens d’un rationalisme ouvert, en particulier dans la dernière des Nouvelles leçons d’introduction à la psychanalyse (1933). Toutefois, lorsqu’on examine comment il se comportait pratiquement, plutôt que de s’en tenir à quelques belles déclarations, on constate (a) qu’il a été malhonnête en parlant de ses résultats thérapeutiques, (b) qu’il a eu sans cesse recours à des stratégies immunisantes et (c) qu’il s’est conduit en chef d’école dogmatique, plutôt qu’en chercheur qui accepte de dialoguer de façon sincère avec des collègues qui formulent des objections.
a) Un des principaux reproches à faire à Freud est d’avoir menti sur les effets de sa méthode. Il a écrit, à de nombreuses reprises, qu’Anna O, la première patiente à bénéficier d’un traitement psychanalytique, avait été guérie de « tous » ses symptômes. On sait aujourd’hui que la thérapie a été un lamentable échec, maquillé en succès inespéré. La patiente, qui était venue consulter Breuer pour une toux nerveuse, s’est retrouvée, après un an et demi de « traitement par la parole », profondément perturbée, morphinomane et poussée à séjourner dans un hôpital psychiatrique, où elle restera plusieurs années (Ellenberger, 1970 ; Borch-Jacobsen, 2005). L’histoire du freudisme commence par un grave mensonge, parfaitement conscient, et se poursuit par une longue suite d’autres mensonges, dans le chef de Freud et de nombreux disciples, Bruno Bettelheim par exemple (voir Pollack, 2005).
Jacques Bénesteau a publié un ouvrage de 400 pages sur le sujet : Mensonges freudiens. Histoire d’une désinformation séculaire. Il est remarquable que pratiquement la seule réponse qu’É. Roudinesco, la très médiatique historienne de la psychanalyse, ait pu formuler à l’encontre de ce livre est qu’il est « antisémite ». Premier élément de son argumentation : Bénesteau (2004, p. 189s) cite des auteurs qui affirment que l’antisémitisme, à Vienne, à l’époque où Freud fait sa carrière, est beaucoup moins important que ce que l’on a coutume de le dire. Deuxième élément : Bénesteau écrit que les psychanalytses « sont partout » [actuellement en France]. Or, souligne Roudinesco, les antisémites utilisent précisément cette expression — « Ils sont partout » — pour parler des Juifs. « Donc », Bénesteau est un antisémite. Comme la logique de ce raisonnement ne saute pas aux yeux de tous les lecteurs, Roudinesco précise qu’il s’agit d’un antisémitisme « masqué » ! En tant que psychanalyste, bien sûr, elle est experte dans le dévoilement de ce qui est inconscient ou masqué aux yeux du profane.
L’important ici est que Roudinesco ne dit pas que Bénesteau ment quand il parle des mensonges freudiens. Elle-même reconnaît, timidement, des « arrangements » freudiens avec la vérité. Par exemple, concernant Anna O, elle écrit, dans Pourquoi la psychanalyse ? : « Si elle ne fut pas guérie de ses symptômes, elle devint bel et bien une autre femme » (1999, p. 30). Quelle habileté dans la pratique de l’euphémisme…
En fait, tous les historiens « indépendants » du freudisme admettent aujourd’hui que Freud a menti sur ses résultats thérapeutiques. Simplement, ils portent des jugements différents sur cette réalité. On peut juger ces mensonges de différentes façons. Certains lui ont trouvé des excuses. Par exemple Richard Webster termine son imposant ouvrage en disant : « En dépit de son attitude parfois moins que scrupuleuse vis-à-vis de la vérité, il reste que, si Freud a voulu persuader ses contemporains d’accepter la psychanalyse, c’était pour nulle autre raison que sa propre foi en elle. En ce sens, la théorie psychanalytique n’est pas plus une escroquerie que ne le sont le christianisme, l’Islam, le judaïsme ou tout autre système de croyance religieuse » (1998, p. 490). D’autres, comme Han Israëls (université d’Amsterdam) ou Frederick Crews (Université Berkeley) n’hésitent pas à parler de « charlatanisme ». En tant que psychologue, je pense que la question essentielle n’est pas la moralité de Freud, mais la valeur de sa théorie. Or, en fin de compte, sa théorie repose sur sa pratique clinique et sur son auto-analyse. Aujourd’hui, ces deux piliers apparaissent davantage comme des romans que de la science rigoureuse. La construction freudienne s’est érigée sur du sable.
Freud espérait le Prix Nobel de médecine. Il a reçu le Prix Goethe de littérature. L’erreur est de croire que la psychanalyse est une science au sens rigoureux du terme. Comme l’avait compris en 1896 Richard von Krafft-Ebing, le célèbre psychiatre et sexologue viennois, la théorie de Freud est « un conte de fées scientifique ». Déjà en 1925, Aldous Huxley expliquait que « la psychanalyse est l’un des plus beaux spécimens de pseudoscience jamais conçu par l’esprit humain » (trad. dans 2005, p. 406).
b) On pourrait avancer que Freud a quelque peu arrangé les faits afin de promouvoir une méthode en fin de compte valable, même si elle est moins efficace que ce qu’il écrivait au début de sa carrière. Se pose alors encore le problème, fondamental, de l’usage abusif du concept d’« inconscient » et des concepts qui s’y rattachent : résistance, refoulement, formation réactionnelle, dénégation, sublimation.
Depuis environ trois siècles, on parle de processus inconscients. Avec raison : à tout moment, nos comportements participent de processus auxquels nous ne réfléchissons pas ou dont nous ignorons l’existence (voir p. ex. Van Rillaer, 2003, chap. 7). Toutefois, tous les psys devraient méditer cette mise en garde que faisait William James déjà en 1890, à une époque où Freud était encore un illustre inconnu : « La distinction entre les états inconscients et conscients du psychisme est le moyen souverain pour croire tout ce que l’on veut en psychologie » (1890, p. 163).
Popper a clairement montré qu’un énoncé scientifique doit être formulé de telle façon que des faits d’observation pourraient le réfuter (sans que cela implique que ce le sera tôt ou tard). D’autres avant lui avaient déjà compris qu’une faiblesse radicale de la psychanalyse est qu’elle peut toujours expliquer tout et son contraire. Ainsi, en 1923, le psychologue Adolf Wohlgemuth montrait que le freudisme fonctionne sur la base du principe « Pile je gagne, face tu perds » (cité dans Borch-Jacobsen & Shamdasani, 2006, p. 233).
Certes, au niveau de la théorie, on peut isoler des propositions vérifiables-réfutables. Par exemple, Freud écrit : « L’infériorité intellectuelle de tant de femmes, qui est une réalité indiscutable, doit être attribuée à l’inhibition de la pensée, inhibition requise pour la répression sexuelle » (1908, tr., p. 42). Il énonce là deux lois empiriques que l’on peut tester : l’infériorité intellectuelle des femmes serait « une réalité » (la psychologie scientifique a montré qu’il n’en est rien) ; le manque d’intelligence des femmes serait dû à la répression sexuelle (je doute qu’on puisse observer, sur un large échantillon, que lorsque des femmes sexuellement très contrôlées parviennent à se libérer de leurs inhibitions, leurs capacités intellectuelles s’en trouvent automatiquement augmentées).
Au niveau clinique, la psychanalyse « se vérifie » toujours et semble donc « irréfutable », « infalsifiable », ce qui signe son absence de scientificité. Exemple : la doctrine du complexe d’Œdipe se « vérifie » toujours, quels que soient les faits observés. Si un garçon aime sa mère et déteste son père, il présente un complexe d’Œdipe manifeste. Si un autre adore son père et se montre agressif envers sa mère, ses tendances œdipiennes sont « refoulées ». Dans ce cas, l’analyste peut dire, comme Freud pour le Petit Hans, que l’agressivité vis-à-vis de la mère est une « expression de tendances sadiques traduisant un désir incestueux » et que l’affection pour le père est une « formation réactionnelle » au désir de tuer celui-ci. (Pour plus de détails, voir Meyer et al., 2005, p. 239-241 ; 421).
Freud, Adler, Stekel, Jung, Rank, Reich, Ferenczi et d’autres étaient des cliniciens. Tous ont construit des théories qui se contredisent mutuellement. Seule la recherche scientifique permet de retenir, parmi les hypothèses, celles qui collent le mieux à la réalité. Freud n’a pas admis l’importance de la démarche expérimentale pour départager des hypothèses, pour confirmer certaines et réfuter d’autres. Il ne croyait pas à l’intérêt de la méthode scientifique pour sa discipline. Lorsqu’un psychologue américain, Saul Rosenzweig, lui envoya des résultats de recherches expérimentales qui allaient dans le sens de sa théorie du refoulement, il répondit : « Je ne puis accorder beaucoup de valeur à ces confirmations, car la richesse des observations solides sur lesquelles reposent mes affirmations les rend indépendantes de la vérification expérimentale. Toutefois, cela ne peut pas faire de mal. » Roy Grinker, qui se trouvait chez Freud quand celui-ci reçut le document de Rosenzweig, raconte : « Freud jeta cette lettre par terre avec colère, en disant : “la psychanalyse n’a pas besoin de preuve expérimentale. » (1958, p. 132)
c) Au départ, Freud avait la volonté de faire de la science. Toutefois, dès que des collègues et des disciples ont produit des idées différentes des siennes, il s’est raidi dans une posture dogmatique, refusant de soumettre ses conceptions à la critique mutuelle et au verdict de nouvelles observations. À la fin de sa vie, évoquant « les dissidences si nombreuses dans l’histoire de la psychanalyse », il fera cet aveu : « Un dicton populaire assure que nous avons à apprendre de nos ennemis. Je déclare que ce ne fut pas mon cas. » (1933, p. 150) Jusqu’au début des années 1910, Freud a cherché à faire partie du monde des chercheurs scientifiques de la psychologie et de la neurologie. En 1913, l’Association allemande de psychiatrie a organisé un congrès, à Breslau, au cours duquel il fut surtout question de psychanalyse. Le professeur Emil Kraepelin y expliqua que « ce qui est bon en elle n’est pas neuf et vient essentiellement de Janet » (Borch-Jacobsen & Shamdasani, 2006, p. 138). Hoche, qui avait fait une enquête sur les résultats thérapeutiques de la psychanalyse, concluait dans un sens très négatif. Il allait jusqu’à dire que la psychanalyse faisait souvent plus de tort que de bien. Il disait qu’elle « était de la vieille technique suggestive sous de nouveaux habits pseudoscientifiques » (id., p. 137). Il dénonçait le dogmatisme et le sectarisme des freudiens. Il citait ironiquement des propos de Stekel ouvrant un congrès de psychanalyse tenu deux ans plus tôt : « En ce jour de célébration, nous nous sentons comme les frères d’un Ordre qui exige le sacrifice de chacun au service de la Communauté » (id., p. 136).
Déjà en 1911, Freud avait refusé de se rendre dans des congrès qui n’étaient pas exclusivement psychanalytiques. Il écrivait à Pfsiter : « Il n’est guère possible d’argumenter publiquement sur la psychanalyse. (...) Les débats ne peuvent que demeurer aussi infructueux que les controverses théologiques au temps de la Réforme » (lettre du 28 mai). Le congrès de Breslau marque un tournant dans l’évolution intellectuelle de Freud. À partir de ce moment, il se centre sur la formation de disciples et le développement d’un Mouvement dont il se veut le chef. Il traite alors de moins en moins de patients. Il reprend à son compte une idée de Jung : l’analyse « didactique », qui devient le moyen de propager sa doctrine sur un mode initiatique, en gagnant facilement sa vie. Comme le disent Borch-Jacobsen et Shamdasami, qui sont sans doute aujourd’hui les historiens de la psychanalyse les mieux informés : « Pour avoir accès à l’“art caché” de Freud, il fallait certes payer monnaie sonnante et trébuchante, mais il était aussi possible de récupérer cet investissement en faisant payer d’autres disciples qui, à leur tour, etc. Séparée de l’Université et des facultés de médecine (Freud a arrêté d’enseigner en 1917), la psychanalyse s’est transformée en une entreprise privée recrutant des clients (des patients-disciples-mécènes) sur un marché dérégulé et formant ses cadres de façon entièrement autonome et “laïque”, indépendamment de toute sanction universitaire ou gouvernementale. La psychanalyse, en un mot, est devenue la firme Sigmund Freud, organisée comme une corporation internationale basée sur le système de la franchise » (Borch-Jacobsen & Shamdasani, 2006, p. 144).
À partir des années 1910, Freud est devenu un homme d’affaires et un chef de secte. Tous ceux qui ont trouvé de l’inspiration dans ses œuvres ne l’ont pas suivi sur cette voie. Aux États-Unis, il y a eu et il y a encore des psychanalystes soucieux de rationalité, d’autocritique, d’honnêteté, de scientificité et d’ouverture. En France, on pourrait citer, comme exemples Daniel Widlöcher (Paris) et Michel Marie-cardine (Lyon), qui ouvrirent leur service aux thérapies comportementales et cognitives.
Malheureusement, les modes de pensée « irrationalistes » du freudisme se sont transmis et même amplifiés avec Jacques Lacan et la plupart de ses disciples. Le gourou parisien a porté l’irrationalisme à un niveau que Freud aurait sans aucune doute désapprouvé. Alors que Freud s’est toujours exprimé avec le souci de se faire comprendre, Lacan n’a cessé de rendre son discours de plus en plus obscur, même pour les initiés (voir Buekens, 2005). Freud avait la volonté de faire de la science, quand bien même il manquait à certaines règles scientifiques, à vrai dire loin d’être bien comprises par tous les chercheurs son époque. Lacan, lui, a promu une attitude franchement antiscientifique. Il déclarait, sans vergogne : « Aucun résultat de la science n’est un progrès. Contrairement à ce qu’on imagine, la science tourne en rond, et nous n’avons pas de raison de penser que les gens du silex taillé avaient moins de science que nous » (1977, p. 10), « Je conclus que le discours scientifique et le discours hystérique ont presque la même structure » (1973, p. 36.).
Ainsi, en un siècle, la psychanalyse, qui avait commencé comme un projet rationaliste, est devenue un puissant vecteur de pensée irrationnelle. En 1920, le célèbre sexologue anglais Havelock Ellis, avec lequel Freud avait entretenu une correspondance amicale, écrivait déjà : « Il est malheureux que Freud ait d’abord été le chef d’une secte, sur le modèle des sectes religieuses » (cité dans Brome, p. 318). Les choses n’ont pas changé. Avec Lacan et son gendre Jacques-Alain Miller, elles ont même considérablement empiré.
Références
Anzieu (1978) Rationalité dans la théorie et dans la pratique de la psychanalyse. Raison présente, n° 46, p. 9-19.
Bénesteau, J. (2002) Mensonges freudiens : Histoire d’une désinformation séculaire. Wavre, Mardaga.
Borch-Jacobsen, M. (2005) La vérité sur le cas de Mlle Anna O. Dans C. Meyer et al., Le livre noir de la psychanalyse. Paris, Les Arènes, p. 25-30.
Borch-Jacobsen, M. & Shamdasani, S. (2006) Le dossier Freud. Enquête sur l’histoire de la psychanalyse. Paris, Les Empêcheurs de penser en rond.
Brome, V. (1967) Les premiers disciples de Freud. Tr., P.U.F., 1978.
Buekens, F. (2005) Pourquoi Lacan est-il si obscur ? Dans C. Meyer et al., Le livre noir de la psychanalyse. Paris, Les Arènes, p. 269-277.
Binswanger, L. (1966) Discours, parcours, et Freud. Tr., Paris, Gallimard.
Crews, F.C. (1998) Unauthorized Freud. Doubters confront a legend. New York, Londres, Viking, 301 p.
Ellenberger, H. (1970) The Discovery of the Unconscious. N.Y., Basic Books. 932 p. Tr., À la découverte de l’inconscient. Histoire de la psychiatrie dynamique. Villeurbanne, Simep, 1974, 760 p. Rééd., Histoire de la découverte de l’inconscient. Paris, Fayard, 1994.
Frank, L. (1910) Die Psychanalyse. Munich, E. Reinhardt.
Freud, S. (1895) Obsessions et Phobies. Gesammelte Werke, Fischer, vol. I, p. 345-353.
Freud, S. (1896a) L’hérédité et l’étiologie des névroses. Gesammelte Werke, Fischer, vol. I, p. 407-422.
Freud, S. (1896b) Zur Aetiologie der Hysterie. Gesammelte Werke, Fischer, vol. I, p. 425-459.
Freud, S. (1900) Die Traumdeutung. Gesammelte Werke, Fischer, vol. II-III. Tr., L’interprétation des rêves. P.U.F., 1967.
Freud, S. (1908) La morale sexuelle civilisée et la maladie nerveuse des temps modernes. Tr., La Vie sexuelle, P.U.F., 1969, p. 28-46.
Freud, S. (1910a) Ueber Psychoanalyse (Fünf Vorlesungen) (1909) Gesammelte Werke, Fischer, vol. VIII, p. 3-60.
Freud, S. (1910b) Ueber « Wilde » Psychoanalyse. Gesammelte Werke, Fischer, vol. VIII, p. 118-125.
Freud, S. (1913) Das Interesse an der Psychoanalyse. Gesammelte Werke, Fischer, vol. VIII, p. 390-420.
Freud, S. (1914) Zur Geschichte der psychoanalytischen Bewegung. Gesammelte Werke, vol. X, p. 44-113.
Freud, S. (1917a) Conférences d’introduction à la psychanalyse. Tr., Œuvres complètes, P.U.F., vol. 14.
Freud, S. (1917b) Eine Schwierigkeit der Psychoanalyse. Gesammelte Werke, Fischer, vol. XII, p. 3-12.
Freud S. (1927) Die Zukunft einer Illusion. Gesammelte Werke, Fischer, vol. XIV, p. 325-80. Tr., L’avenir d’une illusion. Œuvres complètes, P.U.F., vol. XVIII, 1994, p. 141-197.
Freud, S. (1933) Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse. Gesammelte Werke, Francfort, Fischer, vol. XV. Tr., Nouvelle suite des leçons d’introduction à la psychanalyse. Œuvres complètes, P.U.F., vol. XIX, 1995, p. 83-268.
Freud, S. (1939) Der Mann Moses und die Monotheistische Religion. Gesammelte Werke, Fischer, vol. XVI, p. 101-246.
Freud, S. (1940) Abriss der Psychoanalyse. Gesammelte Werke, Fischer, vol. XVII.
Freud (1950) Aus den Anfängen der Psychoanalyse – Briefe an Wilhelm Fliess, Abhandlungen und Notizen aus den Jahren 1887-1902. London, Imago.
Freud, S. & Binswanger, L. (1995) Correspondance. Tr., Paris, Calmann-Lévy.
Freud, S. & Pfister, O. (1963) Briefe. 1909-1939. S. Fisher.
Grinker R., A philosophical appraisal of psychoanalysis. Dans J. Masserman (éd.), Science and Psychoanalysis. New York, Grune & Stratton, 1958, vol. I, p. 132.
Huxley, A. (1925) Une supercherie pour notre siècle. Tr. dans C. Meyer et al. (2005) Le livre noir de la psychanalyse. Paris, Les Arènes, p. 403-411. (Original dans les revues The Forum, p. 313-320 et The Adelphi, mai 1925).
Israëls, H. (1999) De Weense kwakzalver. Honderd jaar Freud en de freudianen. [Le charlatan de Vienne. Un siècle de Freud et de freudiens]. Amsterdam, Bert Bakker (Prometheus), 192 p.
James W. (1890) Principles of psychology, New York, Holt ; Londres, Macmillan, vol. 1.
Lacan, J. (1966) Ecrits. Paris, Seuil.
Lacan J. (1973), Télévision. Paris, Seuil.
Lacan J. (1977) Ornicar ? Bulletin Périodique du Champ Freudien, n° 12, p. 10.
Meyer, C., Borch-Jacobson, M., Cottraux, J., Pleux, D., Van Rillaer, J. (2005) Le livre noir de la psychanalyse. Paris : Les arènes, 830 p. Rééd. en poche, Collection 10/18, n° 3991, 2007, 1018 p.
Pollak, R. (2005) Bettelheim l’imposteur. Dans C. Meyer et al. (2005) Le livre noir de la psychanalyse. Paris : Les Arènes, p. 533-548.
Popper, K. (1966/1979) La société ouverte et ses ennemis. Tr., Paris, Seuil, tome 2.
Roudinesco, E. (1999) Pourquoi la psychanalyse ? Paris, Fayard.
Roudinesco, E. (2004) « Le Club de L’Horloge et la Psychanalyse : Chronique d’un antisémitisme masqué ». Les Temps Modernes, 627, p. 242-254
Sokal, A. et Bricmont, J. (1999), Les impostures intellectuelles. Ed. revue, Le Livre de Poche, n° 4267.
Sulloway, F. (1979) Freud, biologist of the mind : Beyond the psychoanalytic legend. N. Y. : Basic Books. Tr., Freud, biologiste de l’esprit. Fayard, 1981, 595 p. Rééd. 1998, 620 p.
Sulloway, F. (2005) Freud recycleur : cryptobiologie et pseudoscience. Dans C. Meyer et al. (2005) Le livre noir de la psychanalyse. Paris : Les Arènes, p. 49-65.
Van Rillaer, J. (1980) Les illusions de la psychanalyse. Wavre, Mardaga, 4e éd. 1996.
Van Rillaer, J. (2003) Psychologie de la vie quotidienne. Paris, Odile Jacob.
Webster, R. (1998) Le Freud inconnu. L’invention de la psychanalyse. Tr., Paris, Exergue.
Zazzo, R. (1978) La psychanalyse est-elle rationaliste ? Raison présente, n° 46, p. 3-8.
Partager cet article
Psychanalyse

Psychanalyse : le déclin d’une illusion
Le 2 décembre 2010
Carl Gustav Jung : psychiatre, psychanalyste et gourou
Le 8 janvier 2024
Y a-t-il du nouveau et du bon dans la psychanalyse ?
Le 15 octobre 2022
La vénération du psychothérapeute : explications et conséquences
Le 7 décembre 2017