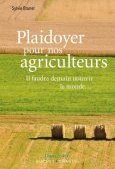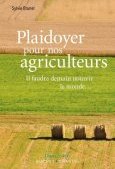Que penser de l’agriculture biologique et des aliments Bio ?
Publié en ligne le 28 mars 2007 - Agriculture -
Qu’est-ce que l’agriculture biologique ? Bref rappel historique
L’agriculture « biologique » est née en Europe dès les années 1930 sous l’influence de trois mouvements : biodynamique ou anthroposophique en Autriche et en Allemagne (R. Steiner puis A. Pfeiffer), organo-biologique en Suisse (H. Müller et H.P. Rusch) et organique en Grande-Bretagne (A. Howard). Ces mouvements reposaient sur des courants philosophiques et sociologiques refusant l’évolution productiviste de l’agriculture et prônant le retour à des modes de production du début du siècle dernier, plus respectueux de la nature et des équilibres écologiques.
Les techniques culturales ou d’élevage préconisées limitent la mécanisation du travail, réduisent les intrants chimiques (engrais minéraux et produits phytosanitaires 1 de synthèse), les additifs et médicaments vétérinaires, interdisent (depuis peu) les OGM et leurs dérivés et, plus globalement, visent à une meilleure autonomie de l’agriculteur (recyclage par compostage de végétaux de l’exploitation et des déjections animales). Seule la méthode biodynamique fait appel à des substances naturelles « biostimulantes » et à des « forces vitales et vibratoires cosmiques et telluriques », ajoutant ainsi un volet plus ésotérique.
L’agriculture biologique s’est très lentement développée en France à la fin des années 1950 sous l’impulsion d’une société commerciale (Lemaire-Boucher) et d’un mouvement associatif d’agriculteurs et de consommateurs (Nature et Progrès), ce dernier reposant sur des fondements plus rationnels. En effet, l’un des arguments utilisés par la dite société commerciale pour vendre une algue calcaire fossile, le lithothamne, amendement 2 bien connu en Bretagne, était l’activation de « transmutations biologiques » par l’intermédiaire d’enzymes microbiennes du sol, sorte d’alchimie moderne qui devait dispenser de restituer au sol les éléments minéraux (notamment azote, phosphore et potassium) exportés par les récoltes, et donc d’employer des engrais complets.
Dans les années 1970, l’agriculture biologique, encore marginale et non réglementée, a connu un début de développement résultant de divers facteurs : surproduction dans plusieurs secteurs agricoles, crise pétrolière, résistance au libéralisme, au productivisme et à la société de consommation, prise de conscience des problèmes écologiques, retour à la terre… Dans ce contexte socio-économique favorable, et malgré son manque d’organisation professionnelle unitaire, sa reconnaissance officielle en 1980 devenait légitime, mais il fallut attendre 1998 pour la mise en place par le ministère de l’Agriculture et de la Pêche d’un Plan pluriannuel de développement avec l’objectif d’atteindre en moins de 10 ans un million d’hectares ainsi cultivés sur 25 000 exploitations.
En France, le qualificatif « biologique » a été consacré par l’usage, bien que « écologique » ou « organique » utilisés dans la plupart des autres pays auraient été moins ambigus. En effet, le terme « biologique » est ubiquiste et banal dans le monde vivant et il n’est pas acceptable qu’il ait ainsi été accaparé par un usage aussi limité. Par exemple, la lutte biologique, bien connue depuis longtemps pour la protection des cultures (coccinelles contre pucerons), n’est pas propre à l’agriculture biologique. Même le préfixe « bio » est maintenant réservé, puisqu’un fameux yaourt ainsi dénommé (car contenant des bactéries vivantes probiotiques 3) a dû changer de nom ! Et que deviendront les biocarburants (parfois appelés carburants bio) qui ne sont pas produits par l’agriculture biologique ? Une telle monopolisation sémantique est évidemment abusive mais, dans ce qui suit, l’agriculture biologique et ses produits seront malgré tout désignés indifféremment par « Bio » (appellation et non préfixe) ou « AB » !
La production en agriculture biologique est-elle réglementée et contrôlée ?
Après 1980, des cahiers des charges ont progressivement été élaborés par les organismes professionnels de l’agriculture biologique et agréés par les pouvoirs publics. Un règlement CEE de 1991 modifié a intégré en 1999 les dispositions du règlement CE relatif aux produits animaux, complété en 2000 au niveau national (principe de subsidiarité) par le cahier des charges français plus strict et étendu à des domaines non couverts (aquaculture).
Avant l’agrément comme exploitation biologique, une période de conversion de 2 ou 3 années est exigée (pour purger la terre des produits chimiques apportés par l’agriculture conventionnelle !) et le contrôle du respect du cahier des charges est assuré par des organismes certificateurs agréés et accrédités dont la compétence et la rigueur ne peuvent être mises en doute (bien que le minimum d’un contrôle annuel semble un peu juste pour vérifier le suivi d’un règlement aussi complexe et assorti d’autant de dérogations !) et qui, en principe, sont indépendants (mais payés par l’exploitant agricole…).

La marque AB est la propriété exclusive du ministère français en charge de l’agriculture qui en définit les règles d’usage. Elle garantit un aliment composé d’au moins 95 % d’ingrédients issus du mode de production biologique, le respect de la réglementation en vigueur en France et une certification placée sous le contrôle d’un organisme agréé par les pouvoirs publics français. Les 5 % « non-bio » comprennent, comme pour les autres produits alimentaires transformés, des additifs et des auxiliaires technologiques figurant dans une liste positive (et donc limitative) d’une soixantaine de substances, sans compter les arômes naturels et les préparations autorisées à base de micro-organismes.
Cependant, il est possible de faire référence à l’origine AB des matières premières dans la liste des ingrédients, si au moins 70 % des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique. Quid des autres ingrédients ? Le consommateur en est-il bien informé ?
Les produits obtenus peuvent alors être dénommés « issus de l’agriculture biologique » et bénéficier en France du logo « AB ». Chaque étape, de la production à la commercialisation, doit être conforme au cahier des charges mais il s’agit d’une démarche volontaire basée sur la confiance et répondant à une obligation de moyens mais pas du tout à une obligation de résultat, notamment sur la qualité des produits.
Les bases théoriques de l’agriculture biologique restent-elles dogmatiques ou irrationnelles ?
Les méthodes dites biodynamiques excluent les engrais chimiques et produits phytosanitaires de synthèse, mais ont aussi recours à des procédés faisant appel aux « forces cosmiques, vitales et vibratoires ». À titre d’exemples : l’utilisation de dilutions de purin d’ortie pour fertiliser et régénérer le sol et la pulvérisation à doses homéopathiques d’un mélange d’humus et de silice pilée. Ainsi, dans une recette préconisée par un gourou à des viticulteurs bourguignons dans un récent reportage télévisé, est-il précisé de « pulvériser, en accord avec les conjonctions astrales, à raison de 4 g par hectare (0,4mg par m2 !), un mélange d’humus ayant subi une maturation pendant un an sous terre dans une corne de vache et de silice pilée dynamisée par agitation ». Même si cette méthode avait, soi-disant, été approuvée par un ingénieur chimiste, elle peut laisser perplexe ! À défaut d’être homologuées comme tous les autres produits utilisés en agriculture, ces préparations bénéficient en général de l’indulgence du législateur. Ainsi, les préparations à base du fameux purin d’ortie n’ont plus besoin d’apporter la preuve de leur efficacité et sont dispensées d’homologation !

La théorie sur les transmutations biologiques (ou à faible énergie), relevant de la fusion froide en biologie, a connu sa période faste entre 1970 et 1980, propagée par les ouvrages de C.L. Kervran dont les « pseudo-preuves » de transmutations dans les domaines de la nutrition minérale des végétaux et des animaux avaient pourtant été démantelées et vigoureusement réfutées (Guéguen L., 1972. Mise au point sur les prétendues transmutations biologiques. Bulletin Inra, 72, 1-4). Les principales transmutations citées permettraient de créer du calcium à partir de potassium (par incorporation d’un proton) ou de magnésium (par incorporation d’un noyau d’oxygène), et bien d’autres éléments. Heureusement, cette théorie n’a plus cours dans les pratiques d’agriculture biologique en France mais fait encore l’objet d’inquiétantes résurgences dans plusieurs pays (Russie, Japon, Allemagne, Suède…et même en France où elle tente de revenir !).
L’interdiction des engrais minéraux solubles demeure dogmatique pour l’essentiel car tout fertilisant doit être mis en solution avant son absorption par la racine. Pourquoi interdire les nitrates de synthèse et autoriser les nitrates du Chili de même nature et aussi solubles, parce qu’il s’agit de guano naturel ? Sachant que la fixation symbiotique de l’azote de l’air par les nodosités des racines n’est possible que chez les légumineuses, (sauf peut-être un jour grâce à la transgénèse ?), comment pourrait-on se passer, pour toutes les autres espèces végétales, des nitrates de synthèse fabriqués à partir de l’azote atmosphérique, inépuisable et peu coûteux ?
En fait, le terme « naturel » ouvre les portes, par exemple aux phosphates naturels broyés autorisés 4 sans les transformations destinées à les purifier (fluor, cadmium…) et à les rendre plus assimilables par la plante ou l’animal (sous les formes de phosphates bi- ou monocalcique), ou à la sylvinite, minerai potassique, au lieu du chlorure de potassium, etc.
De même, pourquoi interdire tous les produits phytosanitaires chimiques de synthèse, homologués après de longues études toxicologiques et bénéficiant d’autorisations de mise sur le marché, et autoriser, dans le même but, diverses substances « naturelles » dont l’innocuité n’a pas été démontrée et pour lesquels une AMM n’est pas exigée (comme pour les médicaments homéopathiques, mais avec un risque plus élevé !).
De nombreuses questions peuvent donc être posées sur la liste des substances interdites, d’autant que bon nombre de ces substances font l’objet de dérogations prévues « en cas de nécessité », cette condition étant établie, souvent a priori, par l’organisme de contrôle. Il en est ainsi de certains produits phytosanitaires et des antibiotiques et autres médicaments pour les traitements vétérinaires.
Malgré les réserves précédentes portant sur la logique de l’interdiction de certaines substances, la plupart des pratiques de l’agriculture biologique, qui ne visent pas à trop augmenter les rendements, sont acceptables et méritent d’être encouragées : assolement et rotation des cultures, association d’espèces et de variétés en privilégiant les moins exigeantes en engrais et les plus résistantes aux maladies, entretien de la vie microbienne du sol par l’apport de matière organique, désherbage manuel, utilisation maximale de l’herbe et des fourrages grossiers pour l’alimentation animale, etc.
Le recours aux OGM est évidemment exclu, malgré la chance qu’ils pourraient peut-être offrir dans le futur pour réduire l’usage de certains pesticides et donc aller dans le sens du Bio…mais cela ne serait plus naturel ! Et pourtant, il y a encore une quinzaine d’années, les micro-organismes génétiquement modifiés n’étaient pas interdits (figurant dans une annexe du règlement donnant la liste des substances autorisées) dans la technologie des aliments Bio…mais le vent a tourné !
L’agriculture biologique est-elle respectueuse de l’environnement ?
Indéniablement oui, et cela devrait être la seule allégation revendiquée, comme cela est le cas dans les pays anglo-saxons. La limitation des rendements et des intrants de produits chimiques (engrais, phytosanitaires…), la promotion de l’élevage extensif diminuent le risque de pollution éventuelle du sol et de l’eau. La pollution par les nitrates et les phosphates est incontestablement l’une des principales causes de l’eutrophisation 5 des eaux de surface (avec prolifération végétale) mais résulte surtout de l’épandage des effluents d’élevage (lisiers) sur de trop petites surfaces. Il est vrai que l’agriculture conventionnelle intensive a tendance, dans le but de maximiser les rendements, à abuser des engrais et des traitements phytosanitaires, ce qui n’est évidemment pas souhaitable. Il faut reconnaître à l’agriculture biologique le mérite d’avoir contribué à tirer la sonnette d’alarme pour limiter les excès.
Cependant, d’autres formes d’agriculture (raisonnée, durable, de précision…), permettent aussi de respecter l’environnement sans renoncer aux bases rationnelles de la production végétale ou animale, sans diminuer les rendements et sans augmenter les coûts de production (et donc les prix de vente). La mesure des conséquences environnementales des pratiques en AB n’est cependant pas prévue dans la réglementation et, par exemple, il y aurait lieu de s’inquiéter de l’utilisation massive de soufre et de cuivre en viticulture à la place de certains fongicides de synthèse, la teneur en cuivre du sol atteignant parfois le seuil de phytotoxicité.
Le développement de l’agriculture biologique est-il durable ?
Actuellement, l’agriculture biologique couvre en France environ 2 % de la superficie agricole (3 % dans l’UE et 0,3 % aux Etats-Unis) et les produits AB (ou Bio) représentent moins de 1,5 % des aliments consommés. Cette part du Bio est donc encore très faible mais la demande tend à augmenter pour diverses raisons : psychoses (souvent non fondées) accrues par les crises alimentaires récentes, suspicion vis-à-vis de l’industrie agroalimentaire, peur irraisonnée du « chimique », préoccupations croissantes de santé, recherche de « naturalité » et des « bons produits d’autrefois », prise de conscience des menaces climatiques et de la baisse des réserves en eau potable… Les motifs écologiques de plus en plus pressants encouragent aussi les pouvoirs publics à soutenir l’agriculture biologique (il existe une agence Bio au ministère de l’Agriculture) qui, il est vrai, favorise aussi l’emploi dans les zones rurales et ne contribue pas aux surproductions périodiques.
Cet encouragement à consommer Bio se traduit parfois par une présentation tronquée et trompeuse de résultats, comme ceux d’une récente enquête CSA / Agence Bio (largement citée par les médias en 2006) présentée comme suit par un grand quotidien : « Près d’un Français sur deux mange Bio ». Le titre du rapport officiel (moins trompeur mais quand même orienté) est : « Près d’un Français sur deux consomme des produits Bio ». Le contenu du rapport d’enquête indique : « 47 % des Français ont consommé au moins un produit Bio au moins une fois par mois en 2005 ». La réalité : 5 à 6 % des Français sont des consommateurs dits réguliers (au moins 6 produits par semaine) mais pas exclusifs d’aliments Bio, lesquels ne représentent pas 1,5 % des aliments consommés… Bel exemple de désinformation pour orienter le citoyen sur la voie souhaitée !
L’agriculture biologique se développera donc pour répondre à la demande croissante de produits Bio qui dépendra elle-même des prix du marché. En effet, les coûts de production des aliments AB sont plus élevés de 20 à 30 % (rendements plus faibles, main d’œuvre pour le désherbage manuel, etc.) ce qui entraîne des prix de vente supérieurs de 20 à 50 % à ceux des aliments conventionnels. Tout dépendra donc, comme dans d’autres secteurs de l’agriculture, des subventions nationales et européennes accordées à l’agriculture biologique que les mouvements écologiques (dont le Pacte écologique), soutenus par les principaux partis politiques, ne manqueront pas de défendre. Tous les consommateurs paieront pour la satisfaction des exigences souvent irrationnelles d’une faible « classe ».
La durabilité de ce mode de culture dépend aussi de celle de la fertilité des sols. En effet, l’autarcie ne peut permettre de maintenir à long terme la fertilité des terres qui dépend de la restitution, par des engrais importés, des éléments minéraux exportés par les récoltes. Le renoncement aux engrais « chimiques » ne pourrait donc pas être généralisé car le maintien de la fertilité des sols en AB ne peut être assuré que par les apports végétaux et animaux (déjections) provenant d’exploitations qui utilisent des engrais ou qui importent des aliments pour animaux (céréales, soja, phosphates… pas toujours Bio et contenant même parfois des OGM !). Pourquoi les engrais « chimiques » ont-ils été inventés il y a deux siècles et pourquoi les pays en développement qui ne peuvent pas les produire ou les acheter en seraient-ils aussi dépendants ?
Concernant les traitements phytosanitaires, que se passerait-il si l’agriculture conventionnelle (98 %) renonçait à leur emploi ? Il est évident que l’on assisterait, comme dans les années 1940, à d’incontrôlables invasions de parasites et insectes ravageurs des cultures. L’agriculture biologique serait donc durable si elle n’était pratiquée que par une minorité des agriculteurs !
Ce développement est aussi déterminé par la demande des aliments Bio et par le fait que de nombreux consommateurs acceptent de les payer plus cher parce que, selon leur croyance et même leur conviction, ils protègent leur santé. Malheureusement, cet argument d’achat n’a pas de justification scientifique.
Les aliments Bio sont-ils meilleurs pour la nutrition et la santé ?
L’agriculture biologique n’a qu’une obligation de moyens mais pas de résultat. Ainsi, la réglementation européenne précise bien : « Aucune allégation ne peut être faite dans l’étiquetage ou la publicité suggérant à l’acheteur que l’indication se référant à l’agriculture biologique constitue une garantie d’une qualité organoleptique, nutritionnelle ou sanitaire supérieure ». Il s’agit bien pourtant de la principale motivation d’achat du consommateur, particulièrement en France. Dans d’autres pays européens, et particulièrement nordiques, l’agriculture biologique est surtout perçue comme un moyen de production respectueux de l’environnement mais ne revendique pas une protection de la santé. Il est évident que le contrôle a posteriori sur le produit étant le plus souvent impossible, la porte est ouverte aux fraudes qui concernent surtout les importations provenant de pays moins exigeants (près de la moitié des aliments Bio est importée) et pour lesquels ce marché représente un bon filon.
Le comportement du consommateur est évidemment dicté par des considérations plus ou moins rationnelles (naturel, écologique, socialement acceptable, équitable, sans produits chimiques…) qu’il serait vain de contester. Cependant, la majorité des consommateurs Bio en France sont également persuadés que manger Bio protège leur santé.
C’est à cette question qu’a voulu répondre un important rapport de l’Afssa publié en 2003 (www.afssa.fr) intitulé « Évaluation nutritionnelle et sanitaire des aliments issus de l’agriculture biologique ». Produit par un groupe de travail ayant réuni et discuté pendant deux années tous les travaux scientifiques publiés sur ce sujet (près de 300 références peuvent être consultées sur le site précédent), ce rapport ne peut être accusé d’être « anti-bio », car ses conclusions ont souvent dû être édulcorées pour obtenir le consensus d’un groupe de travail majoritairement constitué de représentants cooptés de la filière Bio (professionnelle et ministérielle) et de trois scientifiques sympathisants, le rôle joué par les autres experts, minoritaires en nombre, ayant souvent été celui d’« empêcheur de tourner en rond ».

De nombreuses études analytiques ont comparé des aliments provenant de l’agriculture conventionnelle ou biologique mais bon nombre souffrent de protocoles expérimentaux critiquables ou d’absence d’interprétation statistique, ce qui ne permet pas de les prendre en compte. Le rapport de l’Afssa, auquel se réfèrent les résultats et conclusions suivantes, n’a retenu que les études publiées respectant un minimum de critères d’inclusion (notamment une période suffisante de conversion). Le nombre d’études prises en compte est élevé pour certains nutriments (protéines, minéraux) mais plus faible pour d’autres (vitamines autres que A).
À défaut de résultats analytiques comparatifs suffisants, et connaissant les techniques de production et les facteurs de variation de la composition chimique des produits, la méthode déductive a parfois été utilisée. Par exemple, si les principaux facteurs de variation sont pratiquement les mêmes dans les deux cas, il n’y a pas de raison de trouver des différences dans le produit final. Ainsi, les facteurs prédominants qui influent sur la composition chimique des produits sont, dans le cas des plantes, la variété, le stade de développement, le cycle de végétation, la saison et le climat et, dans le cas des animaux, la race, l’âge et le niveau d’engraissement. Il est évident que l’on ne peut comparer le Bio et le non-Bio si les autres facteurs sont différents : par exemple, comparer un poulet « industriel » de 40 jours à un poulet Bio de 80 jours n’a pas de sens, le degré d’engraissement étant très différent (il faudrait alors comparer à un poulet labellisé de même âge et ayant eu accès à un parcours extérieur !).
Valeur nutritionnelle des aliments Bio
De manière générale, l’ensemble des données examinées n’a montré que très peu de différences significatives et reproductibles entre la composition chimique des aliments conventionnels et celle des aliments Bio issus des mêmes variétés ou races et à des stades de récolte ou d’abattage comparables.
La teneur en matière sèche des légumes (mais pas des fruits) est parfois un peu supérieure dans le cas de la production AB mais cette tendance peut aussi être attribuée à des différences de stade de maturité. Aucune influence significative du mode de production n’a été constatée sur les teneurs en glucides, en protéines, en éléments minéraux (sauf une petite tendance favorable pour le magnésium dans les légumes Bio), en oligoéléments et en vitamines (dont le béta-carotène). Concernant les phytomicroconstituants d’intérêt nutritionnel, le mode de production n’influe pas sur les teneurs en lycopène des fruits et légumes mais pourrait augmenter celles en polyphénols, ce qui pourrait aussi être attribué au stade de maturité à la récolte.
La composition des grains, et des graines en général, est quasi-constante et donc très peu sujette à l’influence du mode de production, notamment de la fertilisation. C’est pourquoi les teneurs en minéraux, oligoéléments et vitamines du pain sont déterminées par le taux de blutage de la farine et sont indépendantes du mode de production du blé. Il est ainsi évident que du pain Bio bis (plus riche en son) sera plus riche en éléments minéraux et en fibres que du pain courant de farine blanche. Cela dépend du choix de la catégorie de farine utilisée mais pas du type d’agriculture.
La simple démarche déductive permet de comprendre pourquoi les produits animaux Bio diffèrent si peu des produits conventionnels comparables. En effet, quel que soit le type d’élevage, le mode d’alimentation est approximativement le même et les aliments pour animaux d’origine Bio n’ont pas une meilleure valeur nutritionnelle. De plus, les cahiers des charges AB comportent de nombreuses dérogations qui autorisent, jusqu’à un pourcentage élevé de la ration, le recours « en cas de besoin » à des aliments (fourrages frais ou conservés, céréales, tourteaux…) ne provenant pas de l’agriculture biologique. La jungle des cahiers des charges et des dérogations est assez peu propice à la rigueur des contrôles.
Quelques différences ont été notées pour la composition lipidique des viandes AB, avec une tendance à une plus faible adiposité (taux de lipides) et un profil modifié des acides gras en faveur des acides gras polyinsaturés. Cependant, ces différences sont attribuables à la vitesse de croissance plus faible et à l’activité physique résultant de l’élevage en plein air et, pour les ruminants, à un recours plus important au pâturage. Des animaux élevés en mode conventionnel dans les mêmes conditions plus extensives donneraient des résultats similaires.
La composition chimique du lait est relativement invariable, à l’exception de certains acides gras qui varient en fonction des apports alimentaires, notamment par l’herbe, et de quelques rares oligoéléments comme l’iode et un peu le sélénium. Il en est de même de l’œuf dont la composition ne varie pas, sauf pour certains acides gras insaturés et le bêta La valeur nutritive des œufs d’élevage « industriel » est donc aussi bonne que celle des œufs Bio, ce que le consommateur admet difficilement !
À la différence des herbivores, pour lesquels le recours à l’herbe est plus important (mais pas toujours) en AB, les porcs et les volailles reçoivent une alimentation globalement similaire dans les deux modes d’élevage, les principaux constituants de la ration (95 %) étant dans les deux cas les céréales et les tourteaux de graines oléo-protéagineuses, complétés par des minéraux et vitamines. Il n’y a donc aucune raison, par simple déduction, de trouver des différences de composition des produits puisque les ingrédients consommés sont identiques, qu’ils soient issus ou non de l’agriculture biologique.
Quoi qu’il en soit, la nutrition doit être raisonnée sur le régime alimentaire global qui doit être équilibré et couvrir tous les besoins nutritionnels. De faibles différences éventuelles concernant un nutriment dans quelques aliments particuliers ne peuvent avoir qu’un impact insignifiant sur le statut nutritionnel du consommateur (et même du consommateur considéré régulier de 6 produits Bio par semaine !).
Les prix plus élevés des aliments Bio sont sans doute justifiés par les différences de coût de production mais certainement pas par une meilleure valeur nutritionnelle.
Valeur sanitaire des aliments Bio
La teneur en nitrates de certains légumes (épinard, laitue, poireau…) aurait tendance à être plus faible en production AB mais cette diminution n’est pas systématique. En effet, l’accumulation de nitrates dépend de très nombreux facteurs (ensoleillement, température, pluviométrie), en plus de la disponibilité en azote soluble. Il est vrai que l’apport excessif d’engrais minéraux azotés solubles est un facteur déterminant de la teneur en nitrates, mais pas plus que l’apport de certains engrais organiques rapidement assimilables comme la farine de sang utilisée en maraîchage Bio. Les légumes apportent environ 80 % des nitrates consommés et ces nitrates sont suspectés de se transformer en nitrosamines cancérigènes après leur réduction en nitrites dans l’intestin. En fait, la probabilité de réduction en nitrites est faible et ne présenterait un risque direct que dans les très rares cas de méthémoglobinémie du nourrisson (mauvais transport de l’oxygène du sang), résultant surtout de problèmes d’hygiène du biberon. Quant aux nitrosamines, leur formation dans le tube digestif est encore moins probable.
Même si une forte consommation de légumes verts (recommandée par les nutritionnistes) conduisait à des doses journalières proches de la DJA (dose journalière admissible), il faut savoir que les DJA sont établies pour des consommations quotidiennes régulières et en y ajoutant une très grande marge de sécurité. En fait, les nitrates sont peu toxiques pour les adultes et il faut rappeler que le seuil réglementaire de 50 mg/L fixé pour l’eau du robinet est une norme environnementale (eutrophisation de l’eau) et non pas une norme sanitaire. Cette limite a d’ailleurs été relevée par décret en 2001 à 100 mg/L pour l’eau de boisson.
Les pesticides ou produits phytosanitaires de synthèse sont interdits en AB et il y a donc peu de risque, sauf contamination de voisinage, d’y trouver des résidus. Cependant, le caractère naturel des pesticides autorisés en AB (pyréthrines, roténone, etc.) n’exclut pas pour autant leur toxicité potentielle pour l’Homme et ne devrait pas les exempter de l’évaluation toxicologique exigée pour les substances de synthèse. Il va de soi que tout doit être fait pour limiter les résidus de produits phytosanitaires dans les végétaux et dans l’eau et une nette amélioration de la situation a été constatée depuis quelques années.
Un récent rapport de la DGCCRF (Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes) a fourni les résultats du Plan de surveillance des fruits et légumes pour l’année 2004. L’absence totale de résidus de pesticides a été constatée dans 52,4 % des échantillons, des traces inférieures à la LMR (limite maximale en résidus) dans 43,8 % et des teneurs supérieures à la LMR dans 3,8 % des cas (moins qu’en 2003). De plus, les dosages ayant été effectués sur les produits frais bruts, non préparés, il est évident que le dépassement de la LMR est rare dans le cas de légumes ou fruits épluchés, lavés ou cuits. Le risque peut donc être considéré comme négligeable, d’autant plus que le dépassement ponctuel de la LMR n’est pas synonyme de risque pour le consommateur. En effet, les LMR sont établies en tenant compte des pratiques agricoles les plus critiques et de consommations régulières maximales de tous les produits (hypothèse maximaliste) dans le but de respecter les DJA ou DJT (doses journalières admissibles ou tolérables), elles-mêmes étant calculées avec une grande marge de sécurité (facteur de 10 à 100). Il est indéniable que la plupart des pesticides sont des substances toxiques (notamment suspectées dans la perturbation d’hormones de la reproduction et la cancérogénèse) et que le danger qu’ils présentent doit être minimisé autant que possible. Toutefois, l’exposition à ce danger n’est importante que pour les agriculteurs qui ne prennent pas assez de précautions lors de l’épandage.
Concernant les contaminants chimiques, il importe d’abord de dissiper une idée fausse très répandue selon laquelle les engrais chimiques laisseraient des résidus dans les végétaux. Les aliments ne contiennent pas de « résidus » d’engrais, lesquels sont constitués d’éléments minéraux essentiels, et non toxiques, les mêmes que ceux que contiennent naturellement les plantes ! Il ne faut pas confondre les engrais, qui sont des aliments de la plante, et les pesticides qui sont des médicaments.
Les contaminants chimiques atmosphériques (dioxines, plomb, radio-nucléides…) visent autant les productions végétales Bio que conventionnelles. En revanche, les produits animaux (lait, viande, œuf) présentent un risque de contamination accidentelle plus élevé en mode AB à cause de l’élevage en plein air, ce qui est aussi le cas des productions labellisées ou d’appellation d’origine qui imposent un parcours extérieur. Dans le cas des herbivores au pâturage, la consommation inévitable de terre augmente l’exposition aux substances déposées par rapport à la distribution de fourrages fauchés. Le risque de contamination chimique des sols par certains métaux lourds (cadmium des phosphates) est aussi plus fort en cas d’emploi d’engrais naturels non purifiés. Et que penser du blé « Bio » importé d’Europe de l’Est depuis l’accident de Tchernobyl ? Et que dire de la validité du signe AB attribué à des produits issus de maraîchage ou de pâturage dans des zones péri-urbaines exposées à des retombées de cheminées diverses, dont celles d’usines d’incinération ?
Comme pour les pesticides, l’aliment brut ne peut être incriminé dans l’exposition du consommateur à un risque chimique non acceptable. Comme le montre le Projet européen « Reach » sur les contaminants chimiques toxiques, les aliments tels qu’ils sont fournis par l’agriculture ne seraient pas des vecteurs importants sans les traitements qu’ils reçoivent (chauffage des emballages, grillage au barbecue, fumage) et surtout par rapport à toutes les autres sources de notre environnement quotidien (matériaux de l’habitat et du mobilier, produits de désinfection et d’hygiène, textiles, cosmétiques, matériels électroniques, jouets…), en général beaucoup moins sujets à suspicion. Le principal suspect est toujours l’alimentation car il s’agit d’une « incorporation » directe, par un acte volontaire, périodique et perceptible, même si les résidus chimiques ainsi véhiculés sont négligeables par rapport aux autres sources et si les additifs à but nutritionnel ou technologique qu’elle contient ont fait l’objet de vérifications sévères d’innocuité et d’autorisations officielles, contrairement aux dizaines de milliers d’autres substances chimiques qui ne sont pas homologuées sur des critères de santé publique.
Les teneurs en mycotoxines des aliments, et des céréales en particulier, seront soumises dès juillet 2007 à des normes européennes plus sévères. Or, il s’avère, selon des essais de plein champ conduits en France en 2005 par les Services de la protection des végétaux du Sud-Ouest, confirmant un rapport de l’Afssa de 2004, que le recours au maïs transgénique Bt se révèle plus efficace que les traitements insecticides habituels pour réduire la teneur en mycotoxines. Des résultats similaires seraient obtenus pour le blé dur. Il faut rappeler que ce maïs Bt est obtenu par transfert d’un gène d’une bactérie naturellement présente dans le sol, Bacillus thuringiensis, qui produit une protéine toxique pour les larves de divers insectes, notamment de la pyrale mais aussi d’autres lépidoptères et de diptères, et même pour des champignons. Cette même bactérie figure dans la liste des pesticides autorisés en agriculture biologique par pulvérisation, potentiellement plus toxique pour les insectes pollinisateurs (abeilles, bourdons) que la toxine produite « naturellement » à l’intérieur des organes de la plante et donc moins accessible. Cependant, il n’existe pas de preuves de surmortalité des abeilles butinant du maïs Bt…sinon il faudrait surtout mettre en cause la lutte biologique par le Bacillus thuringiensis ! Alors, pourquoi ne pas adopter le maïs transgénique pour se protéger des mycotoxines, en réduisant simultanément les résidus d’insecticides de synthèse ? Ne serait-ce pas une démarche « biologique » bénéfique pour la santé humaine ?
Des mycotoxines, métabolites secondaires cancérigènes sécrétés par des moisissures (Aspergillus, Penicillium, Fusarium…) qui se développent dans certaines conditions (humidité, température…) au moment de la récolte et du stockage constituent un réel sujet de préoccupation. Il serait logique que leur présence soit plus fréquente dans les produits végétaux non traités par des fongicides et, en fait, des cas de fortes contaminations ont été relevés dans des échantillons Bio, notamment dans des farines de céréales. Cependant, ces contaminations sont très variables et peuvent aussi être réduites par des techniques culturales appropriées. Il n’empêche que la vigilance s’impose et que tout doit être entrepris pour maîtriser ces contaminations dont l’agriculture conventionnelle n’est pas non plus à l’abri. Que doit-on craindre le plus, des traces résiduelles inoffensives de fongicides de synthèse dans les céréales ou des doses dangereuses de mycotoxines ? Ce problème préoccupe actuellement les autorités sanitaires et des pistes de prévention sont à l’étude, notamment par la transgénèse végétale (mais les OGM resteront interdits en AB !).
D’autres toxines peuvent provenir des engrais organiques (fumier, compost) privilégiés dans l’agriculture biologique. Ce problème est particulièrement développé dans le rapport cité de l’Afssa. Quant aux boues d’épuration des eaux usées, leur épandage est interdit.
Enfin, ce qui peut sembler paradoxal, les produits issus de l’agriculture biologique présentent un risque nettement plus élevé de contamination par des bactéries et virus pathogènes et par divers parasites. Comme pour les contaminations chimiques précédentes, la production en plein air des légumes (au lieu de sous serre) et des animaux (au lieu du confinement) augmente la probabilité d’exposition à des vecteurs de parasites et agents infectieux disséminés par les insectes, les excréments de rongeurs (et parfois de renard) et d’oiseaux sauvages. La liste est longue de ces parasites auxquels sont exposés les animaux au pâturage ou sur parcours extérieur (ténia, douve, trichine et autres helminthes, toxoplasmes…) mais il ne faut évidemment pas en exagérer le risque de transmission à l’Homme et de parasitose.
La maîtrise du risque est bien plus difficile dans un élevage biologique en cas d’infestation car, même si le traitement curatif par des médicaments allopathiques 6 et antibiotiques est autorisé (avec un nombre limité de traitements par an) en cas d’urgence et de constat d’inefficacité (habituelle) de l’homéopathie ou de la phytothérapie, il est souvent trop tard pour agir et les traitements préventifs sont interdits, sauf certains traitements antiparasitaires considérés indispensables (pour plus de détails sur les dangers microbiens, viraux et parasitaires, voir le rapport très détaillé de l’Afssa). De même, certains agents infectieux apportés par les engrais organiques et que le compostage ne permet pas de détruire totalement (par exemple les spores bactériennes) persistent dans le sol et sont susceptibles d’être transmis aux animaux. À cet égard, la « pureté » des engrais minéraux, qualifiés de « chimiques », est un réel avantage !
Il est évidemment difficile de faire admettre au consommateur que les œufs de poules d’élevage intensif en batterie, à coquille propre et rapidement emballés et commercialisés après la ponte, présentent un risque de contamination par les salmonelles beaucoup plus faible que les œufs Bio ! Tel est pourtant le cas, mais comment accepter le fait que les œufs « industriels » sont les meilleurs ?
Qualités organoleptiques des aliments Bio
Comme pour les qualités nutritionnelle et sanitaire, et contrairement à d’autres signes de qualité comme le label rouge, l’appellation AB ne confère pas aux aliments une qualité gustative supérieure et les contrôles réalisés dans le cadre réglementaire ne portent pas sur des analyses sensorielles. Quelques rares études ont tenté de comparer les deux modes de production sur des critères spécifiques comme le taux de sucres, l’acidité, la fermeté, mais les conclusions sont peu convaincantes tant les facteurs influant sur ces qualités sont nombreux et indépendants du mode de production. En effet, les principaux facteurs de qualité sont, comme pour la composition chimique, la variété végétale ou la race animale, la vitesse de croissance, le stade de maturation et la fraîcheur des légumes ou des fruits, l’âge et le degré d’adiposité des animaux. Il n’y a donc pas de raison propre au mode de production Bio pour que les fruits, légumes, viandes, lait, œufs et vins soient mieux appréciés des consommateurs, sauf pour la charge symbolique et par les arguments irrationnels qui orientent le choix…et inconsciemment le goût ! Par exemple, les légumes et fruits AB sont souvent de moins bel aspect extérieur que leurs équivalents conventionnels (irrégularité de format, taches, parfois signes d’attaques parasitaires…), mais cela peut paradoxalement constituer des signes valorisants de naturalité et d’absence de traitement !
Il est indéniable que les alarmes récentes (ESB, dioxines, grippe aviaire), même si elles ne sont pas attribuables au seul élevage intensif, ont accru chez le consommateur le souci de l’identité et de la traçabilité des aliments, en un mot de leur « authenticité ». En achetant Bio, et surtout si la production est bien localisée (région, exploitation), il a le sentiment d’être mieux protégé. Attente pourtant vaine et souvent illusoire !
Conclusion
L’objectif de cette mise au point, qui n’a pas la prétention d’être exhaustive, n’est pas de dissuader le consommateur d’acheter des aliments Bio, ses choix étant défendables dans un souci de protection des ressources naturelles (sol, eau) et de satisfaction personnelle reposant sur des croyances et des critères irrationnels mais respectables, mais de contribuer à son information objective pour qu’il fasse ces choix en bonne connaissance de cause. Qu’il sache notamment que les aliments qu’il achète ainsi plus cher ne sont pas meilleurs pour sa santé et que, quoi que d’aucuns puissent en penser, l’agriculture biologique restera limitée à une production de « niche » et à une consommation de « classe », car elle ne pourrait certainement pas permettre aujourd’hui, et encore moins demain, de nourrir l’humanité.

Les références de tous les travaux mentionnés dans cet article peuvent être retrouvées avec précision dans le rapport de l’AFSSA, Évaluation nutritionnelle et sanitaire des aliments issus de l’agriculture biologique.
1 Les produits phytosanitaires, couramment appelés pesticides, sont des substances de traitement des plantes et comprennent les herbicides (détruisant les mauvaises herbes), les insecticides et les fongicides.
2 Un amendement est destiné à modifier la structure ou le pH du sol (amendement calcaire) et son but n’est pas, comme dans le cas des engrais, d’apporter des nutriments à la plante.
3 Les probiotiques, par opposition aux antibiotiques, sont des bactéries vivantes (lactobacilles, bifidobactéries) entrant en compétition avec les bactéries pathogènes dans le tube digestif et susceptibles d’avoir un effet bénéfique sur l’utilisation des aliments et la santé.
4 Plusieurs minerais de phosphate ou de potasse naturels broyés mais non traités « chimiquement » sont autorisés dans les textes réglementaires AB.
5 L’eutrophisation (trop bien nourri) des eaux de surface résulte de l’apport excédentaire d’éléments nutritifs, notamment d’azote et de phosphore, par les engrais et les effluents d’élevage, provoquant un développement non contrôlé de la végétation aquatique et une asphyxie par manque d’oxygène.
6 Le terme « allopathique » désigne tous les médicaments de la médecine classique autres que homéopathiques.
Thème : Agriculture
Mots-clés : Alimentation - Écologie
Publié dans le n° 276 de la revue
Partager cet article
L' auteur

Léon Guéguen
Directeur de recherche honoraire de l’Inra et membre émérite de l’Académie d’agriculture de France.
Plus d'informationsAgriculture
Thèmes connexes : Agriculture et alimentation bio, Alimentation
De l’agriculture de subsistance à la productivité
Le 18 juillet 2012
L’agriculture du Lauragais au milieu du XIXe siècle
Le 12 janvier 2022
Toxicocinétique et glyphosate
Le 13 avril 2021
Et si les plantes n’étaient pas aussi sourdes que leurs pots ?
Le 26 septembre 2019Communiqués de l'AFIS














![[Lyon - Mercredi 28 février 2024 à 20H30] Soirée Ciné-Café : Au pays de l'abeille noire](local/cache-gd2/41/504edd6b853ac09a87f1c6b0378d64.png?1707108191)
![[Paris – Mercredi 19 février 2020] La santé des végétaux : hier, aujourd'hui et demain](local/cache-gd2/ca/eab08e30987d14a14001908dcca94a.jpg?1675293099)