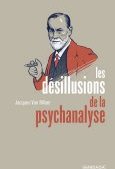Le « dressage pavlovien » des freudiens. Comprendre le conflit psychanalyse - psychologie scientifique
Publié en ligne le 11 septembre 2005 - Psychanalyse -
« La France freudienne »
Jusqu’en février 2004, les psychanalystes français étaient des hommes et des femmes heureux. C’étaient même les psychanalystes les plus heureux de la Terre. La France et l’Argentine sont actuellement les deux pays au monde où il y a le plus de psychanalystes par habitants. La psychanalyse y est omniprésente : les journalistes et les hommes politiques s’épanchent, en grand nombre, sur des divans freudiens ; les psychanalystes contrôlent très largement le secteur de la santé mentale et l’information psychologique diffusée dans les médias. En Argentine, la situation économique joue aujourd’hui en défaveur des longues cures freudiennes. En France, les héritiers de Freud ne peuvent imaginer un meilleur sort. Il n’y a pas longtemps, Élisabeth Roudinesco - historienne et psychanalyste, principale avocate du freudisme dans les médias - écrivait : « La France est le seul pays au monde où ont été réunies pendant un siècle les conditions nécessaires à une intégration réussie de la psychanalyse dans tous les secteurs de la vie culturelle, aussi bien par la voie psychiatrique que par la voie intellectuelle. Il existe donc dans ce domaine une exception française. » ([21], p. 130)
Il y a plus de vingt ans, une sociologue américaine, Sherry Turkle, avait déjà publié une étude fouillée sur « l’exception française ». La traduction française de son ouvrage s’intitule La France freudienne. Turkle a essayé de comprendre pourquoi, selon son expression, « toute la France est passée à la psychanalyse », après mai 68. Elle écrit : « Le mouvement psychanalytique français a peut-être été lent à démarrer, mais son développement a ensuite été explosif. Le vocabulaire psychanalytique a envahi la vie et le langage, transformant la manière dont les gens pensent en politique, discutent de littérature, parlent à leurs enfants. Les métaphores psychanalytiques ont infiltré la vie sociale française à un point qui est sans doute unique dans l’histoire du mouvement psychanalytique. Même aux États-Unis les choses ne sont jamais allées aussi loin. » (1982, trad., p. 25)
Cela fait un quart de siècle que, lorsque paraît en France un ouvrage qui remet fondamentalement en question la psychanalyse, la grande presse n’en parle pas ou confie sa présentation à un psychanalyste. Les impostures intellectuelles de Sokal et Bricmont a été une remarquable exception. Notons toutefois que ce livre ne remet en question que les fantaisies pseudoscientifiques de Lacan et de ses imitateurs. Il ne s’attaque pas aux fondements de la doctrine freudienne.
À titre d’exemple de présentation dans la presse d’un ouvrage qui démontre les faiblesses de la psychanalyse comme telle, citons le compte rendu du livre d’Adolf Grünbaum, Les fondements de la psychanalyse, paru en français en 1996. Le journaliste du Monde a conclu son analyse par ces mots : « L’ironie mordante qui sourd à chaque page de ce livre érudit trahirait-elle le projet véritable de cette entreprise : l’éradication de la psychanalyse et du traitement mis au point par Freud, qui ne laisserait aux malades d’autre choix que les antidépresseurs ? » (27-12-1996 ; je souligne). À en croire ce journaliste et la majorité de ses confrères, les Français qui souffrent de troubles psychologiques n’ont qu’une alternative : la psychanalyse ou les médicaments. L’énorme développement de la psychologie scientifique et de ses applications, sous la forme de thérapies dites « comportementales » et « cognitives », se trouve ainsi ignoré ou passé sous silence.
On comprend mieux dès lors ce paradoxe apparent, que rapporte Roudinesco : « La France est aujourd’hui le pays d’Europe où la consommation des psychotropes (à l’exception des neuroleptiques) est la plus élevée et où, simultanément, la psychanalyse s’est le mieux implantée, aussi bien par la voie médicale et soignante (psychiatrie, psychothérapie) que par la voie culturelle (littérature, philosophie). [...] La consommation de tranquillisants et d’hypnotiques touche en France 7 % de la population, et celle des antidépresseurs, en augmentation constante, 22 %. » ([21], p. 32)
Comment se fait-il que la « France freudienne » est le pays où l’on consomme le plus de psychotropes au monde ? En fait, peu de gens peuvent se payer une cure psychanalytique. D’autre part, bon nombre de médecins généralistes et de pédiatres constatent l’absurdité et l’inefficacité des interprétations freudiennes, mais ignorent l’existence des thérapies comportementales et cognitives (TCC) ou n’en connaissent que des caricatures. Quand bien même ils disposent d’une information correcte sur ces thérapies, ils ne peuvent trouver facilement un praticien disponible. Ils ne leur reste donc, comme outils thérapeutiques, qu’à donner quelques conseils et prescrire des médicaments.
Dans un pays comme la Hollande, qui compte le plus de thérapeutes comportementalistes par habitants, la consommation des psychotropes est une des plus faibles qui soit. Ce n’est pas un hasard.
L’étude de l’Inserm
La situation monopolistique de la psychanalyse en France a subi un coup terrible en février 2004 : la publication d’un rapport de l’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale) sur l’efficacité des psychothérapies.
Il y a trois ans, la Direction générale de la Santé, l’Union nationale des amis et familles de malades psychiques (UNAFAM) et la Fédération nationale des associations d’ex-patients de psychiatrie (FNAP-Psy) ont demandé à l’Inserm de procéder à une étude de l’efficacité de trois types de psychothérapies : la psychanalyse (et les thérapies dites « dynamiques »), la thérapie familiale et les TCC.
Les experts de l’Inserm (psychiatres, psychologues, épidémiologistes et statisticiens) ont analysé plus de 1000 recherches publiées dans la littérature scientifique internationale. Bien entendu, il s’agit essentiellement recherches anglo-saxonnes. Difficile de faire autrement : dans la « France freudienne », il n’existe pratiquement aucune étude objective et méthodique sur les effets de la psychanalyse. Dans les pays latins, les freudiens se sont toujours contentés d’études de cas, de discours théoriques et d’affirmations péremptoires, basées sur les textes de Freud, de Lacan et quelques autres Autorités.
L’étude de l’Inserm a conclu à une efficacité nettement supérieure des TCC par rapport à la psychanalyse et aux thérapies familiales, pour presque tous les troubles envisagés. Des trois approches, la moins efficace est la psychanalyse. Ses résultats pour les troubles mentaux sérieux sont du niveau de celui du placebo. L’efficacité des thérapies familiales et systémiques se situe à un niveau intermédiaire, entre les TCC et la psychanalyse.
Les gains thérapeutiques des TCC sont importants, beaucoup se maintiennent pendant des mois et même des années après la thérapie. Les études scientifiques examinées démontrent l’absence de déplacement ou de substitution de symptômes, contrairement à ce qu’affirme une légende freudienne [27][28].
Pour qui connaît la littérature scientifique internationale sur la psychothérapie, cette conclusion n’a rien d’étonnant. Aux yeux des mandarins de la psychanalyse, il est absolument intolérable que l’Inserm l’ait rendue publique.
Et la réaction de freudiens
La psychanalyse est un job en or : un job facile et qui rapporte gros. Tout le monde sait qu’il rapporte gros. N’insistons pas sur cette évidence. Arrêtons-nous un instant au fait qu’il s’agit d’un métier facile.
Freud lui-même, en présentant sa méthode, écrivait qu’« elle est beaucoup plus facile à appliquer qu’on ne l’imagine lors de sa description » ([8], p. 7). De son côté, Lacan déclarait : « Qu’est-ce que la clinique psychanalytique ? Ce n’est pas compliqué. Elle a une base - C’est ce qu’on dit dans une psychanalyse. En principe, on se propose de dire n’importe quoi, mais pas de n’importe où - de ce que j’appellerai pour ce soir le dire-vent analytique... On peut aussi se vanter, se vanter de la liberté d’association, ainsi nommée... Évidemment, je ne suis pas chaud-chaud pour dire que quand on fait de la psychanalyse, on sait où on va. La psychanalyse, comme toutes les autres activités humaines, participe incontestablement de l’abus. On fait comme si on savait quelque chose. » ([18], p. 7)
À noter toutefois que ce même Lacan a inauguré, à partir des années 60, un stratagème destiné à occulter la facilité de la pratique freudienne, à savoir : les « barbelés verbaux », le langage ésotérique. Ainsi Lacan pouvait dire, par exemple, en terminant une interview à la télévision : « L’interprétation doit être preste pour satisfaire à l’entreprêt. De ce qui perdure de perte pure à ce qui ne parie que du père au pire » [17]. À l’époque où j’étais encore membre de l’Ecole belge de psychanalyse, des collègues ont passé deux soirées à analyser ces deux phrases et ont fini par y trouver la castration, le Nom-du-Père et la problématique du Phallus. Lacan pouvait se permettre de dire n’importe quoi. Ses disciples trouvaient toujours un sens profond dans le dire-vent analytique. Lacan était un génie... de la mystification par les mots.
Revenons à la facilité de la pratique freudienne. Que fait, au juste, le psychanalyste ? Essentiellement trois choses :
- écouter en état d’attention flottante, c’est-à-dire sans faire d’effort d’attention consciente,
- émettre régulièrement des « mhms », pour assurer le client1 qu’il est écouté et qu’il a intérêt à continuer à associer « librement »... dans la direction conforme à la théorie,
- donner de temps en temps des interprétations, tantôt compréhensibles, tantôt énigmatiques.
Le décodage psychanalytique est très simple : il consiste pour une large part en découpages de mots « signifiants » et en repérages d’analogies ou de significations symboliques. C’est à la portée de toute personne qui a terminé le lycée et qui a lu quelques livres de psychanalyse. Lorsque le client pose des questions embarrassantes, il suffit de les lui retourner : « Pourquoi posez-vous cette question ? », « Qu’est-ce que cela interpelle ? », etc. Les critiques et les oppositions du client sont interprétées comme des « résistances », des « dénégations » ou des manifestations d’un « transfert hostile ». Elles ne remettent jamais l’analyste en question.
Or voilà que ce maudit rapport de l’Inserm conclut qu’en ce qui concerne l’efficacité thérapeutique de la psychanalyse, le roi est nu. On comprend la fureur des freudiens.
Pour répondre à l’étude de l’Inserm, les analystes ne sont pas en mesure de se situer au niveau scientifique. La réaction a donc été la sempiternelle objection concernant l’impossibilité de mesurer le psychisme ou l’âme. Je dis bien « l’âme », car la psychanalyse ne s’intéresse guère aux comportements, mais seulement aux profondeurs de « l’âme ». Je rappelle, en passant, que Freud, jusqu’à la fin de sa vie, a défini la psychanalyse comme « ein Stück der Seelenkunde » [une partie de la science de l’âme] ([12], p. 142).
La colère des freudiens s’est portée d’une part vers les chercheurs de l’Inserm. Ainsi Pascal-Henri Keller (maître de conférences à l’université Victor-Segalen, Bordeaux-II) déclare, dans Libération, que les auteurs de l’INSERM sont « les nouveaux barbares » et il les compare aux nazis qui ont brûlé les livres de Freud (21 avril 04). Hallucinant !
La colère des freudiens s’est portée, d’autre part, vers les thérapeutes comportementalistes, que jusqu’alors ils ignoraient superbement.
Ainsi, Jacques-Alain Miller, philosophe-psychanalyste, gendre de Lacan et porte-parole des lacaniens de France, écrit dans L’orientation lacanienne III du 24 mars : « Les thérapies cognitivo-comportementales ne sont pas à proprement parler des psychothérapies, mais des pratiques de rééducation et de conditionnement. » Le même Miller déclare, dans L’Express du 23-02-2004 : « Les thérapies cognitivo-comportementales favorisent le court terme. Comme la Bourse, elles sacrifient l’avenir pour embellir la réalité. Pis, ce sont des méthodes cruelles qui passent par l’exposition du sujet au trauma lui-même - par exemple en mettant un patient phobique des cafards devant des cafards. La première fois, il hurle, la deuxième fois un peu moins et, au bout de quelque temps, on considérera qu’il est guéri ! C’est du maquillage : les effets, s’ils existent, sont transitoires ou superficiels, quand ils ne se révèlent pas nocifs. En cela, l’efficacité des TCC repose uniquement sur l’autorité de l’expérimentateur, qui se pose en expert, en chef de commando. [...] La psychanalyse est le refuge de l’unique, de l’approche sur mesure dans un monde qui ne rêve que de clonage. »
Qui ne rêve que de clonage ? Quelques biologistes, des gens qui élèvent des brebis, Raël et ses disciples... Le monde entier ? JAM - c’est ainsi que l’appellent ses amis - a de curieux fantasmes, qui en disent beaucoup plus sur sa personnalité que sur les TCC. Sa façon de présenter les TCC est une caricature honteuse, bien plus choquante que le film Un divan à New York, qui montre que n’importe qui, s’il présente bien et s’il n’est pas idiot, peut s’improviser psychanalyste.
Arrêtons-nous un instant à cette affirmation de JAM : « La psychanalyse est le refuge de l’unique, de l’approche sur mesure ». Quelle est la réalité des faits, au-delà du discours racoleur sur « la singularité du Sujet » ?
Voici ce qu’écrivait Abraham Kardiner, dans le journal qu’il a tenu à l’époque où il faisait sa psychanalyse didactique chez Freud : « En comparant mes notes avec celles d’autres étudiants, je me suis aperçu que l’homosexualité inconsciente, tout comme le complexe d’Œdipe, faisait partie de la routine d’une analyse. [...] Une fois que Freud avait repéré le complexe d’Œdipe et conduit le patient jusqu’à son homosexualité inconsciente, il ne restait pas grand-chose à faire. On débrouillait le cas du patient et on le laissait recoller les choses ensemble du mieux qu’il pouvait. Quand il n’y réussissait pas, Freud lui lançait une pointe par-ci par-là afin de l’encourager et de hâter les choses. » ([16], p. 92 ; 125)
À y regarder de près, on constate que la « profondeur » freudienne se réduit toujours à quelques mêmes pulsions et complexes, absolument universels : la libido réprimée, l’envie du pénis, l’homosexualité refoulée, les fixations orales et anales, le schéma familialiste, l’Œdipe et la castration. Un psychologue scientifique dirait que x % d’enfants, de tel âge, vivant dans telle culture, présentent des tendances œdipiennes. Le psychanalyste, lui, affirme que le complexe d’Œdipe est universel. Si le complexe n’est pas directement observable chez tel enfant, il est tout simplement « refoulé ». L’interprétateur freudien - via des analogies, des symboles, des jeux de mots et le recours à la sublimation et à la formation réactionnelle - n’a aucune difficulté à aboutir au schéma général, fixé une fois pour toutes.
Autre échantillon de la prose vengeresse des freudiens blessés par l’expertise de l’Inserm : Roland Gori (professeur de psychopathologie à l’université d’Aix-Marseille) déclare, dans Le Monde du 26 février : « Les TCC, c’est un dressage pavlovien [...] On est dans la soumission librement consentie. Politiquement c’est dangereux : il suffit de se reporter aux travaux d’Hannah Arendt ou de Michel Foucault [...] Le rapport de l’Inserm est une machine de guerre contre la psychanalyse. Avec, derrière, des arrière-pensées économiques : s’emparer du marché juteux de la santé mentale. Ce rapport n’est que l’annonciation de ce qu’Elizabeth Roudinesco appelle « l’homme comportemental ». »
C’est cette expression « dressage pavlovien » qui m’a donné l’idée et le titre de la présente conférence.
Tous les psychanalystes ne font pas preuve d’une pareille ignorance combinée à la mauvaise foi. Un Daniel Widlöcher par exemple écrivait, il n’y a pas longtemps :
« Ce qui constitue la force des thérapies comportementales n’est pas le simple fait que l’on dise au sujet ce qu’il doit faire ; c’est que les prescriptions qui lui sont faites se fondent sur une analyse minutieuse des symptômes. Le comportementaliste ne se contente pas de constater qu’il existe une phobie des transports, ni même que cette phobie s’applique à la conduite automobile ou au voyage en avion. Il note avec précision dans quelles conditions précises l’angoisse se développe : à la pensée de monter dans le véhicule, à l’évocation d’une immobilisation forcée ou durant le transport ? C’est cette analyse qui permet de déterminer les circonstances et le seuil exact de déclenchement de l’angoisse ; la prescription en tiendra compte. Elle ne consistera pas en un conseil général, mais indiquera dans quelles situations très précises le patient devra forcer son appréhension et accepter une certaine quantité d’angoisse. Pour lutter contre l’intoxication tabagique, on fera l’inventaire des circonstances et des moments qui conditionnent l’acte de fumer, et c’est en fonction de cet inventaire qu’une lutte fractionnée et progressive sera indiquée » ([29], p. 31). Hélas, des psychanalystes comme Widlöcher sont peu nombreux. Ils sont quasi inexistants dans les rangs des lacaniens purs et durs.
Pour remettre les pendules à l’heure, il me paraît utile de développer trois points :
- préciser ce que l’on entend par « conditionnement » et « comportement » ;
- expliquer ce qui fait réellement la spécificité des TCC ;
- rappeler que la psychanalyse est une forme subtile, mais d’autant plus puissante, de conditionnement des esprits.
Le « conditionnement »
Le mot « conditionnement » est utilisé de façon péjorative et polémique par des psychanalystes dès qu’ils parlent des psychothérapies et, en particulier, des TCC. Dans leur bouche, ce mot désigne le dressage et la manipulation mentale. En fait, la signification la plus générale de ce mot - qui vient de « condition » - est : « ce qui conditionne une chose, c’est-à-dire sans quoi elle n’existerait pas », comme le précise par exemple le dictionnaire philosophique de Foulquié ([7], p. 117).
Dans la psychologie scientifique, ce mot a un sens neutre. Il désigne un type d’apprentissage, dans lequel les contingences environnementales jouent un rôle déterminant (en particulier l’apprentissage « pavlovien ») ou bien les conditions environnementales d’un comportement, qui favorisent son apparition, son maintien ou sa disparition.
Ainsi, pour l’instant, je vous « conditionne » à m’écouter. Autrement dit, j’adopte des comportements qui sont la « condition » de votre attention. Réciproquement, vous me conditionnez à continuer à parler. Si vous n’écoutiez plus ou si vous vous mettiez à siffler, je cesserais de parler. Tout comportement dépend d’une constellation de « conditions ». C’est en ce sens qu’il est « conditionné ».
A l’intention de ceux qui sont mal informés sur le conditionnement « pavlovien », je rappelle qu’il s’agit d’un type d’apprentissage au cours duquel un élément de l’environnement acquiert une nouvelle signification, suite à son association avec un autre élément. Lorsqu’un chien entend régulièrement le pas de celui qui lui apporte de la nourriture, l’audition de ce bruit finit par provoquer à peu près les mêmes réactions physiologiques que la vue de la nourriture. Si vous êtes victime d’une agression dans un parking, le parking prendra pour vous la signification d’un endroit dangereux. Le fait d’y retourner provoquera, au moins pendant un certain temps, une réaction d’anxiété. Chez Jacques-Alain Miller, le mot « Inserm » provoque, depuis février, une poussée d’adrénaline. Chez lui, certaines « conditions » ou « contingences » ont modifié, sans doute pour longtemps, la signification de cet acronyme. C’est cela le conditionnement « pavlovien ».
Vu la signification ambiguë du mot « conditionnement », certains psychologues, comme moi, ne l’utilisent quasi plus. Le processus analysé par Pavlov, il y a un siècle, s’explique parfaitement à l’aide des concepts d’apprentissage et de signification.
Le mot « comportement »
Autre notion ambiguë : le « comportement ». Les psychologues scientifiques ont choisi ce concept comme unité de base de leurs observations parce qu’ils veulent travailler de façon scientifique. L’âme, l’esprit, la volonté, l’inconscient et autres entités mentales ne sont pas des réalités que l’on peut étudier directement de façon objective. Les seuls faits sur lesquels les chercheurs peuvent s’accorder et qu’ils peuvent prendre comme point de départ de leurs constructions - pour éventuellement parler de volonté ou de processus inconscients -, ce sont des comportements observables, leurs conditionnements environnementaux et leurs corrélats physiologiques.
Les psychologues utilisent malheureusement le terme « comportement » de deux façons différentes. Au sens étroit, il désigne une action manifeste, directement observable, qui se distingue des phénomènes psychiques « internes » (les cognitions et les affects). Dans son acception large, il désigne toute activité signifiante, directement ou indirectement observable. Il présente alors trois dimensions : une composante cognitive (perception, souvenir, réflexion, etc.), affective (plaisir, souffrance, indifférence) et motrice (action, expression corporelle). Mis à part les réflexes élémentaires, tout comportement présente ces trois éléments. En définitive, toute analyse d’un comportement implique de prendre en compte six variables :
• ses trois dimensions : cognitions, affects, actions
• le ou les stimuli antécédents
• la ou les conséquences anticipées
• l’état de l’organisme.
La naissance du courant cognitivo-comportemental
Dans les années 1950, en différents endroits de la planète, des psychiatres et des psychologues ont développé des formes de psychothérapie basées sur la psychologie scientifique. Ils les ont appelées « thérapies comportementales » (T.C.).
Les principaux artisans de ce nouveau paradigme furent un psychiatre sud-africain, Joseph Wolpe (qui avait été d’abord psychanalyste), un psychologue clinicien anglais, Hans Eysenck2, et un psychologue expérimentaliste américain, Fred Skinner.
Contrairement aux autres courants, les T.C. ne sont pas l’œuvre d’un Père-fondateur. La théorie de référence n’est pas consignée dans des textes sacrés, que les disciples lisent et commentent à l’infini. La théorie de référence est la psychologie scientifique, c’est-à-dire un ensemble de connaissances relativement bien vérifiées, mais qui évoluent à travers le temps. Dès lors, la manière de pratiquer des T.C. aujourd’hui n’est plus celle de 1960, l’année où l’expression « behaviour therapy » apparut pour la première fois dans le titre d’un ouvrage (un recueil d’articles édité par Eysenck à Londres).
On peut définir les thérapies comportementales comme l’utilisation de la psychologie scientifique pour résoudre des problèmes psychologiques ou encore des procédures, testées méthodiquement, qui traitent des troubles psychologiques grâce à l’apprentissage de nouveaux comportements : des modes de penser, d’éprouver et d’agir.
L’adjectif « comportemental » ne signifie pas une focalisation exclusive sur l’action, même si les comportementalistes attachent une grande importance à celle-ci. Il indique avant tout qu’il s’agit d’une thérapie fondée sur la psychologie définie comme « science du comportement ».
Le mot « thérapie » est souvent préféré à « psychothérapie », parce que le préfixe « psycho » évoque l’âme. Le comportementaliste ne travaille pas sur l’âme, mais sur des comportements, entendus au sens large du terme : des pensées, des émotions et des actions.
Dans les années 60, s’est développé un courant de « thérapie cognitive ». L’initiative en revient principalement à Albert Ellis et Aaron Beck, deux psychanalystes américains, insatisfaits du manque de scientificité du freudisme et de sa faible efficacité. Ils ont développé l’idée que, lorsque les problèmes psychologiques sont sérieux, il ne suffit pas que le patient parle, se souvienne et exprime des émotions, tandis que le thérapeute écoute, analyse et communique des interprétations « profondes ». Pour eux, il faut repérer des schémas de pensée et des croyances dysfonctionnelles en vue de les modifier de façon active et méthodique.
Durant les années 70, ces deux courants se sont intégrés dans ce que l’on a appelé la ou les « thérapies cognitivo-comportementales » (le singulier met l’accent sur les dénominateurs communs des procédures, le pluriel met en avant leur diversité). Cette expression s’est imposée en France (le pays occidental où le rejet du « behaviorisme » a été le plus fort), mais pas partout. Aux Pays-Bas par exemple, les praticiens qui se définissent simplement comme « comportementalistes » utilisent le mot au sens large et tiennent évidemment compte de « comportements cognitifs ». Bien plus, en principe tout « comportementaliste » sérieux travaille avec les six variables de l’équation comportementale que nous venons d’évoquer. L’expression « thérapie contextuello-bio-cognitivo-affectivo-praxique » serait plus juste, mais elle n’est guère utilisable, même sous la forme d’un acronyme (« TCBCAP »). Ici, pour faire bref, je parlerai de « thérapie comportementale » ou de « TCC ».
Du point de vue théorique, les meilleures expressions sont peut-être « psychologie scientifique appliquée » ou « psychothérapie d’orientation scientifique ». Malheureusement, le mot « science » est souvent mal compris dans le public : tantôt il fait croire naïvement que l’expert possède la « Vérité » ou une collection de certitudes, tantôt il suscite des résistances chez ceux qui s’imaginent que démarche scientifique et respect de la personne sont incompatibles. Tout particulièrement en France, le thérapeute qui utiliserait ces expressions se ferait facilement étiqueter « positiviste » ou « scientiste », du moins par ceux que Jacques Bouveresse[3] appelle les « littéraristes » et qui ont aujourd’hui le vent en poupe dans les médias.
L’ancrage des TCC dans la psychologie scientifique fait qu’elles évoluent de façon continue, tant au niveau des procédures que des références théoriques. Les praticiens diffèrent en fonction notamment des problèmes qu’ils traitent, de leur expérience personnelle et de leur connaissance des recherches scientifiques. Cependant, au-delà de la multiplicité des variantes possibles, tous se caractérisent par un objectif (modifier de façon tangible des conduites), le choix d’un moyen (la démarche scientifique) et un style d’interaction avec le patient (que l’on peut qualifier de « pédagogie démocratique »). Explicitons ces trois points.
L’objectif est de modifier concrètement, de façon observable, des comportements que le patient souhaite changer.
Les objectifs de changement sont définis au terme d’un dialogue. Le thérapeute aide le patient à formuler des objectifs réalistes et concrets, qui tiennent compte de son bien-être, à plus ou moins long terme, et de la qualité de ses relations avec autrui.
Dans certains cas, le thérapeute limite son aide à une demande explicite et bien délimitée (p. ex. se débarrasser de la phobie invalidante de prendre le métro ou de parler en public). Dans d’autres, un traitement efficace implique d’élargir sensiblement le ou les objectifs. Ainsi la personne qui veut se libérer de la dépendance à l’alcool ne peut se contenter d’une technique de contrôle des impulsions à boire à contretemps : elle doit également développer son répertoire d’activités agréables « concurrentes », elle doit apprendre des stratégies pour mieux réguler les émotions pénibles et affronter des situations stressantes, etc.
En définitive, c’est toujours le patient qui décide les buts à atteindre et le degré d’engagement dans le processus d’apprentissage.
Le souci de scientificité
L’approche comportementale ne se définit pas d’abord par un ensemble de procédures, ni une théorie - pas même la théorie actuelle de l’apprentissage. Sa principale caractéristique est de fournir une aide psychologique en gardant le souci de scientificité, c’est-à-dire de vérification soigneuse des hypothèses de travail et des effets des pratiques. Comme en médecine, le souci de scientificité n’exclut nullement une attitude respectueuse et chaleureuse. Ce n’est pas seulement une question d’éthique, mais encore d’efficacité : de nombreuses recherches scientifiques ont montré l’importance de ces facteurs affectifs. Le comportementaliste respecte et écoute son patient, il lui témoigne de la sympathie, tout en évitant les dérapages affectifs et sexuels,... qui ne sont pas rares dans la pratique du divan.
Le style du thérapeute : collaboration, transparence, incitation à l’action
- Le comportementaliste n’est pas un gourou. Il agit comme un pédagogue respectueux de l’« apprenant », soucieux de le faire accéder rapidement à davantage d’autonomie. Il évite l’établissement d’une relation caractérisée par l’obéissance à l’autorité, l’affection ou l’amour. Il s’efforce d’instaurer une ambiance de travail, sereine et sympathique.
- Le thérapeute explicite en toute clarté les principes, les objectifs, les méthodes, les contrats, les critères d’évaluation, les résultats. Il propose éventuellement des lectures, qui permettent au patient de bien comprendre les processus qui le perturbent et la logique du traitement. Il s’abstient d’utiliser un jargon incompréhensible visant à impressionner.
- Le patient qui veut se libérer de réactions bien ancrées ne peut se contenter de parler et de recevoir des interprétations pendant une ou deux heures par semaine. Il doit effectuer, dans la vie quotidienne, des « tâches thérapeutiques », c’est-à-dire des observations méthodiques et des essais de nouveaux comportements.
Les procédures varient considérablement, raison pour laquelle mieux vaut utiliser le pluriel « thérapies (cognitivo)comportementales ».
Un exemple de traitement comportemental
Je m’en tiens ici à un type de traitement et un exemple : le traitement de la phobie des araignées, que je pratique moi-même. Je n’ai pas encore traité une phobie des cafards, sur laquelle fantasme Mr. Miller. Les principes sont les mêmes.
La personne qui souffre d’une peur très intense des araignées, même non dangereuses, peut essayer de se souvenir du point de départ de cette phobie. Le rappel ne manque pas d’intérêt. Toutefois, contrairement à une opinion largement répandue, le ressouvenir de l’expérience princeps n’est pas nécessaire et, d’autre part, elle n’est pas suffisante pour se libérer du problème. Beaucoup de personnes se souviennent parfaitement du traumatisme qui est au départ d’une phobie sans que cela modifie leur réaction émotionnelle !
Un psychanalyste peut croire que la peur des araignées tient au symbolisme de cet animal. Selon Freud, « l’araignée est, dans le rêve, un symbole de la mère, mais de la mère phallique, qu’on redoute, de sorte que la peur de l’araignée exprime la terreur de l’inceste avec la mère et l’effroi devant les organes génitaux féminins. » (1933, G.W., XV, p. 25 ; trad., 1984, p. 36)
Un psychanalyste lacanien insistera sur ce que Freud appelait « l’interprétation par mots-ponts » (« Wort-Brücke ») et que Lacan a rebaptisé « décomposition signifiante ». Il pourra penser que la peur de l’araignée signifie la négation d’un arrêt. En effet, dans « araignée », il entend : « arrêt nié ».
Que fait un comportementaliste ? Sûrement pas un « dressage » pavlovien ou autre.
En principe, il va d’abord inviter le patient à s’informer correctement sur les araignées, par exemple par la lecture d’un ouvrage scientifique (pas un film d’horreur, bien entendu). Le patient doit apprendre, de façon objective, quelles araignées sont dangereuses et lesquelles ne le sont pas. En Belgique, le problème est simple : il n’y a pas d’araignées réellement dangereuses. La situation est différente déjà dans le Sud de la France, pour ne pas parler des pays africains.
Deuxième étape : le patient est invité à apprendre comment se calmer lorsqu’il a peur. Trois apprentissages s’avèrent ici importants et parfois nécessaires :
- Apprendre à contrôler la respiration, c’est-à-dire, dans la plupart des cas, freiner l’hyperventilation, essayer de respirer surtout par le ventre et expirer le plus lentement possible. Pour les personnes qui réagissent par des paniques, des exercices méthodiques sont généralement nécessaires.
- Apprendre à diminuer rapidement le tonus musculaire. Ceci implique des exercices méthodiques de relaxation « comportementale »
- Apprendre à utiliser des auto-instructions. Il ne s’agit pas simplement de la méthode Coué, qui consiste à se répéter une même formule générale. Les auto-instructions sont des formules brèves et précises, qui permettent de lutter contre les idées dramatisantes induites par une situation phobogène.
Lorsque ces nouvelles compétences sont acquises, le thérapeute propose au patient de passer à l’action, de façon progressive, par étapes. Certes, il importe de parler et d’essayer de changer des idées, mais la procédure la plus efficace pour restructurer un schéma de pensée - en l’occurrence la dangerosité des araignées - est de recourir à l’action. Pas plus qu’on apprend à nager en se contentant de parler de natation, on ne peut éliminer une réaction émotionnelle intense et bien ancrée en se limitant à l’usage de mots.
Avec l’accord du patient, le thérapeute commencera par montrer une toute petite araignée enfermée dans un bocal. Le bocal sera mis à la distance souhaitée par le patient.
Les étapes suivantes seront :
– Des petites araignées, dans bocal fermé, à proximité
– Toucher et bouger le bocal
– Ouvrir le bocal. Mettre la main sur le bocal
– Laisser une petite araignée en liberté sur une table
– Toucher avec un crayon une petite araignée
– Toucher et bouger un bocal fermé contenant une grosse araignée
– Capturer une araignée sur une surface lisse à l’aide d’un bocal et d’un morceau de carton
– Toucher brièvement une petite araignée
– Faire descendre dans la main une araignée dans un bocal ouvert et retourné
– Laisser l’araignée circuler sur la main et le bras
– Capturer des araignées sans le thérapeute, à plusieurs reprises.
À chacune de ces étapes, le thérapeute fait d’abord la démonstration. Avant que le patient ne touche l’araignée, le thérapeute doit l’avoir fait devant lui. Pour passer d’une étape à la suivante, le thérapeute demande toujours l’accord du patient.
Grâce à ces exercices de confrontation - que l’on appelle « exposition », « immersion » ou « désensibilisation » - le patient apprend deux choses. D’une part, il modifie sa perception des araignées. La signification qu’il attribuait à ces animaux se modifie « profondément », durablement, à moins que, par suite, il fasse une expérience réellement pénible. D’autre part, le patient apprend comment gérer une forte réaction émotionnelle, en l’occurrence la peur. Il expérimente l’efficacité de la régulation de la respiration et du tonus musculaire, ainsi que la possibilité de piloter le flux des idées et de neutraliser les idées de catastrophes par d’autres idées, consciemment et volontairement mises au point. On est aux antipodes de la thérapie « cruelle » imaginée par Mr Miller : le thérapeute n’est pas, pour reprendre son expression, « un chef de commando » ; le patient ne « hurle » pas, il n’est pas traumatisé.
La peur des araignées disparaît après quelques heures d’exercices. Cette peur n’est pas remplacée par un autre symptôme. Tout au contraire : on observe un effet boule-de-neige positif. Le patient qui a pu gérer et faire disparaître sa phobie des araignées constate une amélioration de l’estime de soi et, plus précisément, la disparition quasi automatique de la peur d’insectes qui lui faisaient moins peur, par exemple les cloportes et les cafards. Si d’autres animaux lui faisaient davantage peur, par exemple les serpents, il devra à nouveau s’entraîner, mais l’apprentissage sera grandement facilité par les habiletés déjà acquises.
Comme en médecine, certains troubles se traitent aujourd’hui bien et facilement, d’autres pas encore ou peut-être jamais. Par exemple, le traitement d’une phobie simple se fait généralement en quelques séances, sans qu’il y ait ensuite des rechutes, au contraire ; celui d’un trouble obsessionnel, en quelques mois et connaît souvent des rechutes ; celui d’une toxicomanie bien ancrée est long, difficile et s’accompagne quasi toujours de rechutes. Les personnalités antisociales et paranoïaques ne changent quasi pas.
Comme dans tout processus d’apprentissage, les résultats des thérapies comportementales dépendent de divers paramètres : l’état de la personne au départ, l’importance qu’elle attache au changement, l’existence de procédures efficientes, la compétence et la notoriété du thérapeute, la qualité de la relation avec lui, l’anticipation d’effets positifs, l’adhésion à la méthode, les efforts mis en œuvre, le degré de satisfaction éprouvé suite à des changements, les réactions de l’entourage, la capacité de relativiser des échecs momentanés, etc.
Mensonges freudiens sur l’efficacité
Les résultats thérapeutiques de la psychanalyse ont été, dès le début, médiocres. Freud a maquillé des échecs en soi-disant guérisons. À partir des années 1920, il a préféré passer son temps à faire des analyses didactiques, plutôt que d’encore essayer de traiter des personnes souffrant de troubles sérieux. Il a formé des élèves, qui ont été reconnus analystes par lui à condition d’adopter très précisément ses schémas d’interprétation. Des « clones » en quelque sorte. (Je parle de « clone », au sens où l’entend Mr. Miller).
Sur la question des mensonges freudiens, je renvoie aux ouvrages d’historiens de la psychanalyse. Je cite en premier lieu Henri Ellenberger, l’auteur d’une monumentale histoire de la psychiatrie, rééditée en 1994 chez Fayard, sous le titre Histoire de la découverte de l’inconscient. C’est lui qui a trouvé, à la fin des années 1960, les documents prouvant que la célèbre Anna O., considérée comme le cas princeps de la psychanalyse, soi-disant guérie de tous ses symptômes, s’était en réalité dégradée tout au long de la thérapie, jusqu’à devoir être placée dans un institut psychiatrique.
L’histoire du mensonge concernant le cas fondateur de la psychanalyse a été présentée en détail chez Aubier par Borch-Jacobsen, sous le titre : Souvenirs d’Anna O. Une mystification centenaire [2].
Sur les fraudes freudiennes, le lecteur anglais a l’embarras du choix. Particulièrement éclairante est une anthologie de 20 textes rassemblés par Frederick Crews (université Berkeley), Unauthorized Freud. Doubters Confront a Legend [4].
En français, le travail le mieux documenté est, à ce jour, celui de Jacques Bénesteau (univ. de Toulouse-Rangueil), Mensonges freudiens. Je me permets d’insister sur cet ouvrage tout à fait remarquable, bien entendu passé sous silence dans la grande presse française et belge francophone. A ma connaissance, seules quelques revues comme La Recherche et Science et pseudo-sciences l’ont présenté à leurs lecteurs.
Le conditionnement des psychanalysés
Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le manque d’honnêteté de bon nombre de psychanalystes, sur leur manque d’efficacité et de scientificité.
Je me contente ici d’évoquer la question de la suggestion, puisque c’est le point sur lequel beaucoup d’analystes ont insisté ces jours-ci pour distinguer leur pratique de celle des « psychothérapeutes » et en particulier des comportementalistes, accusés d’être des « conditionneurs » ou des « dresseurs ».
Freud a été interpellé, tout au long de sa carrière, sur la question de la suggestion. Dans ses premières publications (en 1895), il explique avoir découvert que toutes ses patientes, sans aucune exception, sont névrosées parce qu’elles ont refoulé le souvenir de sévices sexuels subis durant l’enfance. Freud prétend qu’il a suffi que les patientes se remémorent pour être guéries. C’est bien sûr un mensonge, comme en témoignent des lettres à son ami Wilhelm Fliess. Ses collègues ne le prennent pas au sérieux. Avec raison. Sans doute reconnaissent-ils l’importance de la sexualité et de sévices dans certains cas, mais la généralisation de Freud leur semble être le résultat de manœuvres de suggestion. Par la suite (à partir de septembre 1897), Freud dira que ces récits correspondent à des fantasmes. Mais là encore, on peut avancer sans beaucoup de risques de se tromper, que Freud a fait, dans la plupart des cas, de la suggestion (voir p. ex. [26], p. 183-187).
Freud a fini par reconnaître que la psychanalyse opère par la suggestion. Simplement, il en parle dans le cadre de sa théorie du « transfert ». Voyons quelques textes de près. Freud écrit :
« Le patient, qui n’est censé chercher rien d’autre qu’une issue à ses conflits générateurs de souffrance, développe un intérêt particulier pour la personne du médecin. Tout ce qui se rapporte à cette personne lui paraît être plus important que ses propres affaires et le distrait de son être-malade. » (1917, XI, p. 456s, trad. 1999, p. 558)
« Pour autant que le transfert est précédé du signe positif, il revêt le médecin d’autorité, il transforme en croyances ses communications et ses interprétations. » (id., p. 463, tr., p. 565)
« Dans notre technique, nous avons abandonné l’hypnose que pour redécouvrir la suggestion sous les espèces du transfert. » (id., p. 464, tr. p. 566)
« Nous accordons que notre influence repose pour l’essentiel sur le transfert, donc sur la suggestion. » (id., p. 466, tr. p. 569)
« Dans chaque traitement analytique, s’instaure, sans aucune intervention du médecin, une relation affective intense du patient à la personne de l’analyste, relation qui ne peut s’expliquer par aucune des circonstances réelles. [...] Cette relation, qu’on appelle, pour faire bref, transfert, prend bientôt la place chez le patient du désir de guérir et devient, tant qu’elle est tendre et modérée, le support de l’influence médicale et le ressort véritable du travail analytique commun. » (1925, G.W., XIV, p. 67, tr. 1984, p. 70s)
« Il est tout à fait vrai que la psychanalyse travaille aussi par le moyen de la suggestion, comme d’autres méthodes psychothérapeutiques. » [Es ist ganz richtig, dass auch die Psychoanalyse mit dem Mittel der Suggestion arbeitet wie andere psychotherapeutische Methoden] (id., p. 68, tr., p. 71).
Lacan lui-même, dans son dernier séminaire, avouait : « Le psychanalyste est un rhéteur. Pour continuer d’équivoquer, je dirai qu’il rhétifie, ce qui implique qu’il rectifie. Rectus, le mot latin, équivoque avec la rhétification. [...] Ce que j’ai appelé le rhéteur qu’il y a dans l’analyste n’opère que par suggestion. Il suggère, c’est le propre du rhéteur, il n’impose d’aucune façon quelque chose qui aurait consistance. C’est même pour cela que j’ai désigné de l’ex- ce qui se supporte, ce qui ne se supporte que d’ex-sister. Comment faut-il que l’analyste opère pour être un convenable rhéteur ? C’est là que nous arrivons à une ambiguïté. L’inconscient, dit-on, ne connaît pas la contradiction. C’est bien en quoi il faut que l’analyste opère par quelque chose qui ne se fonde pas sur la contradiction. Il n’est pas dit que ce dont il s’agit soit vrai ou faux. Ce qui fait le vrai et ce qui fait le faux, c’est ce qu’on appelle le pouvoir de l’analyste, et c’est en cela que je dis qu’il est rhéteur. » (1979, p. 6s)
Une source fréquente d’abus de pouvoir dans le domaine de la psychothérapie est la relation de fascination et de sujétion qui s’y développe facilement. Le phénomène avait déjà été bien décrit au début du XIXe siècle, sous le nom de « rapport magnétique », par les « magnétiseurs », disciples de Mesmer et précurseurs de l’hypnose. Ces ancêtres de la psychothérapie avaient constaté, chez de nombreux patients, la disposition à croire que le thérapeute dispose de pouvoirs surnaturels, le désir croissant de contacts avec le thérapeute, le développement d’une véritable passion amoureuse et d’une subordination totale (voir Ellenberger, 1974, p. 67-68, 131-34).
Ce thème a été l’objet de la conférence de Pierre Janet au congrès international de psychologie tenu à Munich en 1896. Janet décrit la passion qui se développe chez la plupart des patients pour leur psychothérapeute. Il dit : « Je ne puis mieux décrire ce besoin qu’en le comparant à une passion dont les symptômes sont bien connus, la morphinomanie » ([15], p. 118). Parlant des femmes « hystériques », il écrit : « Celui qui s’occupe d’elles n’est plus à leurs yeux un homme ordinaire ; il prend une situation prépondérante auprès de laquelle rien ne peut entrer en balance. Pour lui, elles sont résolues à tout faire, car elles semblent avoir pris une fois pour toutes la résolution de lui obéir aveuglément » (id., p. 125s). Janet terminait son exposé en disant que le médecin doit utiliser le « besoin de direction » pour « éduquer l’esprit » du patient, mais qu’il doit, dans un second temps, lui apprendre à se passer du médecin, plutôt que de « laisser se développer une dangereuse passion somnambulique ».
Pour avoir pratiqué successivement la psychanalyse et les TCC, je peux dire que la relation de dépendance est beaucoup plus forte en psychanalyse que dans les TCC. C’est ce qui explique notamment que les patients en analyse abandonnent vite les raisons pour lesquelles ils ont entamé la cure (des troubles qui font souffrir et que la psychanalyse, bien souvent, n’est pas en mesure de faire disparaître) au profit des objectifs de l’analyste (analyser des rêves, se souvenir d’expériences sexuelles de l’enfance, etc.). Le sociologue Nathan Stern donne de nombreux exemples de ce glissement, dans La fiction psychanalytique, un ouvrage très instructif sur les « trucs » des freudiens pour subjuguer leurs patients.
Terminons par un exemple. Pas n’importe lequel : Pierre Rey. Pendant dix ans, le rédacteur en chef de Marie-Claire est venu chaque jour de la semaine en analyse chez Lacan. A ma connaissance, il est le seul qui ait écrit un livre sur son expérience de client de Lacan.
Rey a entamé sa cure pour se délivrer de phobies sociales. De cette souffrance, il est bien peu question dans son analyse. Les psychanalystes dédaignent les « symptômes ». Rey nous donne de jolies illustrations de sa dépendance à l’analyste. Voici deux échantillons :
« Lacan savait que je me levais tard. - À demain, six heures. - D’accord. - Six heures du matin. - Écoutez... Il me serrait la main. Le lendemain, je sortais de chez moi sans avoir fermé l’œil. Il répétait l’expérimentation jusqu’à ce qu’il fût sûr que j’aie pris le pli de son exigence. Il en aurait fallu davantage pour me faire renoncer : j’étais ferré. M’eût-il demandé de le rejoindre aux antipodes pour une entrevue de vingt secondes à dix millions, j’aurais trouvé l’argent et j’y serais allé. Quand ils ont cette force, les liens du transfert sont insécables. Je ne me posais pas le problème en ces termes, je n’avais pas le choix : question de vie ou de mort » ([20], p. 67s).
Au cours d’une soirée chez des amis, Rey entend deux jeunes hommes dire que Lacan est un dangereux charlatan. Il réagit : « Pendant cinq minutes, j’eus la force de ne pas intervenir. Ensuite, je sentis un voile blanc m’obscurcir le regard tandis qu’une fantastique poussée d’adrénaline me fit me dresser, blême soudain, muscles tendus, visage de pierre. Je pointai tour à tour sur eux un index meurtrier et m’entendis dire d’une voix blanche : Écoutez-moi, connards... Écoutez-moi bien... Bougez simplement un cil, ajoutez simplement un mot et je vous tue. Paralysés, blancs comme la craie, je crois qu’ils ne respiraient même plus. Par crainte de tenir ma promesse, je tournai les talons. Ils en profitèrent pour quitter les lieux sur la pointe des pieds » (id., p. 146s).
Cette idolâtrie de l’analyste a-t-elle aidé Rey à se délivrer de ses « symptômes » ? Au terme de dix années de « travail » analytique, très cher payées, il écrit : « L’avouer aujourd’hui me fait sourire : je suis toujours aussi phobique. Mais, entre-temps, j’ai négocié avec mes phobies. Ou je ne me mets plus en position d’avoir à les éprouver, ou, le dussé-je, les considérant comme l’accident d’un temps vide, je les subis avec la résignation ennuyée qu’appellent les fatalités extérieures. » ([20], p. 77. C’est Rey qui souligne)
Au cours des 25 dernières années, pendant lesquelles j’ai pu voir des patients traités par psychanalyse et des patients traités par TCC, j’ai souvent rencontré des patients en analyse tout aussi dépendants de leur analyste que Pierre Rey l’était de Lacan, son gourou, son « lacangourou ». Je n’ai que très rarement rencontré des patients de comportementalistes manifestant pareille dépendance infantile.
S’il se pratique « quelque part » un conditionnement des esprits, ce n’est pas chez les comportementalistes qu’il faut le chercher, mais bien chez Freud d’abord, chez ses zélés disciples ensuite, des disciples dont beaucoup sont davantage intéressés par le pouvoir et l’argent que par les effets observables de leurs très longues et coûteuses analyses.
1 | Bénesteau, J. (2002) Mensonges freudiens. Histoire d’une désinformation séculaire. Belgique, Mardaga (diffusé en France par SOFEDIS), 400 p. Voir aussi le très intéressant, qui fournit des textes en allemand, en français et en anglais.
2 | Borch-Jacobsen, M. (1995) Souvenirs d’Anna O. Une mystification centenaire. Paris : Aubier, 120 p.
3 | Bouveresse, J. (1999) Prodiges et vertiges de l’analogie. De l’abus des belles-lettres dans la pensée. Paris : Raisons d’agir, 158 p.
4 | Crews, F. (1998) Unauthorized Freud. Doubters Confront a Legend. New York & London : Viking, 302 p.
5 | Ellenberger, H. (1970) The Discovery of the Unconscious. N.Y. Basic Books. 932 p. Trad. : A la découverte de l’lnconscient. Histoire de la psychiatrie dynamique. Villeurbanne : Ed. Simep, 1974, 760 p. Rééd. : Histoire de la découverte de l’inconscient. Paris : Fayard, 1994.
6 | Ellis, A. (1998) How to control your anxiety before it controls you. Trad. : Dominez votre anxiété avant qu’elle ne vous domine. Trad., Montréal, Éd. de l’Homme, 1999, 270 p.
7 | Foulquié, P. (1962) Dictionnaire philosophique. Paris : PUF.
8 | Freud, S. (1905) Ueber Psychotherapie. Gesammelte Werke. Frankfurt am Main : Fischer, vol. V, p. 13-26.
9 | Freud, S. (1917) Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse. G.W., vol. XI. Trad. : Conférences d’introduction à la psychanalyse. Gallimard, 1999.
10 | Freud, S. (1925) Selbstdarstellung. G.W., vol. XIV, p. 33-96.
11 | Freud, S. (1933) Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, Gesammelte Werke, vol. XV. Trad. : Nouvelles conférences d’introduction à la psychanalyse, Trad. Gallimard, 1984.
12 | Freud, S. (1938) Some elementary lessons in Psycho-analysis. G.W., vol. XVII, p. 141-7.
13 | Grünbaum, A. (1984) The foundations of psychoanalysis. Trad. : Les fondements de la psychanalyse. Une critique philosophique. Paris : P.U.F., 1996, 464 p.
14 | Inserm (dir.).Psychothérapie : Trois approches évaluées. Rapport. Paris : Les éditions Inserm, 2004, XII- 553 p.
15 | Janet, P. (1897) L’influence somnambulique et le besoin de direction. Revue philosophique, XLIII, p. 113-43.
16 | Kardiner, A. (1977) My Analysis With Freud. N.Y. : Norton. Trad. : Mon Analyse avec Freud. Paris : Belfond, 1978.
17 | Lacan, J. (1973) Télévision. Paris : Seuil, 74 p.
18 | Lacan, J. (1977) Ouverture de la section clinique, Ornicar ?, 9, p. 7-14.
19 | Lacan, J. (1979) Une pratique de bavardage. Le séminaire. Ornicar ?, 19, p. 5-9. (Texte établi par J.-A. Miller).
20 | Rey, P. (1989) Une saison chez Lacan. Paris : Laffont.
21 | Roudinesco, E. (1999) Pourquoi la psychanalyse ? Paris : Fayard, 198 p.
22 | Sokal, A. & Bricmont, J. (1997) Impostures intellectuelles. Paris : Odile Jacob, 276 p. Rééd. Le Livre de poche, n° 4276, 1999.
23 | Stern, N. (1999) La fiction psychanalytique. Étude psychosociologique des conditions objectives de la cure. Mardaga, 201 p.
24 | Turkle, S. (1978) Psychoanalytic politics. Freud’s French Revolution. Trad., La France freudienne. Paris : Grasset, 1982, 306 p.
25 | Van Rillaer, J. (1981) Les illusions de la psychanalyse. Liège : éd. Mardaga (diffusé en France par SOFEDIS), 4e éd. : 1996, 420 p.
26 | Van Rillaer, J. (2003) Psychologie de la vie quotidienne. Paris : Odile Jacob, 2003, 336 p.
27 | Van Rillaer, J. (2004a) Une légende moderne : « Les comportementalistes ne traitent que des symptômes « , Journal de Thérapie comportementale et cognitive. Paris : Masson, 14 (1), p. 3-7.
28 | Van Rillaer, J. (2004b) Traiter le Moi profond ou les symptômes ? In : Le Moi. Du normal au pathologique. Auxerre : Ed. Sciences Humaines (diffusion P.U.F.), p. 337-344.
29 | Widlöcher, D. (1996) Les nouvelles cartes de la psychanalyse. Paris : Odile Jacob, 276 p.
Partager cet article
L' auteur

Jacques Van Rillaer
Professeur émérite de psychologie à l’université de Louvain (Louvain-la-Neuve) et à l’université Saint-Louis (…)
Plus d'informationsPsychanalyse

Psychanalyse : le déclin d’une illusion
Le 2 décembre 2010
Carl Gustav Jung : psychiatre, psychanalyste et gourou
Le 8 janvier 2024
Y a-t-il du nouveau et du bon dans la psychanalyse ?
Le 15 octobre 2022
La vénération du psychothérapeute : explications et conséquences
Le 7 décembre 2017