Dossier • Science et média : une relation sous influence
La science dans l’écosystème médiatique
Publié en ligne le 4 mai 2018 - Science et médias -L’expression « écosystème médiatique » est empruntée à Olivier Bossel.
La science sur le marché médiatique
La recherche scientifique est un processus cumulatif, lent et réflexif. Une première observation explorant une nouvelle question donne lieu à une publication initiale dans une revue scientifique. Pour être considérée comme scientifiquement valide, cette observation doit pouvoir être répliquée ou s’inscrire logiquement dans un faisceau d’observations déjà validées. La connaissance évolue donc d’une observation initiale stimulante, mais incertaine, vers un consensus dont la robustesse augmente avec le nombre d’observations. Ce processus de production s’exerce à travers un réseau d’institutions : laboratoires, centres de recherche, universités, ministères. Les acteurs humains de ce processus – chercheurs, techniciens, administratifs et décideurs politiques – ont aussi leurs intérêts propres. La recherche peut donc être aussi considérée comme un marché où la publication scientifique représente l’unité de valeur principale qui s’échange contre des financements, de la notoriété et du pouvoir institutionnel. Ce marché fonctionne en partie en interne : les publications scientifiques sont rédigées, commentées et évaluées par des chercheurs et leurs institutions. Celles-ci récompensent les chercheurs qui publient par un financement qui peut inclure tout ou partie de leur salaire.

Cependant, ce marché ne s’est jamais limité au monde académique. Les chercheurs et leurs institutions ont toujours eu à convaincre les décideurs politiques pour obtenir les financements nécessaires. Dans les nations démocratiques, les décideurs politiques cherchent à satisfaire les attentes des électeurs et s’appuient sur les médias pour les percevoir puis, éventuellement, les influencer. Ce rôle croissant des médias a été résumé par le concept de médialisation (en anglais : medialization) [1]. Il décrit un processus évolutif où le contenu de l’information produite par les médias est régi par les normes médiatiques (instantanéité, spectacularité, primat de l’émotionnel sur le rationnel) et où les acteurs externes aux médias sont poussés à infléchir leurs activités en fonction de ces normes [1].
Plusieurs travaux dans le domaine de la communication des sciences ont montré la pertinence de ce concept pour décrire l’évolution des interactions entre sciences et médias [2]. La relative méfiance des chercheurs vis-à-vis des journalistes a progressivement disparu. De leur propre chef ou incités par leurs institutions, les scientifiques recherchent de plus en plus le contact avec les médias car, dans leur grande majorité, ils constatent que c’est bon pour leur carrière [3,4]. De leur côté, les institutions scientifiques ont multiplié et étoffé leurs services de presse et inondent les journalistes de communiqués. Du côté des médias, les études montrent une augmentation de la couverture des études scientifiques. De plus, cette couverture se complexifie avec l’usage croissant des médias en ligne. Enfin, une enquête auprès de 39 décideurs politiques allemands montrent que ceux-ci s’appuient sur de nombreux collaborateurs analysant les médias de masse afin d’orienter leurs actions [5]. Cette veille vise à savoir ce qui préoccupe le public et à évaluer comment l’action politique est perçue, y compris lorsqu’elle implique des faits scientifiques. De plus, les décideurs politiques puisent dans les médias les arguments rhétoriques les mieux à même de convaincre les citoyens de la pertinence de leurs actions. Enfin, ils utilisent en retour les médias pour influencer l’opinion publique [5].
L’examen détaillé de la couverture médiatique des sciences met en évidence différents biais propres au traitement médiatique lui-même :
- Les sciences expérimentales sont très inégalement couvertes par les médias : la recherche biomédicale est de loin le domaine le plus couvert [6]. Ceci correspond aux attentes du public puisque que, selon les enquêtes Eurobarometer, les Européens sont beaucoup plus intéressés par les questions de santé et d’environnement que par les autres questions scientifiques.
- La couverture médiatique des recherches biomédicales est très hétérogène : les études associant une pathologie à un facteur de risque lié au style de vie (par ex. tabagisme et cancer) sont quatre fois plus couvertes que les études décrivant une association avec un facteur de risques sur lequel le sujet ne peut agir (par ex. risque génétique).
- Les médias privilégient les études publiées dans des revues prestigieuses. Ils favorisent donc les études initiales par rapport aux études ultérieures, même quand ces dernières invalident une étude initiale médiatisée (voir l’article d’Estelle Dumas-Mallet dans ce numéro de SPS).
À travers ces biais, on voit bien que les médias ne se donnent pas pour but premier d’informer et d’éduquer le public quant à l’avancement global de la recherche scientifique. Les enquêtes auprès des journalistes montrent que ces choix leurs sont dictés par le souci de répondre aux attentes des lecteurs.
« ...les chercheurs sont donc poussés à embellir leurs résultats et à en exagérer la portée... »
« ...les chercheurs sont donc poussés à embellir leurs résultats et à en exagérer la portée... »
D’autres observations évoquent des biais suggérant que les institutions scientifiques et les chercheurs adaptent leurs actions afin d’accroître leur visibilité médiatique.
- Les médias d’un pays donné couvrent plus volontiers les travaux réalisés par des laboratoires du même pays que ceux des laboratoires étrangers [3].
- Les revues scientifiques prestigieuses privilégient les études rapportant des résultats positifs, spectaculaires et nouveaux. Pour accéder à ces revues, les chercheurs sont donc poussés à embellir leurs résultats et à en exagérer la portée, dans les publications scientifiques ou les communiqués de presse rédigés par les institutions. Lorsqu’elles sont présentes dans les communiqués de presse, ces distorsions et exagérations se retrouvent telles quelles dans les articles de journaux [7,8].
- Les études de réplication sont, en moyenne, publiées dans des revues moins prestigieuses que les études initiales correspondantes [9] et sont donc rarement reprises par les médias [10], alors qu’elles sont essentielles à la stabilisation des connaissances.
En résumé, la recherche scientifique se construit sur le long terme alors que les médias privilégient le nouveau et le spectaculaire, mais ce sont les chercheurs et leurs institutions qui s’adaptent à cet impératif médiatique. Ces pratiques montrent qu’il s’agit moins d’informer le public sur la science en tant que telle que d’en faire la promotion. Elles suggèrent aussi que les scientifiques et leurs institutions jouent un rôle actif dans cette activité promotionnelle [3,11].
Les conséquences de la médialisation
Les conséquences sociétales d’une information scientifique de mauvaise qualité
Pour reprendre l’exemple proposé par Estelle Dumas-Mallet, l’affirmation très médiatisée, mais invalidée par les études ultérieures, selon laquelle les patients souffrant du trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité présentent un niveau anormalement élevé du transporteur de la dopamine a eu des conséquences. Cet argument a été mis en avant dans les médias pour justifier le bien-fondé de la prescription de Ritaline alors même que les effets bénéfiques à long terme de cette médication sont incertains [12]. Dans le domaine des neurosciences et de la psychiatrie, mes collègues et moi-même avons décrit en détail les différentes formes de distorsion des observations scientifiques quand elles sont rapportées par les médias et leurs conséquences sociétales [13,14]. Chacun pourra sans peine imaginer dans son champ d’intérêt particulier les fâcheuses conséquences d’une information médiatique souvent très éloignée de la réalité des observations scientifiques.
La crise de la reproductibilité
Robert Merton a défini les normes de la recherche scientifique [15]. En plus de l’exigence de reproductibilité, il note que la connaissance scientifique avance grâce à la coopération désintéressée entre tous les chercheurs. Entre cette norme idéale et la pratique, il y a toujours eu un écart : les chercheurs et leurs laboratoires sont en compétition puisque celui qui fait une découverte est plus récompensé que celui qui la confirme. Tant que cette compétition s’exprime à l’intérieur du milieu académique, ses effets néfastes sont contrebalancés par les institutions scientifiques : certaines découvertes majeures de ces dernières décennies n’ont pas été publiées dans des revues prestigieuses. Le problème avec la médialisation de la recherche, c’est qu’elle exacerbe la compétition et la déplace sur le terrain médiatique. Il devient alors beaucoup plus difficile de concilier les pratiques de la recherche avec les normes de Merton [11].

Depuis le début des années 2000, de plus en plus d’articles et d’éditoriaux parus dans des revues scientifiques s’inquiètent du manque de reproductibilité de la recherche expérimentale. Quelques journaux grand public commencent à se faire l’écho de cette « crise de la reproductibilité » (voir Le Monde Science et Médecine du 27 septembre et du 4 octobre 2017). Tous pointent les effets pervers de l’impératif de publication dans des revues prestigieuses. De fait, entre deux études d’intérêt et de qualité méthodologique équivalentes, celle qui est publiée dans une revue prestigieuse rapporte beaucoup plus aux chercheurs et à leurs laboratoires en termes de notoriété et de financement. Comme le titre Le Monde du 4 octobre 2017, soumis à cet impératif, les scientifiques « sont poussés à la faute ». De ce point de vue, les deux articles du Monde proposent une bonne description de tous les mécanismes qui contribuent à diminuer la fiabilité des publications. À juste titre, ils soulignent que la fraude caractérisée est beaucoup plus rare que tous les petits arrangements utilisés pour publier à tout prix un résultat positif. Par contre, ces deux articles oublient l’une des forces incitatives qui poussent à la faute : le financement de la recherche sur projet [16].
Ce que ne mentionnent pas non plus ces articles du Monde, c’est que les revues scientifiques prestigieuses sélectionnent d’abord les articles qu’elles publient sur des critères de nouveauté et qu’elles représentent, et de loin, les principales sources d’information reprises par les médias [10]. Autrement dit, pour les chercheurs, l’impératif « publier ou périr » devient « publier un résultat susceptible d’attirer l’attention des médias », quitte à embellir leurs résultats et en exagérer l’intérêt. Les médias deviennent donc les arbitres et évaluateurs du marché de la publication scientifique. Comme le montrent Petersen et ses collègues [5], les décideurs politiques des démocraties modernes orientent leurs décisions pour répondre aux attentes des citoyens telles qu’elles sont exprimées par les médias. En particulier, la décision de financer tel domaine ou programme de recherche plutôt que tel autre est très probablement influencée par le battage médiatique fait autour de ces questions. De fait, des études américaines ont montré que le financement de la recherche biomédicale est bien loin d’être réparti en proportion du coût socio-économique de chaque pathologie et que le lobbying est, financièrement parlant, très efficace [17,18].
Et si la « crise de la reproductibilité » devenait un objet majeur d’intérêt médiatique ?
Pour l’instant, la « crise de la reproductibilité » n’a attiré l’attention que de quelques grands quotidiens (Le Monde, The New York Times, The Washington Post, The Economist, The Guardian). Que se passerait-il si les journaux plus populaires et la télévision s’en emparaient ? On imagine les titres : « Scientifiques tous pourris », « Les chercheurs tous menteurs ». Barry Bozeman est un politologue spécialiste de la bureaucratisation des institutions. Il s’est récemment intéressé à la recherche académique et a montré que les premiers cas de fraude scientifique fortement médiatisés aux États-Unis pendant les années 1980 ont déclenché un vague de mesures bureaucratiques visant à contrôler plus étroitement l’activité des scientifiques et de leurs institutions [19]. Avec la « crise de la reproductibilité », les scientifiques semblent prendre les devants et promettent de prendre des mesures draconiennes pour améliorer la fiabilité des publications avant même que la « crise » ne s’étale dans les tabloïds et sur les écrans.
Mais la « crise » est-elle bien réelle ? La reproductibilité des études est-elle vraiment plus mauvaise qu’il y a trente ans ? À notre connaissance, nous sommes encore les seuls à avoir apporté un modeste élément de réponse à cette question : non, les études initiales d’association publiées dans les années 1980 n’étaient pas confirmées plus souvent par les méta-analyses que les études initiales publiées dans les deux décennies suivantes [20]. Comme déjà dit, les publications initiales sont par nature incertaines et il est illusoire de vouloir faire disparaître cette incertitude. Par contre, nombre de mesures préconisées pour améliorer la fiabilité des études sont de nature bureaucratique et vont entraver l’activité des chercheurs. Par exemple, l’obligation de publier à l’avance un protocole expérimental définissant les variables à observer va empêcher ou retarder la publication de résultats inattendus, qui sont pourtant souvent les plus intéressants. De même, l’incitation à utiliser des critères de significativité statistique plus contraignants (p<0,005 plutôt que p<0,05) se justifie dans certains domaines, mais risque d’entraver la publication d’observations cliniques sur un petit nombre de patients alors que ce sont celles-ci qui déclenchent l’alerte, comme le montre le cas du Médiator.

Alors que faire ?
La médialisation croissante de la vie publique étant un processus qui touche tous les aspects de la vie politique dans les démocraties modernes, il est illusoire de croire que la science pourrait y échapper. Pourtant, cette médialisation sape progressivement les normes qui permettent aux chercheurs de faire avancer la connaissance. Il ne s’agit pas ici d’une défense passéiste de valeurs corporatistes, mais d’alerter les citoyens sur les conditions mêmes de la recherche. Oui, la recherche en train de se faire est une activité aussi risquée qu’incertaine. Vouloir encadrer réglementairement cette incertitude ne conduira qu’à stériliser la recherche.
La médialisation entrave aussi la liberté des chercheurs en favorisant le financement des projets de recherche les plus susceptibles d’attirer l’attention des médias [21]. Comme le soulignent des grands noms de la recherche américaine, ce mode de financement a des effets pervers dont le plus évident est que les chercheurs en pleine force créatrice passent plus de temps à écrire des projets et à juger ceux de leurs collègues qu’à faire de la recherche [16,22]. Puisque le financement de la recherche académique est principalement assuré par l’impôt et que l’avancement des sciences implique la coopération désintéressée entre les chercheurs, la seule issue logique aux effets pervers de la médialisation des sciences est de faire accepter cette exigence de désintéressement par la société et, donc, de renoncer au financement sur projet.
Bien entendu, comme toute activité dépendant de l’argent public, la recherche académique doit être évaluée, mais elle devrait l’être a posteriori. Philippe Lazar, directeur de l’Inserm de 1982 à 1996, avait mis en place une telle procédure d’évaluation rigoureuse qui avait l’avantage de limiter efficacement le principal risque du financement a posteriori, le mandarinat. John Ioannidis est le chercheur américain qui a le plus œuvré, depuis 2001, pour alerter la communauté scientifique sur la médiocre fiabilité des publications scientifiques. Lui aussi en arrive à la même conclusion dans un éditorial paru en 2011 dans la revue Nature et intitulé : « Financez les chercheurs, pas les projets » [22].
1 | Strömbäck J, “Four Phases of Mediatization : An Analysis of the Mediatization of Politics”, The International Journal of Press/Politics, 2008, 13:228-46.
2 | Peters HP, Heinrichs H, Jung A, Kallfass M, Petersen I, “Medialization of science as a prerequisite of its legitimization and political relevance”, in : Cheng D, Claessens M, Gascoigne NRJ, Metcalfe J, Schiele B, Shi S (editors), Communicating science in social context, Springer, 2008, 71-92.
3 | Peters HP, “Scientific sources and the mass media : forms and consequences of medialization”, in : Rödder S, Franzen M, Weingart P (editors), The sciences’media connection – Public communication and its repercussions, Springer Science, 2012, 217-39.
4 | Peters HP, Brossard D, de Cheveigne S, Dunwoody S, Kallfass M, Miller S et al., “Science communication. Interactions with the mass media”, Science, 2008, 321:204-5.
5 | Petersen I, Heinrichs H, Peters HP, “Mass-Mediated Expertise as Informal Policy Advice”, Science, Technology & Human Values, 2010, 35:865-87.
6 | Suleski J, Ibaraki M, “Scientists are talking, but mostly to each other : a quantitative analysis of research represented in mass media”, Public Understanding of Science, 2009, 19:115-25.
7 | Schwartz LM, Woloshin S, Andrews A, Stukel TA, “Influence of medical journal press releases on the quality of associated newspaper coverage : retrospective cohort study”, BMJ, 2012, 344:d8164.
8 | Yavchitz A, Boutron I, Bafeta A, Marroun I, Charles P, Mantz J et al., “Misrepresentation of randomized controlled trials in press releases and news coverage : a cohort study”, PLoS Med, 2012, 9:e1001308.
9 | Gonon F, Konsman JP, Cohen D, Boraud T, “Why most biomedical findings echoed by newspapers turn out to be false : the case of Attention Deficit Hyperactivity Disorder”, PLoS One, 2012, 7:e44275.
10 | Dumas-Mallet E, Smith A, Boraud T, Gonon F, “Poor Replication Validity of Biomedical Association Studies Reported by Newspapers”, PLoS One, 2017, 12:e0172650.
11 | Bucchi M, “Norms, competition and visibility in contemporary science : the legacy of Robert K. Merton”, Journal of classical Sociology, 2015, 15:233-52.
12 | Bourdaa M, Konsman JP, Secail C, Venturini T, Veyrat-Masson I, Gonon F, “Does television reflect the evolution of scientific knowledge ? The case of attention deficit hyperactivity disorder coverage on French TV”, Public Understanding of Science, 2015, 24:200-9.
13 | Gonon F, « La psychiatrie biologique : une bulle spéculative ? », Esprit, 2011, 11 (novembre), 54-73.
14 | Gonon F, Konsman JP, Boraud T, « Neurosciences et médiatisation : entre argumentation de la preuve et rhétorique de la promesse », in : Chamak B, Moutaud B (editors), Neurosciences et société : Enjeux des savoirs et pratiques sur le cerveau. Armand Colin, 2014, 109-33.
15 | Merton RK, The normative structure of Science. The sociology of science : theoretical and empirical investigations, University of Chicago Press, 1973, 267-78.
16 | Edwards MA, Roy S, “Academic Research in the 21st Century : Maintaining Scientific Integrity in a Climate of Perverse Incentives and Hypercompetition”, Environmental engineering science, 2017, 34:51-61.
17 | Best RK, “Disease Politics and Medical Research Funding”, American Sociological Review, 2012, 77:780-803.
18 | Reardon S, “Lobbying sways NIH grants”, Nature, 2014, 515:19.
19 | Bozeman B, Jung J, “Bureaucratization in Academic Research Policy : What Causes It ?”, Annals of Science and Technology Policy, 2017, 1:133-214.
20 | Dumas-Mallet E, Button K, Boraud T, Munafo M, Gonon F, “Replication Validity of Initial Association Studies : A Comparison between Psychiatry, Neurology and Four Somatic Diseases”, PLoS One, 2016, 11:e0158064.
21 | Scheu AM, Volpers AM, Summ A, Blöbaum B, “Medialization of research policy : anticipation of an adaptation to journalistic logic”, Science Communication, 2014, 36:706-734.
22 | Ioannidis JP, “More time for research : fund people not projects”, Nature, 2011, 477:529-31.
Thème : Science et médias
Mots-clés : Science
Publié dans le n° 323 de la revue
Partager cet article
L' auteur

François Gonon
Directeur de recherche émérite au CNRS (UMR 5293, université de Bordeaux).
Plus d'informationsScience et médias
Le traitement de l’information scientifique dans les médias.
Les médias et la science
Le 4 juillet 2020
Les revues prédatrices : un concept dépassé ?
Le 9 janvier 2023
Les Lumières à l’ère du numérique : entretien avec Laurent Cordonier
Le 2 septembre 2022
Influence de la Lune : une histoire à dormir debout
Le 22 mars 2022Communiqués de l'AFIS
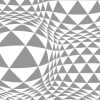
Glyphosate, médias et politique : la science inaudible et déformée
Le 20 octobre 2023

























