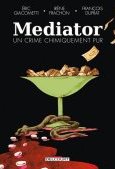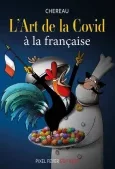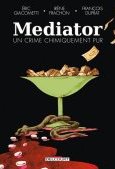Classifications internationales des troubles mentaux
Vraies limites et faux problèmes
Publié en ligne le 23 juillet 2013 - Médecine -
Parmi les nombreux stratagèmes qu’utilisent les psychanalystes pour tenter d’échapper aux évaluations de leurs pratiques, un argument qui revient souvent est la contestation des catégories diagnostiques définies dans les classifications internationales.
Selon eux, comme ils ne reconnaissent pas la validité de ces catégories, ils ne peuvent passe couler dans le moule de la recherche internationale sur les troubles mentaux, ni en termes de recherche fondamentale, ni en termes de recherche clinique, et par conséquent on ne peut les évaluer selon les mêmes critères, CQFD. Cet article examine certains des reproches les plus couramment faits aux classifications des maladies, et en particulier au DSM-IV.
Le DSM définit-il arbitrairement ce qui est pathologique ?

En sciences, la normalité n’a aucune connotation prescriptive ou morale, c’est un concept purement statistique : c’est ce qui est observé chez la majorité des individus de la population. Par conséquent l’anormalité est ce qui est observé chez une minorité d’individus. Si l’on illustre ce point sur la distribution des scores de quotient intellectuel (QI) au sein de la population (dont la moyenne est 100 et l’écart-type est 15 par construction), il est « normal » d’avoir un QI dans le milieu de la distribution (autour de 100), et il est « anormal » d’avoir un QI très faible ou très élevé.
La pathologie est un concept distinct, elle est définie (notamment dans le DSM-IV) comme étant ce qui dévie significativement de la norme et qui engendre de la souffrance chez le patient ou son entourage. C’est pour cela que, bien qu’il soit « anormal » d’avoir un QI très élevé, cela n’est pas considéré comme une pathologie (à la différence d’un QI très faible).
Il n’existe pas toujours dans la nature une frontière claire entre la bonne santé et la maladie. Par conséquent, les seuils que l’on fixe entre le normal et le pathologique ont inévitablement une part d’arbitraire. Bien souvent on fixe par convention le seuil à 2 écarts-types au-delà de la moyenne de la population. Cela correspond au score de 70 pour le quotient intellectuel, en-deçà duquel on définit la « déficience intellectuelle ». Bien évidemment, les personnes qui ont un QI de 69 ne sont pas qualitativement différentes de celles qui ont un QI de 71. Tout le monde s’accorde à dire que les personnes avec un QI de 85 fonctionnent normalement et que celles avec un QI de 50 ont de graves problèmes. Mais le seuil à 70 n’a rien de magique. Simplement, en pratique, il parvient relativement bien à identifier les personnes qui ont des difficultés importantes et qui nécessitent une prise en charge particulière, avec néanmoins tous les problèmes inhérents aux effets de seuil. Il en est exactement de même pour de nombreuses maladies somatiques, par exemple le diabète, avec le problème de fixer le taux de glycémie à partir duquel une prise en charge médicale se justifie.
Ce qui est évident concernant les scores de QI, qui sont par nature unidimensionnels et quantitatifs, est également vrai pour de nombreuses maladies. Par exemple, l’autisme est défini sur trois dimensions (cf. article de Baudouin Forgeot d’Arc) et la sévérité du trouble varie continûment et indépendamment sur chacune des trois dimensions, de telle sorte qu’il n’y a pas de seuil naturel séparant les véritables troubles autistiques de simples traits de personnalité un peu « bizarres ». De même, il existe tout un continuum de la dépression la plus sévère et chronique à de simples variations passagères de l’humeur. Les mêmes considérations s’appliquent à la plupart des maladies somatiques (c’est-à-dire non psychologiques), pensons par exemple à l’hypertension artérielle, les cancers, ou la myopie.
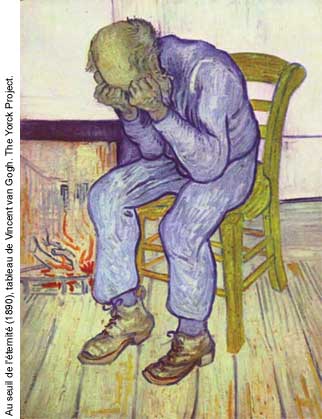
Certains voudraient limiter la définition des maladies à celles pour lesquelles une cause ou un mécanisme pathologique est clairement identifié [1]. Mais cela revient à confondre classifications nosographique (des troubles) et étiologique (des causes).
Classifier les maladies est un préalable, qui définit les entités sur lesquelles on peut faire de la recherche dans le but d’en déterminer les causes. La compréhension des causes peut conduire à remanier la classification nosographique et à la rapprocher d’une classification étiologique (c’est le but ultime), mais on ne peut faire de la classification étiologique un préalable ni un impératif. Ne reconnaître que les maladies dont les causes sont connues conduirait à ne pas identifier et ne pas prendre en charge la plupart des patients !
En somme, il n’y a pas de définition naturelle de la maladie. D’un point de vue purement scientifique, à la limite, on pourrait totalement se passer de seuils. Les seuils existent essentiellement pour des considérations pratiques, ils sont nécessaires pour prendre des décisions : déclencher (ou pas) une prise en charge, choisir un traitement A ou un traitement B, décider de rembourser (ou pas) un acte, etc.
Les catégories diagnostiques du DSM sont-elles arbitraires et manquent-elles de validité ?
Tout le monde est d’accord pour dire que les catégories diagnostiques définies dans les classifications sont imparfaites (et certaines plus que d’autres). C’est pour cela qu’elles ne sont pas figées et qu’on les révise régulièrement en fonction de l’état des connaissances. C’est tout l’enjeu des concertations actuellement en cours en vue du DSM-V et de la CIM-11. Pour une discussion éclairée des enjeux de ces révisions dans le domaine de la psychiatrie, on lira avec intérêt l’article de Michael Rutter (2011), le plus éminent pédopsychiatre britannique [2], et celui de Baudouin Forgeot d’Arc dans ce numéro.
Parmi les reproches couramment adressés à ces catégories diagnostiques on trouve le fait que chaque catégorie recouvre une population hétérogène (c’est flagrant pour l’autisme, notamment en raison des variations induites par le niveau intellectuel), et le fait qu’elles ont des frontières incertaines, avec un recouvrement parfois important (le cas le plus connu étant la comorbidité – ou association – notoire entre dépression et troubles anxieux). Ces faits sont bien connus et peuvent, ou pas, signaler la faible validité de certaines catégories diagnostiques. Le même problème existe dans de nombreuses maladies somatiques, par exemple les jaunisses.
Là encore, il faut comprendre que ces catégories n’existent pas dans la nature. Elles sont imposées par l’homme, qui trouve utile de désigner par un même nom des profils de dysfonctionnements ayant d’importants traits en commun, et ce notamment parce que les personnes présentant des troubles similaires ont souvent des besoins similaires et vont pouvoir bénéficier d’approches thérapeutiques similaires. L’hétérogénéité de chaque catégorie et le recouvrement entre catégories n’est pas en soi un argument déterminant contre la validité des catégories. Ce qui importe, c’est de déterminer, en fonction des données épidémiologiques, physiologiques et cliniques, s’il est plus avantageux d’un point de vue médical d’élargir une catégorie, de regrouper des catégories ou, au contraire, de les subdiviser, plutôt que de conserver les catégories actuelles. Il est également envisagé, pour le DSM-5, de compléter les diagnostics par des données dimensionnelles (des profils quantitatifs), ce qui pourra être très utile, tout en sachant que ces dernières ne pourront pas totalement remplacer les catégories pour certains usages, en particulier pour la prise de décision.
Une autre caractéristique des troubles mentaux définis dans les classifications internationales est que, contrairement à la plupart des maladies somatiques, leurs définitions ne font généralement pas référence à des causes. Ce choix délibéré découle simplement du fait que, pour la plupart des troubles mentaux, les causes ne sont connues que de manière très partielle, et même lorsqu’elles sont connues en moyenne, il est excessivement difficile de les établir pour un patient donné. Et pourtant, les patients ont besoin d’aide (c’est pour cela qu’ils consultent), ils ne peuvent pas attendre quelques décennies que la recherche ait avancé ! Les troubles mentaux sont donc définis sur la base des symptômes plutôt que sur la base des mécanismes pathologiques, ce qui les distingue partiellement des maladies somatiques.
Certains considèrent qu’on ne peut pas définir des maladies sur la base de symptômes, en l’absence de causes connues [1]. On n’est pas obligé de partager cette vision étroite de la notion de maladie. Chaque maladie s’exprime à de multiples niveaux de description (moléculaires, cellulaires, physiologiques et, pour les troubles mentaux : cognitifs, comportementaux et phénoménologiques). Il n’existe pas un unique niveau privilégié auquel toutes les maladies seraient définissables de manière pertinente. Ce qui importe, c’est de définir chaque maladie au niveau qui permet d’apporter la réponse la plus cohérente. Il y a toutes les raisons de penser que les niveaux cognitifs, comportementaux et phénoménologiques sont les niveaux de description les plus pertinents pour la plupart des troubles mentaux.

On peut imaginer que les traitements des troubles mentaux seraient plus efficaces s’ils étaient guidés par une connaissance précise des mécanismes pathologiques sous-jacents. En théorie, c’est certain, c’est tout l’enjeu de la future médecine personnalisée. En pratique, c’est impossible dans la plupart des cas avec les connaissances disponibles actuellement. Les traitements, qu’ils soient psychothérapiques ou médicamenteux, sont donc prescrits largement dans l’ignorance des mécanismes sousjacents. Il n’en reste pas moins que certains sont efficaces, en moyenne, sur une proportion importante de patients, alors même qu’il est certain qu’il existe une grande variété de mécanismes au sein même des patients à qui le traitement réussit. Ce qui est en soi une confirmation partielle de la pertinence des catégories telles qu’elles sont définies.

Par exemple, la schizophrénie est un trouble d’origine complexe, impliquant une multitude de facteurs de susceptibilité sur de multiples gènes, ainsi que des facteurs environnementaux (comme le cannabis). Chaque patient possède donc une combinaison unique de facteurs génétiques et environnementaux. Faut-il définir une catégorie diagnostique pour chacun ? Ce serait absurde, alors même que les antipsychotiques apportent des bienfaits importants à la plupart d’entre eux. De même, l’autisme a des causes tout aussi complexes et hétérogènes que la schizophrénie. Et pourtant, les approches psychothérapiques et comportementales passées en revue par la Haute Autorité de Santé 1 en mars 2012 semblent réussir à environ 50 % de ces enfants, toutes causes confondues. Peu importe que leur sillon temporal supérieur (ou d’autres régions de leur cerveau) soit perturbé par des facteurs génétiques influençant la synaptogénèse ou la migration neuronale, ou par un virus ou par une hypoxie à la naissance, ce qui compte du point de vue des cliniciens, c’est que les enfants qui ont des déficits cognitifs similaires répondent positivement à un certain type de rééducation et d’éducation qui leur permet de développer certaines compétences cognitives, et ce malgré leurs perturbations cérébrales.
Ainsi, de la même manière qu’il serait absurde de vouloir définir différemment les maladies coronariennes selon qu’elles soient dues à du cholestérol, au tabagisme, à des facteurs génétiques ou à une combinaison complexe des trois, il est absurde de vouloir absolument limiter la définition des troubles mentaux à des mécanismes pathologiques bien identifiés.
Mais bien entendu, il est important de continuer les recherches pour déterminer ces mécanismes, et dans les cas où la découverte de types de mécanismes différents permettrait d’envisager des traitements différents au sein d’une même catégorie diagnostique, il conviendra de réfléchir s’il est plus opportun de subdiviser la catégorie, ou simplement de compléter le diagnostic par un test permettant de déterminer le mécanisme pathologique et le traitement le plus adapté.
Les catégories diagnostiques du DSM biaisent-elles les recherches et déterminent-elles ce qu’elles peuvent trouver ?
Il est vrai que les recherches scientifiques doivent se baser sur des hypothèses précises, le plus souvent du type « les patients avec tel trouble ont telle particularité (démographique, environnementale, cognitive, cérébrale, ou génétique), comparés à des sujets témoins ». Ce qui suppose de s’appuyer sur des catégories diagnostiques définies au préalable ; il n’est donc pas étonnant que la plupart des recherches portent sur les catégories définies dans les classifications internationales.
Mais il ne faudrait pas croire pour autant que cela a pour effet de rendre ces catégories plus « réelles » et de les figer, bien au contraire. Il ne suffit pas de formuler une hypothèse pour qu’elle soit confortée par les données ! Les cimetières de la science sont remplis d’hypothèses qui n’ont pas survécu à la confrontation aux données. Lorsqu’une catégorie diagnostique s’avère trop hétérogène ou incohérente, on échoue à lui trouver des bases cognitives, cérébrales et génétiques stables, qui résistent à l’analyse statistique. Ce qui conduit les chercheurs à proposer de l’abandonner, la redéfinir ou la subdiviser en catégories plus fiables et surtout plus en accord avec les données recueillies. Ce qui importe, c’est de faire de la recherche rigoureuse, basée sur des données objectives, reproductibles, et de faire évoluer les théories et les classifications pour les faire coller de mieux en mieux aux données. C’est le principal moteur de changement des versions successives des classifications internationales. Autrement dit, les classifications des maladies définissent le « réverbère » au pied duquel la plupart des scientifiques cherchent. Mais elles ne garantissent pas d’y trouver quelque chose, et lorsque les résultats sont négatifs, les chercheurs s’éloignent tôt ou tard du réverbère et finissent par en définir de nouveaux.
De fait, il existe déjà de nombreuses données (cognitives, cérébrales, génétiques) à l’appui d’une bonne partie des catégories du DSM-IV et de la CIM-10. En même temps, elles questionnent souvent les catégories à leurs frontières, et c’est tant mieux. Pour donner un exemple, les données cérébrales et génétiques sur l’autisme montrent à la fois que la catégorie diagnostique « autisme » (à la Kanner) est bien ancrée dans une réalité biologique, sinon on n’aurait pas les données convergentes que l’on a déjà, mais que cette réalité biologique est encore plus compatible avec une catégorie plus large, que l’on appelle aujourd’hui « troubles du spectre autistique ». Le DSM-5 doit en tenir compte.
Donc non, le DSM ne crée pas des choses qui n’existent pas. La plupart des catégories existantes sont déjà bien assises empiriquement. D’autres sont améliorables, certaines sont inadéquates, et elles devront donc être révisées en fonction des données. Les classifications orientent parfois les recherches dans des voies sans issue, mais cela ne peut durer qu’un temps ; tôt ou tard, les données finissent par le révéler et suggérer les modifications nécessaires. Par ailleurs, si un chercheur est en désaccord avec certaines catégories actuelles, rien ne lui interdit d’en définir de meilleures, de tester leur validité et de montrer éventuellement qu’elles produisent des résultats plus cohérents.
Des classifications qui s’améliorent régulièrement
Pour conclure, c’est bien parce que les classifications internationales s’appuient sur les connaissances scientifiques et sont révisées régulièrement en fonction de leur évolution, que chaque version successive est meilleure que la précédente et qu’on a toute raison d’être optimiste pour les suivantes. Les classifications des maladies suivent le même processus autocorrecteur que la science en général. Par ailleurs, les reproches qui sont faits à la classification des troubles mentaux par le DSM-IV sont les mêmes que ceux qui peuvent être faits à toutes les classifications de toutes les maladies, et sont inhérents à la nécessité pratique de définir des seuils pour la pathologie et des frontières entre catégories. Il serait déraisonnable d’avoir envers les classifications des troubles mentaux des exigences différentes de celles que l’on a pour les autres maladies. Il faut connaître les limites de ces classifications, comprendre pourquoi elles existent, les utiliser à bon escient et travailler à les améliorer.
Remerciements à Philippe Domenech pour ses commentaires sur une précédente version.
1 | Foncin, J. F. (2008). Réflexions à partir de l’importance de la notion de cause dans la classification des « maladies ». In D. Prat, A. Raynal-Roques & A. Roguenant (Eds.), Peut-on classer le vivant ? Linné et la systématique aujourd’hui (pp. 99-105). Paris : Belin.
2 | Rutter, M. (2011). “Research Review : Child psychiatric diagnosis and classification : concepts, findings, challenges and potential”. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 52(6), 647-660.
Imaginez que dans une spécialité médicale, n’importe laquelle, disons, par exemple, la diabétologie, les spécialistes français s’honorent d’avoir une classification des maladies franco-française. Une classification basée sur des idées sur les causes du diabète différentes de celles communément acceptées dans la recherche médicale internationale, et conduisant à définir les multiples formes de diabète différemment des critères préconisés dans la Classification Internationale des Maladies éditée par l’Organisation Mondiale de la Santé. Qu’en penseriez-vous ? Aimeriez-vous être soigné(e) par ces diabétologues français ? [...] C’est pourtant exactement ce qui se passe au sein de la psychiatrie française. La 5 e édition de la Classification française des troubles mentaux de l’enfant et de l’adolescent (CFTMEA) vient d’être publiée, à destination des psychiatres français souhaitant pratiquer une psychiatrie française, avec des critères diagnostiques fondés sur une théorie psychanalytique des troubles mentaux tombée en désuétude dans le monde entier, sauf en France et dans quelques pays sous influence française. Cette classification débouche sur des modes de prise en charge et sur des pratiques thérapeutiques tout aussi franco-français, et qui, dans le cas de l’autisme par exemple, sont rejetés par la quasi-totalité des associations de patients, et ont fait l’objet de plusieurs condamnations, notamment par le Conseil de l’Europe en 2004, par le Comité Consultatif National d’Ethique en 2005, par un groupe de spécialistes internationaux de l’autisme en 2011, et sont exclues de la recommandation de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé en 2012. Et pourtant, la CFTMEA continue à être largement utilisée par des psychiatres français (particulièrement en pédopsychiatrie), les diagnostics inappropriés continuent à être formulés et les pratiques contestées perdurent. [...]
Extrait d’un texte de Franck Ramus publié sur Lemonde.fr, 26/09/2012 (http://franck-ramus.blogspot.fr/)
Publié dans le n° 303 de la revue
Partager cet article
L' auteur

Franck Ramus
Directeur de recherche au CNRS et professeur attaché à l’École normale supérieure. Il dirige l’équipe « (...)
Plus d'informationsMédecine

Tests microbiote, science ou pseudo-science ?
Le 31 mai 2023
Peut-on vraiment guérir d’un trouble psychique ?
Le 2 septembre 2023
Le regard d’un pionnier de la santé mondiale
Le 17 août 2023
Les populations sous-représentées dans les essais cliniques
Le 27 avril 2023
Maladies neurodégénératives : comment expliquer notre impuissance ?
Le 28 novembre 2022